L’innovation du ciel à la terre à l’École des troupes aéroportées
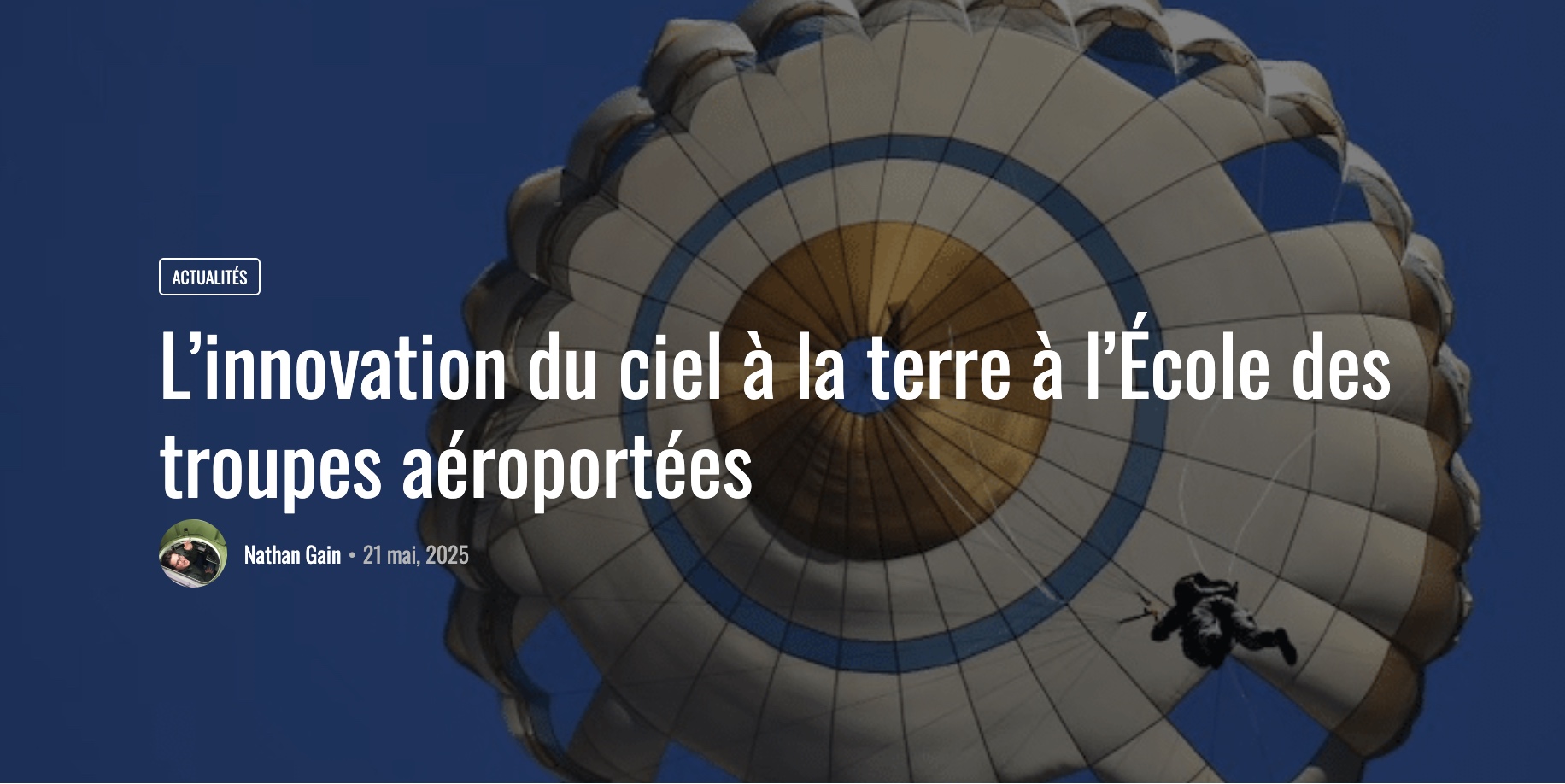
L’innovation est à nouveau à l’honneur à Pau, épicentre béarnais des troupes aéroportées et siège d’une école spécialisée au sein de laquelle quelques-uns réfléchissent aux scénarios et aux équipements des opérations aéroportées (OAP) d’aujourd’hui et de demain. Tour d’horizon des problématiques et de quelques solutions adoptées ou à l’étude en amont d’une Journée innovation des troupes aéroportées (JITAP) propice à élargir le champ des réflexions.
Une école au cœur du domaine TAP
Ils ne sont que 200 et pourtant, ces cadres issus de tous les régiments et de toutes les armées, d’unités conventionnelles ou spéciales, constituent la crème de la crème du combat aéroporté. Ensemble, ils arment l’École des troupes aéroportées (ETAP), seule détentrice des savoir et savoir-faire nécessaires pour former la totalité des parachutistes et chuteurs opérationnels des armées, du ministère de l’Intérieur et de quelques alliés triés sur le volet. Si elle oeuvre principalement au profit de la 11e brigade parachutiste, elle accueille ainsi les marins d’ALFUSCO, les aviateurs de la brigade des forces spéciales air et les gendarmes du GIGN. Mais aussi les écoles, à commencer par Saint-Cyr et l’Académie militaire de la gendarmerie nationale.
Située « au coeur de l’inter-domaine TAP », l’école de Pau propose un catalogue de 35 formations, du brevet de base à l’instructeur en chute libre, le Graal du domaine. Mais pas seulement. L’ETAP est également une référence en matières de réglementation et d’innovation. Et celle-ci innove à plus d’un titre. En matière d’instruction notamment. Depuis peu, elle forme en interne ses propres sous-officiers au bénéfice de la 11e BP. Une première cohorte de 28 stagiaires lançait le processus en octobre dernier. Les former directement dans leur futur environnement de travail permettra de renforcer la cohésion et de donner aux régiments un sous-officier parachutiste « complet », « tactiquement formé » et donc directement opérationnel, relève le lieutenant-colonel Philippe, à la tête du bureau études et prospectives (BEP) de l’ETAP. Mais c’est sur l’adaptation des tactiques et des équipements face au durcissement des menaces que porte l’effort principal.
Après plusieurs décennies de calme relatif, le Sahel aura permis de renouer avec les OAP d’envergure. Ces sauts réalisés durant l’opération Barkhane, les plus ambitieux en quatre décennies, n’affrontaient cependant qu’un ennemi dispersé, peu armé et, surtout, dépourvu de moyens de défense sol-air. Dix ans plus tard, et alors que l’aventure sahélienne s’achève, le danger majeur est non seulement ailleurs mais aussi d’un tout autre acabit. L’adversaire principal, tant pour les TAP que pour le reste des forces françaises, c’est à nouveau une armée conventionnelle, cet ennemi à parité cette fois équipé d’une défense sol-air épaisse, multi-couche et évolutive. Avec un déni d’accès redevenant la norme, l’heure est à l’introspection tous azimuts pour ceux qui doivent avant tout passer au travers.
Passer au travers d’un maillage plus dense
« Nous réfléchissons à ce que sera une OAP face à un ennemi à parité. Il convient de réfléchir au moyen de percer la bulle A2AD et de réaliser une OAP », pointe le lieutenant-colonel Philippe. Comme l’a démontré la phase initiale de l’attaque russe sur l’aéroport de Kyiv en février 2022, « aucune bulle n’est totalement étanche, cela n’existe pas ». Deux ans plus tard, le bouclier israélien, sans doute l’un des plus denses au monde, était à son tour percé par des roquettes et des ULM envoyés par le Hamas. Même la Russie a ses failles, comme le démontre l’envoi régulier de missiles et de drones ukrainiens dans son espace aérien. Bien que « hyper fiable », la défense sol-air a donc ses limites. « Certes, les radars voient, mais l’humain reste en deuxième couche et conserve des faiblesses, notamment dans l’interprétation ». Le coût ensuite. Faut-il nécessairement tirer ce missile complexe, coûteux et dont les stocks sont limités ? La couche la plus dense reste la couche moyenne portée, mais « chaque strate a ses faiblesses » et toute défense sol-air « reste parcellaire et concentrée sur certains points précis ».
Ces limites, l’ETAP les étudie de près pour déterminer les meilleures stratégies de pénétration, d’évitement et de contournement. L’un des officiers du BEP sortait ainsi de six mois d’étude approfondie des matériels russes, américains et chinois. Reste que la menace est désormais bien plus élevée que lors des opérations précédentes. « Tout l’enjeu sera de savoir pourquoi et sur quoi on mène une OAP. C’est toute l’étude que mène la 11e BP aujourd’hui via l’imposition de dilemmes tactiques ». Complexe, la manœuvre « n’est pas sans risque » et ne pourra se conduire qu’en interarmées et interalliés, chacun amenant les moyens disponibles dans tous les champs concernés, cyber y compris, pour aboutir à la combinaison garantissant le plus haut taux de succès. Un alignement des planètes nécessaire de tout temps, mais maintenant beaucoup plus contraint.
Si le premier défi sera de franchir la barrière, le second sera de durer au-delà. Une fois au sol, les troupes aéroportées deviennent autant d’ilots isolés au sein d’un maillage adverse autrement plus dense qu’avant. À l’armée de l’Air et de l’Espace de répondre au premier enjeu, à l’ETAP d’envisager le second pour tenir a minima 96 heures en totale autonomie. Un délai de ravitaillement étendu par rapport à la norme actuelle, plutôt centrée sur deux à trois jours. Gagner de 24 à 48h amène de nombreux défis de poids et de volume, de par l’emport supplémentaire exigé en munitions, nourriture, eau, batteries et autres équipements indispensables. Diminuer la charge du combattant, assurer son ravitaillement, l’évacuation des blessés et la récupération de la force, c’est justement « tout l’objet de nos études pour le moment ».

Un enjeu de poids
Pour l’ETAP, située au coeur d’un écosystème composé de régiments expérimentateurs et du groupement aéroporté de la Section technique de l’armée de Terre (STAT), les réflexions portent sur trois segments, que sont la très grande hauteur, la très basse hauteur et la logistique aéroportée. « Comment j’amène mes troupes sur la zone d’action ? Comment porter plus ? », s’interroge le lieutenant-colonel Philippe. Deux problématiques qui en appellent bien d’autres, comme celles portant sur la limite de la fatigue ou l’allègement de l’équipement. L’une des particularité du parachutiste, c’est en effet sa propension à emporter la quasi totalité du barda individuel et les quelques équipements collectifs sur son dos. Soit près de 50 kg à récupérer et transporter durant au moins quatre jours.
Cette caractéristique engage un réflexion à première vue paradoxale : alléger le sac à dos non pas pour réduire la charge, mais pour permettre d’emporter plus de munitions, plus de rations. C’est tout l’objet de travaux conjoints entre industriels et unités. Avec MOS, par exemple, ce spécialiste de la nutrition « spéciale » engagé pour plancher sur une « ration 96h ». Le résultat ? Un ensemble de pains lyophilisés pour un poids total de 750 g, trois fois moins que la ration actuelle pour cette solution évaluée avec le concours des groupements commandos parachutistes. C’est aussi un travail sur les effets vestimentaires et autres équipements du quotidien, cette fois poursuivi en collaboration avec le 2e régiment étranger de parachutistes. « Nous allons gagner 10 grammes par 10 grammes sur une gamelle, une gourde, un kit de survie », pour in fine finir par réduire la masse de quelques kilogrammes. Le poids ne changera pas, c’est donc sur les moyens d’allègement que planche l’ETAP pour permettre au combattant de tenir dans le temps. « Nous allons lancer une étude sur les sac à dos. Nous sommes en train de voir avec la STAT », indiquent ceux qui lorgnent en parallèle sur de nouvelles clefs de portage pour réduire la fatigue musculaire.
Entre la mise à terre et les premiers pas sur le plancher des vaches, se pose l’épineuse question de la réarticulation. Généralement dégagées, les zones de saut participent à la vulnérabilité de parachutistes dispersés, focalisés sur la récupération de leur matériel, le regroupement, voire à la prise en compte des premiers blessés. Les TAP ne manquent pas d’idées simples pour accélérer et sortir au plus vite de cette phase délicate. Fruit de l’imagination d’un sous-officier, la mule largable démontable (MLD) est une première piste. « Au départ, c’est une branche taillée pour faire un axe, deux roues de brouette et une sangle », rappelle le lieutenant-colonel Philippe. Affinée dans un garage puis inscrite dans le projet de réarticulation rénovée et modernisée, la MLD permettra de gagner de 20 à 30 précieuses minutes lors de cette phase critique. Elle s’accompagne de son pendant électrique, une mule W-Go robotisée propulsée par des roues électriques et dotée d’une capacité d’emport de 700 kg. L’objectif à court terme sera d’en valider le largage.
Autre piste, le sac de récupération de matériel (SRM) vise cette fois à faciliter l’emport des parachutes dorsal et ventral, en les réinstallant devant pour laisser place à la musette et faciliter l’usage de l’arme. « Si on est pris à partie, une simple poignée permet de larguer le tout pour faciliter le combat. C’est tout bête, mais il fallait y penser ». Tant la MLD que le SRM sont passés à l’échelle. Les premières perceptions datent de septembre 2024 pour la 11e BP, avec une vingtaine de MLD équipant depuis lors l’échelon national d’urgence rénové (ENU-R). Un succès qui devrait ensuite bénéficier aux forces spéciales.
Double usage, trottinette et débrouillardise
Rien ne se perd au sein des TAP, tout se conserve. « Il est hors de question de sauter avec du matériel que l’on utilisera pas », explique le chef du BEP. Non seulement le matériel doit servir mais il aura aussi plusieurs usages. La MLD, par exemple, n’est pas limitée à la réarticulation. L’ajout d’une planche ouvre la voie au transport de munitions ou d’un blessé, l’ajout d’une caisse rigide au transport de « tous les petits matériels optroniques, drones et autres équipements fragiles qui ne peuvent pas être largués dans une gaine ». Grâce à la MLD, les TAP pourront emmener plus de munitions antichars et d’appui-feu. Là aussi, l’heure est au recadrage pour conserver ces capacités d’appui tout en musclant la quantité. Parmi les voies explorées sur demande de la brigade, celles d’un lance-roquettes au panel d’effets élargi, plus léger et moins cher que l’Akeron MP, ou encore d’un mortier de 60 mm permettant d’emporter plus de coups, quitte à sacrifier un peu de portée.
L’ETAP pousse également le curseur un cran plus loin en matière de mobilité. Si le Fardier aérolargable amène un début de réponse mais demeure limité en nombre, l’EZRaider pourrait agir en complément. Plus légère, cette trottinette électrique tout terrain d’origine israélienne serait en service dans les forces spéciales israéliennes. Son intérêt hormis ses performances et sa discrétion ? La possibilité d’un largage par une portière latérale une fois repliée en position verticale. Une configuration « comme un colis MILAN » qui la libérerait des contraintes de la livraison par air, apanage du 1er régiment du train parachutiste. La STAT en a acquis deux exemplaires à des fins d’expérimentation. L’un d’entre eux pourrait atterrir à l’ETAP pour confirmer – ou non – la piste de l’aérolargage. En cas de succès, l’EZRaider prendrait ensuite la voie des régiments, voire des forces spéciales, pour en confirmer l’intérêt tactique.
Motorisées à minima, les TAP n’hésiteront pas à aller se servir dans les équipements capturés à l’ennemi ou abandonnés par les populations civiles. Exploiter la débrouillardise du combattant français, voilà l’idée sous-jacente à la création de cette petite trousse à outils qui, accompagnée de quelques matériaux, permettra de faire démarrer un véhicule d’opportunité pour emmener le groupe de combat. « Comment cacher un PC dans des véhicules civils ? Nous sommes largués sans véhicules, comment motoriser la force ? Il y a là un vrai chantier », lance le lieutenant-colonel Philippe. Un chantier dépassant le seul cadre du BEP pour s’étendre à l’ensemble de la 11e BP et un effort parmi d’autres dans un panorama à 360° appelé à évoluer au vu du contexte sécuritaire, des nouvelles technologies et de l’imagination visiblement sans limite des troupes aéroportées. Début de réponse avec une seconde édition de la JITAP propice aux surprises.
Crédits image : ETAP
