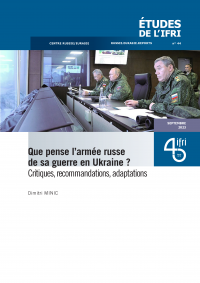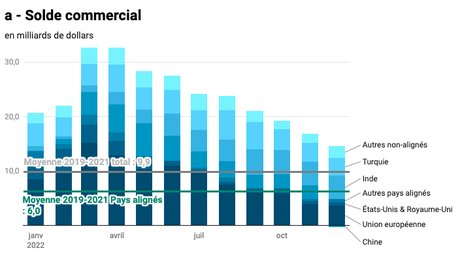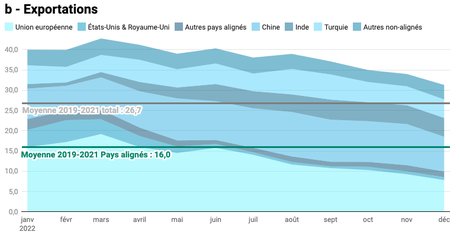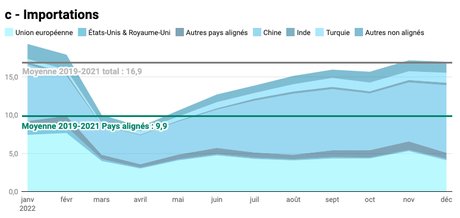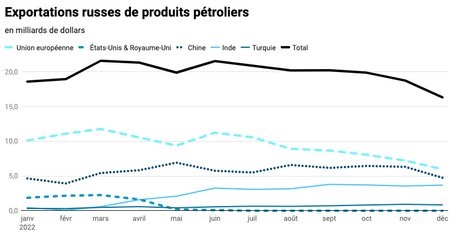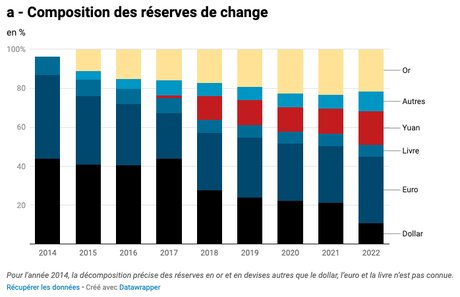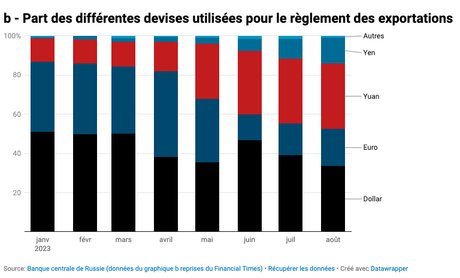Si le conflit entre Arménie, Azerbaïdjan et Haut-Karabagh est parfois évoqué dans l’actualité, les origines historiques et l’imbroglio juridique qui ont présidé à la situation actuelle restent peu connus du plus grand nombre. Cette note entend apporter un éclairage de temps long qui fait souvent défaut et préciser quelques questions de toponymie qui revêtent, ici plus qu’ailleurs, une forte dimension politique.
Les confins de l’Empire perse
Pour bien comprendre de quoi il retourne, il est certainement nécessaire d’effectuer un rappel historique et donc de choisir, un peu arbitrairement, où commencer le récit. Je choisirai donc pour ma part le début du XIXe siècle. Quelle est alors la situation qui prévaut dans le Sud Caucase ? En fait, l’ensemble de la région fait alors partie de l’Empire perse régi en ce temps-là par la dynastie Qadjar qui a succédé en 1789 à la brève dynastie Zend et surtout à la longue dynastie Safavide (1501-1736). Il faut souligner qu’aucune de ces trois dynasties n’est d’origine persane. Ses représentants sont essentiellement turcomans et parlent un dialecte du turc, le turc azéri. Ils n’en sont pas moins profondément assimilés au système impérial iranien qui prévaut depuis la plus haute Antiquité et dont le sentiment national a été renforcé par le particularisme religieux qu’est le chiisme duodécimain. Ce particularisme les différencie par exemple des Turcs ottomans qui règnent sur Constantinople ou des Ouzbeks qui dominent alors l’Asie centrale et qui sont tous sunnites orthodoxes. Le Caucase du Sud est alors depuis longtemps une marche lointaine de l’Empire où vivent de manière assez mêlée trois peuples – les Arméniens, les Géorgiens et des Turcomans que l’on appelle ici des Tatars du Caucase – ainsi que de très nombreuses minorités comme les Talishs, les Lezguiens, les Adjars, les Kurdes, les Zoks et même des Juifs et des Grecs. En termes géographiques, le Sud Caucase constitue un territoire plutôt montagneux, où des hauts plateaux de taille restreinte sont entrecoupés de profondes vallées sauf à l’est où la plaine du Chirvan s’ouvre sur la mer Caspienne, alimentée par les deux grands fleuves que sont la Koura au nord et l’Araxe au sud.
D’un point de vue historique, les Géorgiens, plus précisément la langue géorgienne est présente dans la région depuis toujours. C’est une langue endogène. Les Arméniens se sont constitués en peuple aux alentours de l’an 600 avant Jésus-Christ en prenant la succession de l’antique royaume d’Ourartou auquel ils ont substitué leur aristocratie et leur langue indo-européenne. Les Arméniens étaient aussi très présents au sein de l’Empire ottoman. En fait, la frontière entre les deux empires coupait en deux le haut plateau arménien, en une Arménie occidentale côté turc et une Arménie orientale côté iranien. Les Turcomans sont pour leur part les derniers arrivés vers l’an mil et ont remplacé un peuple autochtone qui avait déjà disparu en tant que tel du fait des invasions arabes : les Albanais du Caucase. La vague de peuplement turcomane s’est étendue sur tout le nord de l’Iran et dans le Caucase du Sud de sorte que les Tatars du Caucase et les Turcomans d’Iran procèdent de la même origine ethnique et culturelle, et partagent la même langue. D’une manière générale, et comme au Liban par exemple, les populations chrétiennes – Arméniens apostoliques et Géorgiens orthodoxes – s’étaient réfugiées dans les zones les plus montagneuses tandis que les colons musulmans occupaient la plaine. On retrouve aussi la différence traditionnelle entre chrétiens plutôt agriculteurs et Turcomans plutôt éleveurs nomades.
Au XIXe siècle, ce qu’on appellera plus tard « le Grand Jeu » bat alors son plein. Il traduit l’affrontement de deux impérialismes antagonistes : le britannique, qui veut coûte que coûte préserver la route des Indes, perle de l’Empire ; et le russe, dont l’objectif est d’atteindre « les mers chaudes » d’où sa flotte pourrait appareiller librement en toute période de l’année. Après avoir soumis le Caucase du Nord et ses populations constitutives – Daghestanais, Tchétchènes et Ingouches notamment –, l’Empire russe jette son dévolu sur ce qu’il appelle alors la Transcaucasie, c’est-à-dire les territoires que nous désignons aujourd’hui sous le nom de Caucase du Sud. A cette époque, bien qu’inféodée à la Perse impériale, la Transcaucasie est divisée en une multitude de khanats semi-indépendants : les khanats de Bakou, de Shirvan, de Gandja, d’Erevan, du Karabagh, etc. Le khanat du Karabagh en particulier est alors dirigé par des familles arméniennes communément désignées sous le terme collectif arabe de « khamsa melik » ou « khamsa melikdom », c’est-à-dire les cinq rois ou les cinq royaumes. Cependant, les dissensions et rivalités entre ces familles régnantes avaient permis vers 1750 à un certain Panah-Ali Khan, un turcoman hostile aux Qadjars, d’asseoir son pouvoir à Chouchi, la capitale du Karabagh sans d’ailleurs que cela ne change grand-chose à la prédominance démographique absolue des Arméniens dans la région.
La Transcaucasie russe
Quoi qu’il en soit, la soumission de la Ciscaucasie permet à l’Empire russe de fondre sur la Transcaucasie face à un Empire qadjar très affaibli et miné par les rivalités entre khans et chefs locaux. L’opération sera menée en deux temps. Aux termes d’une première longue offensive menée de 1804 à 1813, les Russes enlèvent à la Perse tout le Daghestan, la Géorgie, la Mingrélie, l’Abkhazie ainsi que les khanats de Bakou, de Derbent, de Chirvan, de Chaki, de Gandja et du Karabagh [carte 1].
Cette annexion par la Russie aux dépens de la Perse est entérinée par le Traité de Golestan (1813). Puis après une courte accalmie, les Russes reprennent leur offensive de 1816 à 1827 pour arracher les khanats d’Erevan, d’Ordubad et du Nakhichevan, ainsi que celui de Talish, situé entre l’Araxe et la rivière Astara. Ce qu’il faut retenir de ces annexions impériales, c’est qu’elles ont été cadencées en deux temps et que les frontières administratives subséquemment décrétées par l’Empire russe correspondent à ces phases d’avancée coloniale, sans prendre aucunement en compte la réalité sous-jacente des populations. Les territoires colonisés sont ainsi intégrés au sein d’une « vice-royauté » du Caucase divisée en toutes sortes d’entités administratives qui correspondaient plus ou moins aux anciens khanats. On y trouve entre autres un gouvernorat de Bakou, de Tiflis, d’Erevan, mais aussi un gouvernorat d’Elizavetpol, à cheval sur d’actuels territoires arménien, azerbaïdjanais et géorgiens et incluant notamment le Haut-Karabagh [cartes 2 et 3]. Selon le recensement russe de 1897, le gouvernorat d’Elizavetpol comprenait un peu moins de 900 000 habitants dont 60% parlaient tatar – c’est-à-dire le dialecte azéri du turc – comme langue maternelle, tandis qu’environ 33% parlaient arménien. Aucune autre langue ne dépassait 2% de locuteurs. Ces pourcentages masquent bien sûr d’importantes disparités locales et notamment la prédominance absolue de l’élément arménien dans la montagne-refuge que constituait le Karabagh. Du reste, les Arméniens reprennent dès 1905 leurs efforts pour détacher les territoires arméniens du gouvernorat et leur conférer un statut d’autonomie au sein de l’Empire russe, comme ils avaient réussi à le faire du temps de la Perse qadjare.

Carte 1 : Les khanats caucasiens de l’Empire perse et les annexions russes suite aux traités de Golestan et de Turkmenchai (® Fabien Dany[1]).
Les tensions ethniques et confessionnelles vont devenir de plus en plus aiguës avec l’émergence du principe des nationalités dont la matrice intellectuelle fut la Révolution française. Le Risorgimento donne naissance à l’Italie en 1861 et l’Allemagne s’unifie autour de la Prusse après la victoire sur la France en 1870. 1870, c’est aussi la date du Traité de San Stefano par lequel la Russie annexe plusieurs territoires de l’Empire ottoman et notamment – à l’est – les régions géorgiennes et arméniennes de Batoum, Ardvin, Ardahan, Kars et Daroynk (Bayazet). Ces changements de souveraineté vont également conduire à des déplacements de population. C’est par exemple à cette époque que bon nombre de Circassiens (Tcherkesses) musulmans, ainsi que des Tchétchènes qui avaient été battus par Moscou, émigrent vers l’Empire ottoman tandis que des Arméniens se réfugient dans l’Empire russe. Ce principe des nationalités conduit surtout à l’émergence de premiers partis politiques nationaux, d’un renouveau des luttes pour l’indépendance au sein des empires centraux et, bien évidemment, de la répression qui les accompagnent.

L’essor des nationalités
Un premier parti politique arménien d’essence libérale démocrate, le parti Armenagan, naît à Van en Arménie turque en 1885, c’est-à-dire après que l’Empire ottoman ait expérimenté une phase de relative libéralisation et alors qu’il se durcissait à nouveau sous le règne d’Abdul Hamit II. Peu après, deux partis arméniens d’essence révolutionnaire apparaissent à leur tour : le parti Hentchak, créé en 1887 à Genève, et le parti Tachnak, créé en 1890 à Tiflis. Ces partis inspirés par la Révolution française et par les mouvements populistes (narodnik) russes sont de tendance socialiste révolutionnaire mais ce sont aussi des partis nationalistes en ce qu’ils envisagent le progrès social dans le cadre d’une révolution nationale. Ils ne diffèrent en rien des formations équivalentes qui apparaissent à la même époque au sein des États qui étaient en train de gagner leur indépendance ou qui rêvaient de le faire, comme par exemple le Parti ouvrier social-démocrate géorgien, fondé en 1893, ou le Parti social-démocrate ouvrier bulgare, créé en 1894. Toutes ces formations partageaient les mêmes aspirations, celles de l’indépendance nationale et du progrès social indissolublement liés. Influencés par les idées nouvelles venues d’Europe, les minorités non-musulmanes étaient en avance sur les musulmans en la matière. Chez ces derniers, face aux pratiques moyenâgeuses du pouvoir corrompu et dictatorial du sultan, la volonté de sédition et l’aspiration à la modernité sont d’abord incarnées par les Jeunes-Turcs du Comité Union et Progrès dont les idées se répandent dans les élites militaires de l’Empire à partir de 1895, mais dont le congrès inaugural se tient à Paris en 1902. En Transcaucasie, le Parti musavat des Tatars ne fut fondé – et encore sous la forme d’une société secrète – qu’en 1911, sur le modèle et à l’instigation des Jeunes-Turcs.
Face au souffle de la modernité, essentiellement porté par ses minoritaires, le sultan suscite et organise les premiers massacres d’Arméniens de 1894 à 1896. Face à ces massacres qui font environ 300 000 morts, le parti Tachnak inaugure la méthode du terrorisme publicitaire avec la prise de la banque ottomane réalisée en 1896 dans l’espoir – après les Traités de San Stefano et de Berlin – d’attirer l’attention des Occidentaux sur le sort d’iniquité fait aux populations arméniennes de l’est de l’Empire. C’est un échec qui conduira à de nouveaux massacres, sans décider les puissances européennes à intervenir. Il n’en reste pas moins que des années 1890 à la Première Guerre mondiale, ces divers mouvements révolutionnaires vont tenter sans succès de faire tomber les empires centraux, autocratiques et arriérés. Dans l’Empire ottoman, ce sont les Serbes, les Bulgares, les Macédoniens et les Arméniens qui tiennent le terrain, suscitant l’admiration jalouse des Jeunes-Turcs en exil à Paris, au Caire où se cachant à Salonique.
Ces derniers parviennent néanmoins à déposer le sultan en 1908 et à s’emparer du pouvoir. S’ils ne parviennent pas à dissiper la méfiance à leur égard des militants du parti Hentchak, ils bénéficient cependant du soutien des Tachnaks, qui déposent les armes, et même d’une partie de la classe politique européenne, de Jaurès notamment, aux yeux de laquelle ils se sont présentés comme des réformateurs progressistes. C’est cependant un masque qui va bien vite tomber car l’échec des tentatives de réformes de l’islam et de le concilier avec la modernité d’une part, la perte définitive des provinces balkaniques après 1912 d’autre part, achèvent de muer les Jeunes-Turcs en un mouvement férocement nationaliste, adepte des théories raciales et du darwinisme social alors en vogue en Europe. Leur projet consiste à transformer le vieil empire multiethnique et multiconfessionnel en État-nation turc. Après un nouveau massacre d’Arméniens à Adana en 1909, c’est la guerre mondiale qui donne aux Jeunes-Turcs l’occasion rêvée de mettre en œuvre leur projet d’extermination.
Guerre et génocide
Lorsque la guerre éclate, l’Empire ottoman était alors proche de l’Allemagne qui cherchait à se tailler un empire qu’elle n’avait jamais vraiment eu. C’est donc naturellement que la Turquie se range aux côtés de la Triple Alliance et qu’elle attaque la Russie sur le front caucasien afin de reprendre les provinces arméniennes de Kars et Ardahan perdues en 1870. L’offensive conduite par des troupes en bras de chemise en plein hiver 1914 sur le haut plateau arménien est un désastre militaire pour l’Empire ottoman. C’est aussi le prétexte de trahison arménienne qui sert de déclenchement au génocide que je ne détaillerai pas ici, si ce n’est pour dire qu’il a conduit – selon les estimations – de 1,2 à 1,5 millions de morts, soit dans tous les cas les deux tiers de la population arménienne de l’Empire. Quand l’armée impériale russe avance en 1916 en Arménie ottomane, elle y trouve un territoire d’où les vivants ont disparu et où ne restent que des charniers [carte 4]. Seule la ville assiégée de Van a pu tenir suffisamment longtemps face aux massacreurs pour accueillir les Russes en libérateurs. Comme on le sait cependant, la Révolution russe éclate en octobre 1917 et les soldats de l’armée impériale abandonnent le front – notamment le front caucasien – laissant les conscrits arméniens, géorgiens et tatars seuls face aux Ottomans qui ne sont pas encore défaits.

Carte 4 : Avancée maximale des troupes russes dans l’Empire ottoman avant la Révolution d’octobre[2]
Politiquement parlant, l’effondrement de l’Empire russe laisse un vide qu’il s’agit de combler. Dès la fin novembre 1917, Arméniens, Géorgiens et Tatars du Caucase créent un « Commissariat de Transcaucasie » et une Diète transcaucasienne – le Seim – se réunit à Tiflis, le 23 février 1918. Cette assemblée est composée de 44 députés musulmans, 29 Géorgiens, 24 Arméniens et 3 Russes. Le 10 avril, son président, Nicolas Tcheidze, proclame l’indépendance de la République démocratique fédérative de Transcaucasie. Cependant, l’armée ottomane, qui avait signé un armistice avec la Russie, progresse afin de recouvrer les territoires ottomans et même de conquérir le Caucase russe. Après la prise d’Erzeroum, de Van, de Kars, les Turcs sont à Batoum début avril et à Alexandropol – aujourd’hui Gyumri, en Arménie – à la mi-mai [carte 5]. La menace turque révèle au grand jour les divergences d’intérêts des trois nations du Caucase qui conduisent à l’éclatement rapide de la République démocratique fédérative de Transcaucasie. La Géorgie proclame son indépendance le 26 mai pour se placer sous protection allemande. Les Arméniens parviennent in extremis à stopper l’avance des Turcs – au cours de trois batailles devenues depuis lors mythiques dans la psyché nationale – pour déclarer leur indépendance le 28 mai, tandis que les Tatars, qui n’espéraient que l’avènement au Caucase de leurs cousins turcs, créent le même jour la République d’Azerbaïdjan.

Carte 5 : Progression ottomane dans le Caucase au printemps 1918 (Anahide Ter Minassian, La République d’Arménie, éditions Complexe, 1989).
Les indépendances et la création d’États-nations au Sud-Caucase
Si les victoires des Arméniens permettent d’éviter l’anéantissement total que leur promettaient les Turcs, et si elles autorisent la création de cette première république, elles ne constituent cependant que des succès en demi-teinte qui n’empêchent pas l’Empire ottoman d’imposer des conditions très dures à cette République par le Traité de Batoum du 4 juin 1918. Aux termes du traité, l’Arménie est essentiellement réduite aux pourtours d’Erevan et du lac Sevan. Les conditions de l’indépendance sont par ailleurs indescriptibles : à la misère et à la famine s’ajoutent l’afflux de dizaines de milliers de rescapés du génocide qui arrivent dans un dénuement total en Arménie orientale. Les Tatars sont partout et menacent, la dysenterie et le typhus sont omniprésents, tout manque. C’est dans ces conditions qu’un héros arménien, le général Andranik, rompt avec le gouvernement Tachnak de cette première République et conduit une guérilla féroce dans la région du Siounik – dans le Sud de l’Arménie actuelle –, éperon rocheux à la frontière iranienne que les Turcs appellent Zanguezour. La campagne sans pitié dans laquelle se lance Andranik contre les Tatars, qui peuplent en partie la région, aboutira à sa réarménisation. Faisant la jonction avec le Karabagh, c’est son action qui permet à l’Arménie de recouvrer ces deux territoires précédemment perdus.
Il faut en effet bien comprendre que jusque-là, les populations des trois nations caucasiennes étaient inextricablement mêlées. Si on prend l’exemple de Tiflis, le recensement de 1897 y indique une population de 159 000 habitants dont 38% d’Arméniens, 26% de Géorgiens et 25% de Russes. A Bakou, qui comporte 260 000 habitants en 1917, on dénombre 79 000 Russes, 69 000 Arméniens et pas moins de 20 nationalités. Les 81 000 musulmans présents n’y sont pas tous tatars. La haute bourgeoisie enrichie par le pétrole est surtout arméno-russe tandis que le prolétariat est très mélangé mais stratifié, avec les Tatars tout en bas de l’échelle sociale. La question sociale y est avivée par les rivalités ethniques qui ont déjà donné lieu en 1905 à une guerre arméno-tatare et à de violents pogroms.
Depuis février 1917, date de la première révolution menchévique, Bakou est administré par une Douma libérale et un soviet modéré où les bolcheviques cohabitent avec de nombreuses autres tendances politiques issues de différents groupes nationaux, dont les Tachnaks arméniens. La proclamation de la République d’Azerbaïdjan, qui s’est faite à Tiflis, s’est accompagnée en février 1918 de l’envoi dans la plaine du Chirvan d’une Armée de l’islam dirigée par Nuri Pacha, le beau-frère d’Enver Pacha, l’un des dirigeants ottomans responsables du génocide. L’objectif de ces forces panturquistes est de prendre Bakou et, comme en Arménie occidentale, d’y éradiquer la population arménienne. Ces forces sont accueillies à bras ouverts par les musavatistes tatars qui se retournent contre le gouvernement des soviets. S’engage alors l’épisode célèbre du siège de la commune de Bakou – que magnifiera par la suite la propagande soviétique –qui met aux prises les assaillants turco-tatars et les défenseurs arméniens et russes de la ville, où la direction politique des bolcheviques est secondée par les capacités opérationnelles des Tachnaks. Le siège de Bakou durera de juin au 15 septembre 1918 et s’achèvera par la chute de la ville, la fuite des commissaires politiques bolcheviques et le massacre par les Tatars et l’armée régulière turque d’environ 15 000 Arméniens. Le gouvernement tatar d’Azerbaïdjan installé jusqu’alors à Elizavetpol – aujourd’hui Gandja – peut rentrer dans la capitale qu’il s’était donnée, dans les wagons de l’armée turque.
Cependant, avec l’armistice de Moudros signé le 30 octobre, les Turcs défaits par les puissances de l’Entente se voient contraints d’évacuer toute la région. Aux termes de celle-ci, l’Arménie indépendante recouvre le district de Kars, une grande partie du district d’Ardahan, le reste revenant à la Géorgie, et même le Nakhitchevan et le Karabagh – nous reviendrons plus loin en détail sur ce dernier cas – passant ainsi d’un réduit invivable de 11 000 km2 à 42 000 km2.
L’Azerbaïdjan : histoire d’une usurpation
Quelques mots maintenant sur l’invention de l’Azerbaïdjan. Le choix de ce nom pour la première république tatare du Caucase n’est pas anodin ni dénué d’arrière-pensées. Historiquement parlant, les territoires sur lesquels s’établit cette République ne se sont jamais dénommés Azerbaïdjan. Depuis des siècles, ces régions de plaines dans les basses vallées de l’Araxe et de la Koura s’appelaient Arran, Chirvan et Mugham [carte 6]. Ce sont les agents panturquistes Jeunes-Turcs qui ont suggéré aux Tatars musavatiste ce nom qui avait toujours désigné la région frontalière de l’Iran situé au sud de l’Araxe. Le mot Azerbaïdjan constitue une déformation tatare du terme arméno-persan Aderbadagan que les Grecs antiques appelaient Atropatène, du nom d’Atropatès, satrape du grand roi achéménide Darius. Du reste, le choix de ce nom d’État suscita de très vigoureuses protestations de la part de l’Iran. Le fait est que depuis les invasions turcomanes de l’an mil, les deux côtés de l’Araxe sont majoritairement peuplés de turcomans – qu’on appelaient jusqu’alors Tatars dans l’Empire russe – qui partagent la même langue, le dialecte azéri du turc. En choisissant ce nom, l’objectif irrédentiste des Jeunes-Turcs était – et reste jusqu’aujourd’hui – de pouvoir ultérieurement revendiquer ces régions septentrionales de l’Iran. C’est pour la même raison et avec les mêmes visées que les bolcheviques se gardèrent bien de changer ce nom lorsque, ultérieurement, ils substituèrent à cette première république indépendante la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan (RSSAz). Ainsi, par une stupéfiante inversion, les médias actuels se croient-ils obligés de préciser « Azerbaïdjan iranien » pour désigner la région qui a de tout temps porté ce nom, tandis qu’ils ont adopté sans réserve et sans épithète le nom factice d’Azerbaïdjan pour un État qui l’a usurpé.

Carte 6 : Les provinces d’Azerbaïdjan, au sud de l’Araxe et d’Arran, de Shirvan et du Mughan, au nord de l’Araxe, dans l’Empire perse[3].
Dans la même logique, les Tatars qui souhaitent désormais être appelés « Azerbaïdjanais », considérant les termes de tatar, turcoman ou turkmène comme péjoratifs, ont-ils éprouvé le besoin de se constituer les lointaines et honorables origines historiques dont ils éprouvaient le manque. C’est ainsi que dès les années 50, des idéologues azerbaïdjanais ont tenté d’établir une filiation imaginaire entre les Azerbaïdjanais et un peuple disparu, les Aghvans, que les sources grecques antiques désignaient comme Albanais du Caucase. Les Aghvans qui peuplaient la région d’Arran étaient un peuple caucasien, christianisé dans la foulée des Arméniens et des Géorgiens, mais qui disparut en tant que tel dès les invasions khazars, puis arabes, de la région et qui était déjà éteint depuis longtemps lors de la submersion turcomane. S’il est possible et même probable que les actuels Azerbaïdjanais descendent partiellement de ces anciens Albanais avec lesquels leurs ancêtres ont fait souche, il n’y a strictement aucune continuité historique entre les deux peuples en dépit des incessantes tentatives de l’Azerbaïdjan pour s’arroger les rares artefacts authentiquement albanais ou des églises et monastères arméniens présentés comme albanais. Du reste, s’il y avait une véritable proximité culturelle, c’était bien celle qui existait dans les temps antiques entre les Arméniens et ces Albanais dont l’Église nationale constituait un archevêché de l’Église arménienne et dont le Catholicos était ordonné par le Catholicossat de l’Église apostolique arménienne. Il ne faut pas chercher ailleurs que dans ce ressentiment des primes origines et d’une légitimité historique défaillante, la politique de haine arménophobe qui constitue depuis sa création la principale politique d’État, voire la raison d’être de l’Azerbaïdjan, qui se comporte à cet égard, et pour les mêmes raisons, comme le Pakistan envers l’Inde.
La soviétisation et l’annexion du Karabagh à l’Azerbaïdjan soviétique
Les trois États caucasiens nouvellement créés vont demander leur adhésion à la Société des Nations dès que celle-ci émerge, c’est-dire alors que sont négociés avec les empires centraux vaincus les traités de paix de fin 1919, début 1920 : de Versailles pour l’Allemagne (juin 1919), de Saint-Germain-en-Laye pour l’Autriche (septembre 1919), de Neuilly pour la Bulgarie (novembre 1919), de Trianon pour la Hongrie (juin 1920) et de Sèvres (décembre 1920) pour l’Empire ottoman. Le 10 décembre 1920, une commission de la Société des Nations donne un avis favorable à la candidature de l’Arménie dont elle reconnaît le territoire de 70 501 km2 avec le Nakhitchevan et le Karabagh ; tandis qu’elle avait rejeté celle de l’Azerbaïdjan le 5 décembre, au motif que ses frontières occidentales, c’est-à-dire celles avec l’Arménie incluant le Karabagh étaient mal définies. Sur le terrain, loin des décisions de la Société des Nations, les combats pour le contrôle du Karabagh continuent cependant de faire rage et du 22 au 26 mars 1920. L’armée azerbaïdjanaise entre dans Chouchi, la capitale du pays, qu’elle ravage et où elle massacre plusieurs milliers d’Arméniens, peut-être jusqu’à 20 000 personnes.
La pacification intervient avec le retour de l’Armée rouge dans la région qui rend par ailleurs caduques les décisions de la Société des Nations : l’Azerbaïdjan était soviétisé dès avril 1920, l’Arménie le fut en décembre et la Géorgie, que bien sous protectorat allemand, ne put résister à la pression bolchévique au-delà de mars 1921. Les Soviétiques placent alors l’ensemble de la région sous l’autorité d’un « bureau caucasien » (Kavburo) qui proroge en quelque sorte l’ancien gouvernorat tsariste. Le 30 novembre 1920, au lendemain de la soviétisation de l’Arménie, Bakou envoyait un télégramme à Erevan pour reconnaître le Karabagh, le Zangezour et le Nakhitchevan comme parties intégrantes de la République socialiste soviétique d’Arménie (RSSAr) Quelques jours plus tard, le 2 décembre, Bakou reconnaît cette fois le droit du peuple du Karabagh à l’autodétermination. Cette reconnaissance est entérinée par toute une série de décisions ou déclarations au cours de l’été 1921 : le 12 juin par une déclaration du Conseil national de la RSSAz ; le même mois par la RSSar qui prend ainsi acte de la renonciation de l’Azerbaïdjan à ses prétentions précédentes ; et enfin le 4 juillet par le Kavburo lui-même, réuni en séance plénière à Tiflis.
Cette concorde de façade cache cependant mal l’hostilité réelle entre Arméniens et Azerbaïdjanais qu’un facteur extérieur va favoriser. La Russie soviétique est encore un État fragile en recherche d’alliés et Staline voit dans la réémergence d’un mouvement nationaliste turc opposé aux impérialistes occidentaux, l’occasion d’attraire la Turquie dans le camp de la révolution bolchevique. Le rusé leader nationaliste turc, Mustafa Kemal, feint de se montrer favorable aux bolcheviques mais fait comprendre à Staline qu’il doit favoriser les musulmans du Caucase. Ainsi, dans la nuit suivant la déclaration du Kavburo, le nouveau maître du Kremlin intervient personnellement pour renverser la décision et rattacher le Karabagh et le Nakhitchevan à la RSSAz, hors de toute procédure légale, même soviétique. La décision est habilement enrobée comme participant de la volonté de transformer la RSSAz en un nouveau type de république sans nation où coexisteraient fraternellement musulmans et Arméniens. La consécration de cette décision intervient lors du processus d’étatisation de l’URSS débuté en décembre 1922. Le 7 juillet 1923, une commission russo-azerbaïdjanaise délimite un oblast, c’est-à-dire une région autonome du Haut-Karabagh (NKAO). Elle prend bien soin de ne lui attribuer que le quart des terres relevant du Karabagh historique et surtout, de détacher cette nouvelle entité juridique de la RSSAr, en créant un prétendu « bas Karabagh » intégré à RSSAz. Un processus similaire se déroule au Nakhitchevan qui devient République Socialiste Soviétique dès le 16 mars 1921 avant d’être rattaché à l’Azerbaïdjan en tant que République autonome le 9 février 1924 [carte 7].

Carte 7 : Le Caucase soviétique avec la République autonome du Nakhitchevan et l’oblast du Haut-Karabagh[4].
Comme on le voit donc, ni l’une ni l’autre de ces deux entités n’ont jamais fait partie d’un Azerbaïdjan indépendant, État qui n’apparaît lui-même dans l’histoire qu’en 1918. Il n’en pas moins vrai que la politique de discrimination raciale conduite par cet État parachève l’élimination des autochtones arméniens comme l’avait fait quelque temps auparavant le génocide en Arménie occidentale. En 1917, les Arméniens constituaient encore 40% de la population du Nakhitchevan. Ils ne sont plus que 10% en 1926, 3% en 1970 et 0,6% à la veille de l’éclatement de l’URSS. Un processus similaire mais moindre touche le Haut-Karabagh, plus enclavé et montagneux. En 1926, il compte 89% d’Arméniens et 10% d’Azerbaïdjanais ; en 1970, 80% d’Arméniens et 18% d’Azerbaïdjanais et en 1989, 76% d’Arméniens et 21% d’Azerbaïdjanais.
La période soviétique et le processus d’indépendance
Pendant toute la période soviétique, les Arméniens du Haut-Karabagh n’abandonneront jamais leur lutte contre cette annexion inique de nature parfaitement coloniale, génocidaire de surcroît. Même au plus fort de la période stalinienne, ils ne cesseront d’envoyer des demandes, pétitions et manifestes. Mais c’est bien sûr l’arrivée au pouvoir de Gorbatchev et les politiques de perestroïka et de glasnost qu’il inaugure qui libèrent toutes les potentialités. A partir du 13 février 1988, des dizaines de milliers de personnes se rassemblent spontanément à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabagh depuis que Chouchi a été mise à sac, pour signer à nouveau une demande de réunification avec la République d’Arménie voisine. Le 20 février, le soviet de la Région autonome réuni en session extraordinaire vote la sécession d’avec l’Azerbaïdjan et la réunification avec l’Arménie « sur la base des normes légales en vigueur et des précédents de résolution de conflits similaires en URSS ».
Bien que cette décision ait respecté toutes les conditions prévues par la Constitution en vigueur, elle est rejetée par le Comité central du Parti communiste d’URSS le 23 février. Entre temps, les manifestations ne faiblissent pas au Karabagh et même en Arménie voisine où plus d’un million de personnes — le tiers de la population du pays — se rassemblent dès le 21, à la suite d’agressions perpétrées par les autorités azerbaïdjanaises à l’encontre d’Arméniens du Karabagh. La troupe et des chars sont envoyés en Arménie par le pouvoir central afin de restaurer l’ordre alors que des leaders commencent à émerger à travers le « Comité Karabagh ».
La réponse des autorités azerbaïdjanaises à cette déclaration de rattachement à l’Arménie ne se fait pas attendre. Du 27 au 29 février, des bandes de tueurs dûment armées par les autorités et encouragées par les forces de l’ordre s’attaquent aux populations arméniennes de Soumgaït, banlieue industrielle de Bakou. Officiellement les pogroms font 32 morts mais les décomptes officieux font apparaître des chiffres bien plus élevés et les méthodes rappellent aux Arméniens le génocide qu’ils ont subi en 1915. Le 29 février, la loi martiale est décrétée tandis que les Arméniens d’Azerbaïdjan commencent à fuir le pays pour se réfugier au Karabagh ou en Arménie. Ces massacres et ceux qui suivront (Kirovabad, novembre 1988, Bakou janvier 1990) achèvent de rendre inenvisageable l’idée d’un retour du Karabagh dans le giron de l’Azerbaïdjan.
Entre juin et septembre, plusieurs votes des autorités karabaghiotes confirment la sécession d’avec l’Azerbaïdjan et le rattachement à l’Arménie, tous rejetés par Moscou qui, le 20 septembre, instaure l’état d’urgence, puis la loi martiale au Karabagh. La situation empire avec le tremblement de terre en Arménie (7 décembre 1988) qui précipite le chaos et révèle l’incurie du pouvoir soviétique. Incapable de faire face seul au désastre, Moscou autorise pour la première fois des équipes de secouristes étrangers à pénétrer sur son sol. Dès le lendemain du tremblement de terre cependant, les membres du Comité Karabagh sont arrêtés.
Alors que dans toute l’URSS, les tendances sécessionnistes s’accélèrent, Moscou tente d’enrayer le processus en promulguant deux textes législatifs : la loi du 3 avril 1990 « sur les modalités de résolution des questions liées à la sécession d’une République fédérée de l’URSS » et l’arrêté du Soviet suprême du 26 avril de la même année « sur l’entrée en vigueur de la loi de l’URSS sur la répartition des pouvoirs entre l’URSS et les membres de la fédération ». C’est sur la base de ces deux dispositions qui signent quasiment l’acte de décès de l’URSS que, le 2 septembre 1991, les Karabaghiotes par la voix de leur Conseil régional exercent leur droit à l’autodétermination en proclamant la République du Haut-Karabagh (RHK). Conformément aux exigences du Droit international, cette déclaration fut ensuite entérinée par un référendum organisé le 10 décembre de la même année. Le taux de participation au referendum fut de 82,2% dont 99,89 % votèrent en faveur de l’indépendance.
Il faut souligner que cette indépendance fut proclamée sur la base territoriale de l’oblast soviétique (NKAO) et de la région adjacente de Chahoumian qui en avait été arbitrairement exclue par la RSSAz, c’est-à-dire sur les territoires où Bakou n’avait pas eu le temps d’achever le nettoyage ethnique. Il faut souligner également que la République du Haut-Karabagh se détacha ainsi légalement de l’URSS avant la disparition formelle de celle-ci, survenue le 25 décembre 1991 et avant la restauration des indépendances de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan survenues respectivement le 21 septembre et le 18 octobre 1991.
Cette chronologie est cruciale en termes de droit international. En effet, lorsque l’Azerbaïdjan proclame son indépendance de l’URSS, la République du Haut-Karabagh en a déjà légalement fait sécession. Cet acte ne la concerne donc plus. De surcroît, la déclaration d’indépendance de l’Azerbaïdjan fait explicitement référence à la première république démocratique d’Azerbaïdjan (1918-1920), donc à un État dont la base territoriale n’incluait pas le Karabagh comme l’indiquaient les décisions de la Société des Nations. On a vu en effet que la région autonome n’avait été annexée à l’Azerbaïdjan que par le pouvoir soviétique et encore de manière parfaitement arbitraire. En quittant l’URSS, l’Azerbaïdjan perdait donc le douteux bénéfice de son protectorat sur le Karabagh, d’autant plus que celui n’était déjà plus concerné. Les actuelles prétentions de l’Azerbaïdjan sur le territoire du Karabagh ne reposent en conséquence sur aucune base juridique, pas plus du reste que les arguments cyniques des Occidentaux qui proposent d’intégrer les Karabaghiotes dans l’État azerbaïdjanais, ce qui signifierait leur disparition.
Trente ans de Karabagh libre
A partir de 1991, les tentatives d’annexion de Bakou tournent ouvertement à la guerre d’agression au cours de laquelle l’armée de défense de la République du Haut-Karabagh et l’Arménie, son alliée, libèrent de 1991 à 1994, une partie des territoires du Haut-Karabagh qui avaient été annexés en 1921 à la RSSAz. L’équilibre des forces fait qu’elles ne parviennent cependant pas à libérer le district de Chahoumian qui sera dès 1991 vidé de sa population arménienne par les habituels procédés d’épuration ethnique azerbaïdjanais. En revanche, la République du Haut-Karabagh recouvre des territoires du prétendu bas Karabagh qui avaient été arbitrairement séparé de l’oblast soviétique, et elle constitue même un glacis dans la plaine d’Arran qui permet de maintenir à distance l’agresseur [carte 8]. Ces victoires militaires ont été rendues possibles par un retournement d’alliance russe et surtout par des luttes internes en Azerbaïdjan qui ont conduit à l’effondrement politique et militaire du pays qui a présidé à l’avènement du clan Aliev. Cette guerre s’accompagne d’un échange forcé de populations entre les anciennes Républiques soviétiques : environ 600 000 Azerbaïdjanais quittent l’Arménie et le Haut-Karabagh, tandis que 400 000 Arméniens quittent l’Azerbaïdjan.
En bons stratèges, les Russes ont cependant contraint les Karabaghiotes et leurs alliés arméniens à signer un cessez-le-feu le 16 mai 1994, mais sans qu’il ne soit sanctionné par un traité de paix définitif. Cette situation permettait à Moscou de continuer à jouer de la concurrence arméno-azerbaïdjanaise et de maintenir son rôle de parrain de la région.
Quoi qu’il en soit, la paix relative qui s’instaure permet au Haut-Karabagh et à ses 150 000 habitants de prospérer en se dotant d’institutions étatiques, un Président et une Assemblée nationale notamment, où règne un vrai multipartisme. Le pays rétablit aussi, à côté de son nom colonial russo-turc de « Nagorno-Karabagh », son nom autochtone original d’Artsakh qui désigne la province d’Arménie historique des lieux. L’Artsakh améliore ses ressources vivrières, se dote progressivement d’une petite industrie et d’infrastructures touristiques en dépit de l’absence de reconnaissance internationale. En effet, la question du règlement du conflit est alors confiée à l’Organisation de Sécurité et de Coopération en Europe (OSCE) dans le cadre duquel les parties belligérantes – Arménie, Azerbaïdjan et Artsakh – sont assistées par un groupe de médiateurs ad-hoc, dit « groupe de Minsk », coprésidé par la Russie, les Etats-Unis et la France. Dans le cadre de ce processus, l’Arménie elle-même ne s’engage pas dans la voie de la reconnaissance de l’Artsakh, estimant que cette posture lui permettra de préserver un canal de dialogue qui devait aboutir à la paix. En pratique cependant, les négociations s’avèrent stériles et – pire – l’Artsakh en est progressivement évincé par le fait que l’un de ses anciens présidents, Robert Kotcharian, devenu président d’Arménie, s’arroge le pouvoir de négocier aux nom des deux parties arméniennes, un choix adoubé par le Groupe de Minsk comme par l’Azerbaïdjan qui refuse tout dialogue direct avec Stepanakert.

Carte 8 : Les Républiques d’Arménie, d’Azerbaïdjan et d’Artsakh incluant la zone tampon.
Le district de Chahoumian restant occupé par l’Azerbaïdjan (1994-2020)[5].
Entre temps, l’Arménie qui a adhéré à l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) – une sorte d’OTAN rassemblant d’anciennes républiques soviétiques – fonde toute sa sécurité sur l’alliance avec la Russie. Erevan se pose aussi en garant de la sécurité de l’Artsakh. L’alliance russe entretient cependant la partie arménienne dans une fausse impression de sécurité alors que l’Azerbaïdjan – dopé aux ressources financières provenant de l’exploitation des hydrocarbures de la Caspienne – se dote d’un équipement militaire moderne de plus en plus impressionnant. A la fin des années 2010, le budget militaire de l’Azerbaïdjan dépasse à lui seul le budget total de l’Arménie.
Révolution de velours arménienne et attaque de Bakou sur l’Artsakh
A la fin mai 2018, un nouvel évènement va venir bouleverser cet équilibre précaire : Le pouvoir arménien assuré par les présidents successifs Robert Kotcharian puis Serge Sarkissian, qui incarnaient la continuité de l’alliance avec Moscou, est renversé par Nikol Pachinian au cours d’une « révolution de velours » effectuée sans qu’un coup de feu ne soit tiré. Contrairement à ses prédécesseurs formés à l’école soviétique, tout comme le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, Nikol Pachinian incarne une pensée plus libérale. Tous ses ministres ont été formés dans des universités américaines et si Pachinian se garde bien de rompre ouvertement avec Moscou – qu’il tente de rassurer de ses bonnes dispositions – sa seule personne et son faible entregent au sein du pouvoir russe ne pouvaient que susciter la méfiance de Moscou. Par ailleurs, afin de complaire à son électorat, Pachinian se lance dans une vendetta judiciaire irréfléchie contre l’ancien président Kotcharian, notoirement connu comme étant l’homme de Moscou.
Il n’en fallait sans doute pas plus pour provoquer un retournement d’alliance du Kremlin qui a certainement autorisé, au moins implicitement, l’attaque de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan qui allait suivre. Au-delà de l’aversion du Kremlin pour Pachinian et ce qu’il représente, deux autres facteurs sont à prendre en compte pour expliquer que Bakou ait alors repris l’offensive. Un premier élément circonstanciel réside dans les propos inutilement provocateurs de Pachinian, qui s’est rendu en Artsakh dès son élection pour déclarer publiquement que « le Karabagh, c’est l’Arménie », ce qu’aucun Arménien ne conteste, mais que les responsables précédents s’étaient prudemment abstenus de déclarer pour préserver un espace de négociation avec Bakou. Le second facteur, plus lourd, est la perte d’influence progressive de l’Occident et la montée en puissance de la Turquie, notamment dans le Caucase du Sud. Outre que Vladimir Poutine ait sans doute voulu punir Pachinian, il a peut-être également considéré qu’il avait peu à perdre avec une Arménie qui lui est presque totalement inféodée mais qu’il devait accéder aux demandes de Bakou sous peine de voir l’influence turque s’y renforcer à nouveau. N’oublions pas en effet que l’attaque survient alors que la guerre, déjà engagée en Ukraine, montre les limites inattendues mais très marquées du potentiel militaire russe. En un mot, le changement d’équilibre et la guerre qui va s’en suivre résultent autant de la montée en puissance de la Turquie que de l’affaiblissement de la Russie dans la région.
Après une première alerte en juillet 2020, l’Azerbaïdjan attaque l’Artsakh le 27 septembre. Il s’agit d’une offensive de grande ampleur, bien préparée et réalisée sous le contrôle opérationnel d’un état-major turc. L’attaque a mobilisé plusieurs milliers de soldats azerbaïdjanais, mais aussi des supplétifs djihadistes syriens convoyés par la Turquie. L’Azerbaïdjan a aussi bénéficié d’une couverture aérienne assurée par des F16 turcs, mais aussi et surtout des fameux drones turcs Bayraktar face auxquels les unités arméniennes étaient largement sans défense. En dépit d’une résistance assez héroïque, les unités arméniennes – qu’elles soient d’Arménie ou d’Artsakh – ont été rapidement submergées face à des troupes plus nombreuses et bien mieux équipées. L’opinion générale des soldats arméniens était qu’ils se battaient contre une armée de l’OTAN.
Durant les combats, les populations et les infrastructures civiles du Karabagh ont été durement touchées, souvent de manière délibérée. Les quelque 150 000 habitants de l’Artsakh ont très largement fui en Arménie voisine, ne laissant au plus fort du conflit que 30 000 habitants dans le pays. Diverses tentatives de médiations ont échoué jusqu’à ce que le 9 novembre 2020, un accord de cessez-le-feu sous médiation russe mette un terme à cette guerre des 44 jours. Entretemps, les Arméniens avaient perdu la zone de sécurité qu’ils contrôlaient au sud du territoire artsakhiote proprement dit – zone frontalière de l’Iran – mais aussi les districts artsakhiotes d’Hadrout et de Chouchi, ce dernier éminemment symbolique ayant été lâché dans des circonstances obscures dans les dernières heures de la phase active du conflit. Au terme du cessez-le-feu, ils ont également dû abandonner les zones de sécurité d’Aghdam, à l’est du pays, et celle de Kelbadjar, à l’ouest, qui assuraient la continuité territoriale avec l’Arménie. Ne restait alors comme connexion entre les deux États arméniens que le « corridor de Latchine », sous contrôle des forces russes de maintien de la paix nouvellement, instauré par l’accord de cessez-le-feu [carte 9]. A l’issue du cessez-le-feu, la plupart des Artsakhiotes réfugiés en Arménie sont revenus dans la zone restée libre du pays. La population qui est remontée à 120 000 habitants y est confrontée à une importante crise du logement.

Carte 9 : La République d’Artsakh et les territoires occupés par l’Azerbaïdjan après la guerre de 2020[6].
L’Arménie affaiblie face au siège du Karabagh
Le traumatisme qui suit le conflit est évidemment immense, d’autant plus que l’Azerbaïdjan, enivré par ses succès militaires et rencontrant des condamnations diplomatiques très molles, n’entend pas en rester là. Début 2022, le régime de Bakou entreprend toute une série d’empiètements territoriaux sur le territoire arménien proprement dit dans l’objectif clair d’affaiblir un peu plus Erevan et surtout d’établir une continuité territoriale avec le Nakhitchevan via la province du Siounik, au sud de l’Arménie que Bakou désigne par son nom turcoman de Zanguezour. Enfin, à partir du 12 décembre 2022, l’Azerbaïdjan met en œuvre le blocus total du couloir de Latchine, qui reliait encore l’Arménie à l’Artsakh et qui était censé être sous contrôle exclusif des forces russes aux termes de l’accord de cessez-le-feu. Ce blocus est assorti du sabotage par Bakou des infrastructures de transport énergétique – gaz, électricité – qui place brutalement l’Artsakh dans une situation critique à tout point de vue. Ce qui est proprement stupéfiant est que ces menées sont conduites sans que cela ne provoque de réaction de Moscou dont la capacité ou la volonté de maintenir la paix est de plus en plus discutable.
Le pouvoir arménien, quant à lui totalement affaibli et dépourvu de tout allié fiable, tente désespérément de sauver ce qui peut l’être, à savoir l’intégrité territoriale de l’Arménie proprement dite dont Bakou occupe désormais 150 km2. A cet effet, Nikol Pachinian est désormais prêt à reconnaître que l’Artsakh fait partie intégrante de l’Azerbaïdjan, se contentant de plaider pour le respect par Bakou des droits socioculturels de la minorité arménienne. Un vœu pieux lorsqu’on sait que la dictature azerbaïdjanaise ne respecte pas même ceux de ses propres citoyens. Notons néanmoins que l’Arménie a entrepris un recours devant la Cour internationale de Justice. Le 22 février 2023, le Tribunal de la Haye a ainsi rendu une ordonnance demandant à ce que l’Azerbaïdjan cesse d’organiser et de soutenir les prétendues « protestations qui empêchent la circulation libre et ininterrompue le long du corridor de Latchine dans les deux sens ». Une ordonnance en théorie contraignante, mais qui est dans les faits restée sans effet dans l’indifférence de la communauté internationale.
Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l’Union européenne et dans une moindre mesure les Etats-Unis tentent de revenir dans le jeu diplomatique caucasien d’où ils avaient été exclus à la faveur de la collusion russo-azerbaïdjano-turque. Erevan et Bakou sont depuis lors engagés dans deux négociations parallèles, l’une sous l’égide de Moscou, l’autre sous l’égide de Bruxelles et parfois de Washington. Il faut peut-être souligner que, dans le cadre de cette compétition diplomatique, l’attitude de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie sont très différentes : si Aliev fort de ses victoires sur le terrain, affiche une constance et une grande assurance dans l’affirmation de ses positions, Pachinian fait montre d’une versatilité propre à dérouter tous les camps, y compris le sien. De fait, les positions inconstantes et inconsistantes du Premier ministre arménien sont de moins en moins soutenues par certains représentants de l’appareil d’État. Elles créent aussi un fort hiatus avec la diaspora qui se mobilise pour susciter un soutien à l’Arménie qui va désormais au-delà de ce que celle-ci ose demander. Si bien sûr l’avenir n’est jamais écrit, nombreux sont ceux qui commencent à penser que Nikol Pachinian, qui fait partie du problème, pourrait bien à terme ne plus faire partie de la solution.
[1] http://www.liranpourlesnuls.net/cartes/carte-les-khanats-independants-du-caucase-avant-le-xviiieme-s/
[2] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Western_Armenia_September_1917.png#/media/File:Western_Armenia_September_1917.png
[3] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lagekarte_Dschibal.jpg#/media/File:Lagekarte_Dschibal.jpg
[4] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_Nagorno-Karabakh.png#/media/Fichier:Location_Nagorno-Karabakh.png
[5] Cercle d’Amitié France-Artsakh (https://france-artsakh.fr/).
[6] Cercle d’Amitié France-Artsakh (https://france-artsakh.fr/).