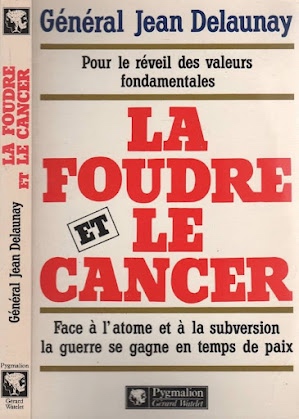En 1935, sous l’impulsion vigoureuse donnée par le général Weygand, cinq ans plus tôt, l’armée française mettait sur pied la 1re Division Légère Mécanique (D.L.M.) qui était en fait la première division blindée existant en Europe. On le sait peu !
Depuis cette date, plusieurs types de divisions ont été conçus, en national, la D.M.R. et les divisions « Lagarde » tandis que, à d’autre périodes, sous l’influence des États-Unis, et de l’OTAN, d’autres types de divisions ont vu le jour, au sein de l’armée de Terre, la division 59 puis la division 67, et enfin la « division de classe OTAN » actuelle. La question est donc posée : existe-t-il une culture militaire française en termes de définition de grandes unités et, dans quelle mesure diffère-t-elle de la culture américaine et otanienne en la matière ?
La réponse est absolument affirmative, il existe bien une culture militaire française à cet égard, culture fondée sur la souplesse à la fois de l’organisation du commandement et de la manœuvre. Cette culture s’oppose fondamentalement à la culture militaire américaine, fondée uniquement sur la masse des moyens.
Les caractéristiques des deux systèmes français et américains.
Quels sont les trois critères principaux respectifs des cultures militaires française et américaine en la matière ?
Tout d’abord, pour le cas français, la stricte adaptation des niveaux de commandement tactique à ceux de la manœuvre : En dessous du niveau tactico-stratégique ou tactico-opératif, constitué par l’Armée, il n’existe que trois niveaux — corps d’armée, division et régiment/groupement — correspondant aux trois niveaux de conception, conduite et exécution de la manœuvre interarmes. Dans le système français, depuis 1916, l’échelon de la brigade n’existe pas. La division constituant l’échelon de conduite de la manœuvre, les appuis qui lui sont alloués sont réduits aux seuls appuis directs, l’essentiel de ceux-ci étant regroupés au niveau du corps d’armée où ils constituent des « éléments organiques ».
Considérant que l’on ne manœuvre bien qu’avec quatre pions, le système français privilégiera toujours la quaternisation en termes d’organisation divisionnaire et régimentaire. Cette quaternisation permet également un mixage optimal des moyens (blindés et mécanisés) au sein des groupements.
Enfin, le système français s’efforce de toujours faire coïncider l’organisation organique sur le besoin opérationnel, ce qui permet de disposer d’une grande cohérence en terme de préparation opérationnelle (entraînement autrefois). Cette corrélation organique —opérationnel n’est aucunement exclusive de la possibilité de mixage des unités (par échanges entre régiments), pour former des groupements temporaires, mieux adaptés à la mission et au terrain. Ce principe n’a été respecté que jusqu’à l’adoption des principes de « modularité » et de « réservoir de forces » fondements de la « Refondation » de 1998.
Le système américain, pérennisé après 1942 lors du réarmement des États-Unis, prend l’exact contrepied de la position française. Il s’agit de divisions lourdes, d’ailleurs le terme de « heavy division » est passé dans le langage courant. Il existe un échelon de commandement de plus que dans le système français, la brigade, ou en 1942 combat command pour les divisions blindées et regimental combat team pour les divisions d’infanterie. Ce système de division lourde a perduré à l’issue de la guerre et s’est installé comme la norme dans l’OTAN. Il a fait dire au critique militaire Liddell Hart, que les divisions alliées correspondaient à un énorme serpent qui se mouvait plus qu’il ne manœuvrait, et dont seuls la tête et le dard piquaient. Dans cette organisation, la structure divisionnaire est ternaire, ainsi que celle de la brigade. Quant aux appuis, ils existent sous une forme redondante, aux deux niveaux de la division et du corps d’armée.
Durant la Guerre froide, il existait également en Centre Europe, une différence majeure entre les deux systèmes, concernant la mise en œuvre[1] du feu nucléaire « tactique ». Du côté des États-Unis, c’était la division qui en était chargée, alors que dans le système français (le PLUTON n’est apparu qu’en 1975), il s’agissait du corps d’armée. C’est également une des raisons qui ont conduit les Américains à constituer un système divisionnaire « lourd ». Et, c’est donc tout naturellement que, dans le système français, les régiments PLUTON ont rejoint les EOCA, en étant intégrés à l’Artillerie de CA.
De la DLM à la DMR.
La D.L.M., imparfaite avec ses deux régiments de chars, son régiment de découverte et son régiment de Dragons portés (en fait une infanterie portée à trois bataillons), répondait aux canons d’organisation français. Il est d’ailleurs significatif que le regroupement de deux d’entre elles, en un « corps de cavalerie » en 1939-1940, a constitué le seul corps d’armée blindé dont n’ait jamais disposé l’armée française. Cette simple remarque est de nature à fortement nuancer le regard généralement porté sur le concept blindé français de 1940. Qui plus est, il était prévu, qu’en opérations, le régiment de dragons portés éclatât et fût réparti au sein des régiments de chars et du régiment de découverte pour former groupements. À ce double titre, la D.L.M. était la première division moderne française. Elle a disparu dans la tourmente de 1940.
Son concept a été repris en 1954 avec la 7e D.M.R. (Division Mécanique Rapide). À cette époque, le maréchal Juin commandait le théâtre Centre-Europe de l’OTAN (AFCENT). Il était fortement conscient que les divisions lourdes de « classe OTAN » étaient tout à fait impropres à conduire le combat « tournoyant » qui était attendu d’elles : en effet, en ambiance nucléaire (c’est-à-dire sous menace d’emploi), il s’agissait, dans des délais les plus brefs possibles, de passer d’un dispositif ouvert et réparti sur le théâtre, pour éviter de constituer un « pion nucléaire » justiciable d’une frappe soviétique, en un dispositif concentré et puissant pour frapper a contrario les « pions nucléaires » dévoilés par le dispositif adverse. Comme Juin était simultanément, la plus haute personnalité militaire française (même s’il avait perdu les attributions de CEMDN, grosso modo CEMA en 1953), il a chargé les inspecteurs de l’infanterie et de l’arme blindée cavalerie[2] de concevoir deux types de division. Ce seront la 7e D.M.R. et la 2e D.I.M. (division d’infanterie mécanisée). La D.M.R., particulièrement légère et toute en souplesse, était articulée autour de quatre « régiments interarmes » constitués de deux compagnies sur half-tracks et de deux escadrons des AMX 13 et une batterie de 105 automoteurs. Un régiment de reconnaissance sur E.B.R. (engin blindé de reconnaissance) est conservé aux ordres, au niveau de la division[3]. Les échelons de la brigade et du bataillon avaient disparu. Tous les canons de l’école française étaient réunis. Quant à la 2e D.I.M., elle est organisée en cinq régiments d’infanterie à 4 compagnies sur half-tracks ou Bren carrier et un escadron Shaffee[4]. Dans ce cas également, les échelons de la brigade et des bataillons ont disparu. Ces deux divisions ont rapidement perdu leurs spécificités puisqu’elles ont été engagées en Algérie où leurs régiments ont été alignés sur l’organisation des unités de quadrillage (la 7e D.M.R. ayant fait un détour par Suez).
Les divisions 59 et 67.
Avant le désengagement d’Algérie, l’armée française avait conçu un nouveau type de Grande Unité, la division 59, sur des critères otaniens (La France était toujours membre des instances de commandement intégrées). À ce titre, les États Unis mettaient à disposition de la France un armement nucléaire « tactique », le lanceur Honest John, dont la mise en œuvre serait effectuée selon le principe de la « double clé », au niveau de la division. Il ne pouvait donc s’agir que d’une division « lourde », à base de trois brigades, et disposant d’éléments organiques variés et puissants.
En réalité, cette division constituait un compromis boiteux entre le tactiquement souhaitable et le budgétairement possible. Les brigades et les régiments étaient articulées autour d’une structure ternaire, et, au moins pour les brigades motorisées, mixaient des régiments de pied absolument différents (régiments motorisés à deux bataillons curieusement rebaptisés E.M.T., et mécanisés ou de chars à 3 compagnies ou escadrons). En outre, le matériel était trop disparate, puisque des camionnettes tactiques y côtoyaient des engins blindés à chenille (VTT/AMX et AMX 13). Cette disparité conduisait à mettre sur pied une multitude de groupements et sous-groupements, sans cesse réarticulés en fonction du milieu et de l’ennemi, ce qui conduisait à un rythme de manœuvre beaucoup trop séquencé.
Des études furent lancées dès le désengagement d’Algérie (Études DAVOUT et MASSENA) pour corriger ces défauts. Elles aboutirent à la constitution de la Division 67, laquelle, conçue alors que la France était toujours membre des structures intégrées de l’OTAN, était encore une division lourde, mais aux structures plus cohérentes que sa devancière. Néanmoins, des impératifs budgétaires ont conduit à maintenir temporairement (mais le temporaire a souvent tendance à durer) au sein de chacune des cinq divisions ainsi constituées deux brigades mécanisées et une brigade motorisée. Enfin, les divisions, comme les brigades ont été bâties sur une structure ternaire (toujours pour des motifs d’économie).
Il convient de noter que la division d’intervention (la 11e division) était construite selon les mêmes errements ; une structure ternaire de brigade avec deux brigades parachutistes et une brigade légère (la 9e brigade).
Les « divisions Lagarde ».
Dans son œuvre magistrale de réorganisation, le général Lagarde a voulu revenir, aussi bien pour le corps de bataille que pour les forces d’intervention, aux canons de la culture militaire française : à partir des 5 divisions « lourdes » et de la division d’intervention, soit 18 brigades, ternaires il a mis sur pied 15 divisions quaternaires, soit 8 divisions blindées[5], 5 divisions d’infanterie[6], et 2 divisions d’intervention[7]. Le corps de bataille était réparti en 3 corps d’armée, dotés d’éléments organiques puissants, et constituant à leur échelon la cohérence tactico-logistique, grâce à la création de 3 brigades logistiques. (les divisions disposaient quant à elles, d’un « volant logistique » sous la forme d’une base divisionnaire déployée à partir d’un régiment de commandement et de soutien). Cette réforme complète et profonde des forces était marquée d’une rare cohérence. Toutes les divisions et tous les régiments de mêlée étaient bâtis sur une structure quaternaire. Pour trouver la ressource indispensable à une telle réforme en profondeur, le général Lagarde a dissous tous les régiments de D.O.T. (en fait, des bataillons à trois compagnies en sous-effectifs, noyaux actifs des véritables régiments de D.O.T.) en en conservant quelques-uns pour les divisions d’infanterie. Seul le 41e RI, en sureffectif à la 9e DIMa a conservé une mission de D.O.T., de protection des installations terrestres de la F.O.S.T. en Bretagne.
Pour conserver la D.O.T., chaque régiment métropolitain d’active dérivait un régiment de réserve. Ceux-ci étaient employés à deux niveaux hiérarchiques : au niveau de la D.M.T. pour les missions statiques de protection de points sensibles d’importance, soit regroupés au sein de brigades de zone, au niveau de la Région militaire — Zone de défense pour des mission de défense de surface, en action d’ensemble.
Cette réforme a été conduite en trois ans, selon un principe de complète décentralisation : en 1976, le général Lagarde en a énoncé les principes et défini les structures à réaliser. Ensuite, chaque année, de 1977 à 1979, chaque commandant de corps d’armée concerné a conduit lui-même la réorganisation de ses moyens et le fusionnement du commandement opérationnel (CA – Divisions) au commandement territorial (Région – Division militaire territoriale[8]). C’est ainsi que, le 1er juillet 1979, ce qui avait été annoncé et planifié le 1er juillet 1976 était réalisé. Chaque année, la mise sur pied à l’été du corps d’armée concerné était suivie à l’automne, d’un exercice en terrain libre sur une profondeur de 300 kilomètres, et mettant en jeu de l’ordre de 800 blindés dont 400 chars et 180 hélicoptères.
Enfin, en liaison avec la mission militaire française présente à Brunssum à AFCENT, la 1re Armée a conduit un long et profond travail de planification pour adapter l’engagement des nouveaux corps d’armée aux différentes hypothèses d’engagement alliées[9], ce qui a abouti à la diffusion d’un Plan Général d’opérations (P.G.O.) à l’intention des CA. Il est à noter que la différence de structures et de taille entre les grandes unités alliées et françaises n’a jamais nui à leur interopérabilité.
Mais, il ne faut pas se voiler la face, il existait une ombre au tableau, l’équipement des forces. Si les unités de l’ABC avaient connu un plan d’équipement de ses régiments en AMX 30 extrêmement rapide, la totalité de ses régiments avait été équipée en moins de quatre ans (1967–1971), il n’en allait pas de même pour les autres programmes. L’AMX 10 P, l’AMX 10 RC, le VAB, les Canons de 155 AUF 1 et TR F 1 allaient demander quasiment une décennie pour équiper les forces, qui, jusqu’à cette échéance devaient continuer à servir des matériels anciens, des VTT AMX, des EBR, des canons automouvants, et, comme les régiments motorisés avaient été créés ex nihilo, dans l’attente du VAB, certains (la 14e DI) allaient être équipés de Dodge 6×6 comme matériels de substitution durant de longues années.
En outre, les cibles de ces nouveaux matériels majeurs avaient été définies en deçà des besoins correspondant aux effectifs alloués. Une réduction d’effectifs était donc inévitable à moyen terme.
Celle-ci intervint en 1983, de façon parallèle avec la création de la FAR. Les deux divisions nouvellement créées, la 6e DLB et la 4e DAM, l’ont été à partir des 6e et 4e DB, dissoutes. Les autres divisions ont été un peu renforcées par l’ajout d’un second régiment d’artillerie et d’un régiment motorisé. Ces mesures ont conduit à la dissolution de deux divisions d’infanterie et leur transformation en « divisions École », à partir des formations dédiées implantées en leur sein. Ces modifications n’ont pas altéré la logique d’organisation des différentes divisions, qui est demeurée conforme aux principes nationaux.
La refondation de 1998. La disparition des divisions permanentes.
En revanche, la « refondation » de 1998 constitua une remise en cause complète et profonde de la logique d’organisation des forces terrestres. Tous les principes d’organisation des grandes unités, liés à la culture militaire nationale ont disparu.
La cohérence entre l’organique et l’opérationnel a complètement disparu, la logique relevant alors de celle de la « modularité » des forces, l’organique étant réduit un simple « réservoir de forces ».
S’agissant des niveaux de commandement, ils ont été réduits, pour ce qui concerne les niveaux permanents, à deux, la brigade et le régiment/groupement. La division permanente a disparu, pour la première fois depuis 1788. Elle a été remplacée à la demande, par quatre EMF (états-majors sans moyens dédiés[10]) qui, regroupés par deux, pouvaient alors constituer un PC de division. Il s’agissait alors, à l’occasion des grands exercices, de mettre sur pied une division « de classe OTAN », soit le retour à une division lourde.
Quant au niveau du corps d’armée, il a été fusionné avec le « Commandement de la Force d’action terrestre » (CFAT) avant d’être rétabli en 2007 sous la forme d’un PC de CA, certifié aux normes OTAN. Avec le rétablissement des divisions permanentes en 2015, l’armée de Terre a donc renoué avec un système de commandement complet, à quatre niveaux depuis le corps d’armée jusqu’au groupement/régiment.
Enfin, la cohérence tactico-logistique était fortement obérée par le fait que la brigade, pion de manœuvre, ne constituait-il pas un échelon logistique.
« And so what ? »
Sous l’influence de l’OTAN dont elle a rejoint les structures de commandement intégrées, la France a donc renoué avec un alignement de ses structures de commandement sur celles de l’Alliance, en tournant ostensiblement le dos à sa culture militaire propre ; ceci, au nom du respect d’une indispensable interopérabilité avec nos Alliés. La question se pose donc de savoir si cette interopérabilité est réellement incompatible avec d’autres structures que celles ayant cours aux États-Unis. Il semblerait que la réponse soit négative, puisqu’à l’époque où la France disposait d’un corps de bataille dont les divisions avaient été bâties sur des critères nationaux, les divisions Lagarde, l’interopérabilité des trois corps d’armée français avec les corps alliés dont les divisions avaient une toute autre dimension, n’a posé aucun souci.
La question est donc posée : à l’heure où l’armée de Terre va connaître la transformation actuellement en cours, ne faut-il pas réfléchir à la structure de nos grandes unités, et s’extraire d’une stricte logique de ressources pour les constituer, pour, a contrario, imaginer quel pourrait être leur emploi et, partant, définir leurs structures. Autrement dit, raisonner de manière cohérente : partir de la finalité pour définir les modalités, et non l’inverse.
NOTES :
- Uniquement la mise en œuvre, en aucun cas la décision d’emploi, du niveau politique.
- Les généraux de Linarès et de La Villéon.
- 4 régiments interarmes : 2e Dragons, régiment Colonial de Chasseurs de Chars (RCCC), 1er RBIC (Régiment Blindé d’Infanterie Coloniale) et 21e R.I.C (Régiment d’Infanterie Coloniale). Rgt de Reconnaissance : 3e R.C.A. (Régiment de Chasseurs d’Afrique).
- 26e R.I., 60e R.I., 151e R.I., 152e R.I., 153e R.I. et le 31e Dragons.
- Les 1re DB (Trèves), 2e DB (Versailles), 3e DB (Fribourg), 4e DB (Nancy), 5e DB (Landau), 6e DB (Strasbourg), 7e DB (Besançon) 10e DB (Châlons sur Marne).
- 8e DI (Amiens), 12e DI (Rouen), 14e DI (Lyon), 15e DI (Limoges) et 27e DIA (Grenoble).
- 9e DIMa (Saint Malo) et 11e DP (Toulouse).
- 1977 : 6e RM- 1er CA à Metz. . 1978 : CCFFA – 2e CA à Baden Oos. 1979 : 1re RM – 3e CA).à Paris et Saint Germain les Loges.
- Depuis la signature des accords Valentin – Ferber, en 1972, la 1re Armée était la seule réserve de théâtre d’AFCENT, et se trouvait engagée comme telle, même si la France ne faisait plus partie des instances de commandement intégrées de l’OTAN.
- Participant à tous les grands exercices nationaux et alliés, ces EMF ont néanmoins emmagasiné une solide culture opérationnelle.