La guerre des Malouines (1982) permet de tirer de nombreux enseignements pour l’armée française aujourd’hui. Que ce soit la communication internationale, le rapport au droit et à la politique et le mode opératoire, c’est un conflit à mieux comprendre pour percevoir les enjeux contemporains.
par Swan Dubois Galabrun, Lilian Tassin, Augustin Fille. Officiers de l’armée de Terre.
Faire de la guerre des Malouines un cas d’école pour la France n’est désormais plus une prise de risque intellectuelle tant les occurrences montrant l’intérêt de cette guerre pour la réflexion française ne manquent pas : les officiers de Marine Corman et Lavernhe exposant la fin du HMS Sheffield dans Vaincre en Mer au XXIe siècle, le député Yannick Chenevard, invoquant l’exemple britannique pour attirer l’attention sur l’intérêt d’une flotte stratégique[1]. La comparaison de l’amiral Vandier dans Mer et Marine en 2021, érige l’événement en un type de guerre déclinable auquel la France serait confrontée. Pourtant, els sont les points communs, mais aussi les divergences afin d’en tirer les justes leçons. Cette analyse est complexe puisque son intérêt n’est pas l’exhaustivité historique ou géopolitique, mais plutôt de dresser une comparaison générale. Cette entreprise possède un fort ancrage historique, mais elle se veut surtout dialectique dans sa capacité à se détacher de l’histoire et de l’actualité.
Situation avant la crise
En 1982, dans un contexte de guerre froide, l’ennemi est à l’Est et le Royaume-Uni ne conçoit une action militaire que dans le cadre de l’OTAN avec comme partenaire minimal les États-Unis. Le temps est à l’austérité et aux coupes budgétaires, dont l’une des premières cibles est les forces armées. Face à l’ennemi soviétique, une flotte de surface solide, principalement anti-sous-marine, semble largement suffisante. Les bâtiments sont conçus et les équipages formés principalement à la lutte contre les submersibles, puis au combat de surface ou anti-aérien, alors que les missions d’appui à un débarquement ou de frappes de cibles terrestres passent largement au second plan.
Sur le plan aéronaval, les porte-avions britanniques sont jugés trop coûteux et inutiles, l’allié américain étant censé fournir l’appui aéronaval dans le cas d’une opération de projection de forces en dehors de l’Europe. Il est décidé que le vieux HMS Hermes, après avoir été proposé à la vente à l’Australie, ne sera pas modernisé et amené vers la retraite, alors que l’Invincible, censé lui succéder, n’est sauvé qu’au prix de la conversion, sur le papier, en porte-aéronefs de lutte anti-sous-marine, et de la vente de la tête de classe à l’Australie. Enfin, les deux navires amphibies de la classe Fearless ne sont plus en mesure de prendre la mer. Dans le paysage institutionnel, seul l’amiral Leach, First Sea Lord, plaide activement pour le maintien d’une capacité à projeter durablement une force conséquente : si son action ne rencontre qu’un succès modéré pour les unités de surface, elle permet au moins de maintenir un volume de force respectable pour les Royal Marines, regroupés au sein de la 3e Commando Brigade. La capacité de combat amphibie qu’ils représentent a été sauvée en l’attribuant à une seule unité, bénéficiant de l’ensemble des moyens nécessaires et des infrastructures d’entraînement. Une comparaison avec la France ne serait pas forcément indiquée puisque cette capacité est répartie entre la 6e Brigade Légère Blindée, la 9e Brigade d’infanterie de Marine, les fusiliers marins et les commandos marine de sorte que la culture amphibie n’est pas le seul pré carré de la marine.
La question capacitaire au cœur de la crise
L’ordre de bataille réduit de la Royal Navy conduit les responsables politiques à n’envisager que des réponses limitées. Lorsque le 20 mars, Margareth Thatcher demande au Foreign Office un mémorandum intitulé Options in the South Atlantic, la partie rédigée par John Nott[2] sur les possibilités d’actions en matière de défense illustre les faibles capacités d’action de la Navy : la seule option considérée sérieusement est l’envoi de Marines tandis que les possibilités d’envoyer des sous-marins ou de mettre sur pied une Task Force sont à peine évoquées.
Pourtant, dès le 29 mars, Margareth Thatcher fera le choix de dépêcher sur place, depuis la Méditerranée, un sous-marin nucléaire d’attaque et un navire ravitailleur puis de faire appareiller un second sous-marin d’Écosse. C’est à ce moment qu’entre en scène l’un des acteurs clefs de la victoire britannique : la Royal Fleet Auxiliary. Cinquième branche de la Navy, la RFA sert depuis 1905 au ravitaillement et aux liaisons entre la Grande-Bretagne et ses dominions, mais aussi au ravitaillement des navires engagés dans des opérations militaires. Cette flotte auxiliaire au statut civilo-militaire permet d’externaliser partiellement les coûts de maintien en condition des navires et de formation de l’équipage, tout en disposant d’une flotte de transport et de ravitaillement sous commandement militaire en temps de crise. C’est aussi elle qui met en place la réquisition des navires de la Merchant Navy, détachant à bord des navires réquisitionnés des officiers spécialistes, dans le cadre du STUFT System[3]. Dès le déclenchement du conflit, un navire de la RFA sera donc en chemin pour les Malouines, premier élément d’une chaîne logistique qui tiendra tout le long de l’engagement britannique.
Lors de la réunion de crise du 30 avril, Sir Leach, seul militaire présent en l’absence de ses supérieurs, insista sur la nécessité de mettre sur pied une flottille complète, couvrant l’ensemble du spectre des menaces, et soutenue par un appareil logistique conséquent.
La constitution de la Task Force s’articula autour de trois types de navires : ceux de combat, de ravitaillement et de transport. Les bâtiments de combat sont dans un premier temps prélevés sur la masse des navires à la mer dont dispose la Royal Navy. Mais très vite, les navires disponibles paraissent insuffisants par rapport aux besoins. Au prix d’un effort remarquable de la part des chantiers navals britanniques, les jumeaux de la classe Fearless sont modernisés et remis en état en un temps record, réussissant ainsi à compenser en quelques semaines des années de sous-investissement. Le HMS Invincible, pourtant annoncé comme vendu à l’Australie par le ministère de la Défense, va en trois jours être équipé pour le combat. Dans les deux cas, les chantiers navals et les équipes de maintenance ont travaillé main dans la main, sous très court préavis, pour des résultats excellents, fruit d’une tradition de coopération civilo-militaire ancienne et entretenue.
Les navires de ravitaillement sont fournis par la RFA, c’est d’ailleurs principalement l’indisponibilité de ceux-ci, bien plus que des navires de lignes, qui compromet partiellement la capacité de la Navy à honorer ses engagements auprès de ses alliés, soulignant leur importance dans le fonctionnement d’une marine au rayonnement mondial. Fort de cet enseignement, la RFA maintient toujours en conditions opérationnelles sept navires ravitailleurs de flotte de trois classes différentes. La Marine Nationale, de son côté, ne dispose que de quatre Bâtiments Ravitailleurs de Flotte de la classe Jacques Chevallier, soit moitié moins que ceux employés dans la Task Force britannique.
Les navires de transport militaires disponibles étant très insuffisants, il est envisagé dès la mise sur pied de la Task Force d’employer des navires civils de la Merchant Navy pour réaliser l’acheminement des troupes nécessaires. C’est ainsi que le SS Canberra acheminera la quasi-totalité du 42 Commando, et que le paquebot Queen Elizabeth 2 servira au transport de la 5e Brigade d’Infanterie. Face aux besoins pressants d’aéronefs supplémentaires, c’est d’ailleurs un porte-conteneurs civil, l’Atlantic Conveyor, qui va être réaménagé afin d’accueillir vingt-cinq appareils. Illustration de la prise de conscience britannique de l’importance de disposer d’au moins deux porte-avions, l’un pour défendre la Task Force et l’autre pour appuyer les opérations à terre. Ce questionnement est largement d’actualité au sein de la Marine Nationale, dans le cadre du programme PANG, qui a été tranché en faveur d’une seule unité de la nouvelle classe, laissant la classe Mistral comme seul élément d’appui aéronaval complémentaire.
Les Britanniques n’hésitent donc pas à agréger des navires civils, parfois employés de manière originale en s’appuyant sur une structure préexistante, à des navires militaires pour combler les trous capacitaires béants dont souffrait la Royal Navy. La démarche de création d’un tel outil en France date de 2016, avec l’article 58 de la Loi pour l’économie bleue, et inscrite dans le Code de la Défense [article L1355-4]. Cependant, si le CESM a souligné la faiblesse des structures et des moyens de ce type à la disposition de la France, les assises de la mer le 19 novembre dernier ont donné un nouvel élan à la réalisation de cette ambition[4].
Une opération amphibie pour la reconquête
L’opération amphibie à proprement parler, n’a été rendue possible que par la très faible résistance argentine sur les lieux du débarquement. Lorsque dans la nuit du 21 au 22 mai la 3 Commando Brigade, précédées d’éléments de reconnaissance du SBS[5] , prend pieds sur le rivage de la baie de San Carlos, suivie des premiers éléments du Parachute Regiment, ses pertes sont négligeables, et seuls deux aéronefs anglais sont abattus. Cela s’explique par la faible présence argentine, mais aussi par la décision quasi immédiate des Argentins de quitter les lieux du débarquement pour établir des défenses plus en profondeur dans l’île, moins exposée aux appuis feux navals directs des navires britanniques.
Ce très faible coût du débarquement britannique est la conséquence d’une série de choix, justifiés par les caractéristiques très originales du territoire à reconquérir. Le commandement britannique a choisi de débarquer loin des objectifs principaux, préférant exposer ses troupes lors de l’approche de l’objectif plutôt que sur la phase de débarquement. Cela a permis de tomber sur des défenses argentines très réduites, sans que les ennemis puissent exploiter la profondeur de leur défense. De plus, le choix de débarquer de nuit a permis de repousser au maximum l’heure de perte de surprise et de débarquer un maximum de personnels avant l’attaque aérienne argentine. Cependant, l’absence d’aérodrome permettant la mise en œuvre d’avions de combat sur l’archipel contraint les Argentins à attaquer depuis le continent, où s’est réfugié le porte-avions Veinticinco de Mayo. Cette contrainte permet aux Britanniques d’espérer mettre en place une bulle A2AD[6] solide sinon hermétique, pour protéger les mises à terre des renforts et de l’échelon de soutien de l’opération à terre.
La réussite du débarquement britannique aux Malouines repose donc avant tout sur l’exploitation à fond de leur supériorité navale locale, rendant toute résistance argentine sur le point de débarquement illusoire. Mais aussi sur le choix de ne pas chercher une action précipitée, de se fondre dans le tempo de la guerre en cours, et d’accepter de construire une victoire sur la durée, en débarquant loin des objectifs à haute valeur politique, de manière à transformer la supériorité navale britannique en une supériorité terrestre, fondée sur la qualité, mais aussi sur le nombre et la résilience de la force débarquée. La persistance d’une structure civilo-militaire britannique permettant la projection de force et les choix opérationnels courageux traduisent une volonté politique de mener et de gagner la guerre.
Le politique doit composer avec l’opinion britannique
À l’hiver 1982, le gouvernement Thatcher était au plus bas dans l’opinion publique. La culture britannique de l’Empire, par-delà les mers, explique que la perte initiale des îles n’ait pas été ignorée, mais ait soulevé de vives critiques et une forme de honte de s’être laissé ainsi prendre. Thatcher, en décidant d’accepter l’épreuve de force avec les Argentins, a donc été largement soutenue par une population mue davantage par l’envie de reprendre les îles que par la détestation de son gouvernement. On relève peu d’oppositions à la guerre, soit des oppositions de principe peu construites contre la guerre en général, soit émanant d’acteurs qui préféreraient la négociation. Elles sont dans tous les cas peu homogènes et marginales. Au cours du conflit, la relation avec les médias incarne dans une certaine mesure le jeu du cabinet avec sa crainte de voir un retournement de l’opinion publique : la diffusion de l’information quant à la perte du Sheffield va soigneusement être préparée et diluée dans le temps afin de ne pas créer un coup de communication susceptible d’embraser les passions. Les photos montrant des cadavres, notamment ceux de soldats britanniques, sont contrôlées, voire interdites. Si certains journalistes se sont plaints, on a surtout vu une franche coopération avec les militaires[7].
Le poids de la culture stratégique aux sources des choix politiques
Le paradigme continental de la France la porte vers la mer, en dépit d’une grande tradition et d’aménités incontestables qui font d’elle une nation maritime. Les affaires d’outre-mer et les guerres coloniales n’ont jamais suscité l’enthousiasme profond des Français, elles ont même provoqué leur ire lorsque le contingent est envoyé, ce que les Britanniques n’ont jamais fait en créant un modèle d’armée professionnelle à but expéditionnaire. La population ne comprendrait sans doute pas l’acharnement à guerroyer pour ces territoires lointains s’ils étaient envahis, quand déjà en temps de paix, on souligne qu’ils sont coûteux et hétérogènes par rapport à la métropole. À l’inverse, rien n’interdit d’imaginer qu’en cas de conflit limité et d’envoi de professionnels, une large part de la population, si son patriotisme est éveillé, pourrait soutenir une telle entreprise par fierté nationale. Éveil qui doit autant à la culture qu’à la participation des vecteurs d’expression et d’influence que sont les médias. Suivant la trinité clausewitzienne, c’est eux qui représentent le plus la population en portant l’opinion publique. Les considérer comme des ennemis et non comme des alliés dans un même but serait donc une mécompréhension certaine. Même si la naissance des réseaux sociaux et d’internet limite la comparaison entre nos deux époques, l’adhésion de la population reste suspendue aux médias et à leur volonté de soutenir le projet. Soulignons alors la nécessité que les journalistes soient sensibilisés à ces enjeux pour mieux éclairer l’opinion publique tout en portant sa voix.
La tension existant d’ailleurs entre le politique et la population à travers la pression que l’opinion publique exerce du second sur le premier, met en lumière le jeu existant en démocratie pour les cabinets entre l’impératif de se maintenir et celui de diriger le pays. Les deux ne sont pas contradictoires puisque l’envoi immédiat de la flotte a répondu à un souci de maintien pour Thatcher comme à des enjeux de grande stratégie de la Grande-Bretagne. La France fait face à des enjeux similaires : en dépit de mécompréhensions marginales, on observe au parlement un consensus global sur les thématiques de défense par un effort des parlementaires pour aider les militaires en donnant une voix politique à leurs demandes. Pas de clivage comme on s’y attendrait, mais un travail commun, car fondé sur des éléments tangibles incontestables : Malouines, comme Éparses par exemple, présentent des ressources du sol et de la mer, et des points d’appui sur les routes commerciales en cas de fermeture de canaux comme Panama et Suez. Les événements en mer Rouge à l’hiver 2024 ont d’ailleurs renvoyé ces hypothèses du monde de la fiction à celui de la réalité. Ressources, positions stratégiques, diversité de populations et de cultures constituent une profondeur stratégique pour la France comme pour le Royaume-Uni. Ce sont autant d’atouts qui font d’elles des puissances, et symbolisent leur rang de Grande Nation. Leur perte est à la fois celle des constituants réels de la puissance, mais aussi de son symbole. La possession de ces terres est d’ailleurs consacrée par la sanctuarisation de la dissuasion même si l’absence de continuité physique avec la métropole crée des opportunités de contestation sous le seuil du conflit. L’importance est dissymétrique dans les opinions entre ces territoires et la métropole, de sorte que le vecteur nucléaire est disproportionné. Les Anglais l’ont envisagé sans l’utiliser pour cette raison, même si leur doctrine diffère. Considérant l’arme atomique dans une architecture plus vaste de défense, la riposte, même par des moyens conventionnels, est nécessaire pour conserver la crédibilité.
Au cœur de la conduite de la guerre, la culture du commandement et sa relation au politique est facteur de succès
Cette question de la pertinence du vecteur employé selon la crise relève du dialogue entre politique et militaire, qui commence dès le 2 avril au matin, quand l’amiral Sir Leach propose d’envoyer la flotte de Woodward, sachant à la fois qu’il faut réagir au plus vite, mais aussi qu’il obtiendra en cas de succès la fin des coupes budgétaires. Pour la durée du conflit, Downing Street dialogue avec l’état-major situé non pas à Whitehall, mais à Northwood, à 30 km, et dirigé par l’amiral Fieldhouse, afin d’éviter les interférences. La Grande Bretagne possède un atout culturel puisque les grands généraux britanniques, rompus à ce genre de guerres, ont la réputation d’avoir une très fine compréhension de leur milieu politique. Le haut commandement jouit d’une certaine autonomie grâce à la confiance du politique, en dépit de quelques interférences réelles, où le cabinet rappelle son existence de façon très insistante auprès des commandants de terrain en raison de son besoin de résultats afin de ne pas avoir à négocier en position de faiblesse. Les Français jouissent de structures de commandement tout aussi adaptées à ce genre d’opérations grâce à une longue expérience dans le domaine, même si ces guerres avaient lieu contre des adversaires asymétriques. L’invasion d’un territoire d’outre-mer marquerait un défi plus élevé pour ces structures qui devraient affronter un ennemi de même envergure. Cette question de l’ennemi renvoie à celle du contexte international puisque c’est ce dernier qui va conditionner les forces en présence pour l’affrontement.
L’ONU, un acteur incontournable
La Guerre des Malouines est riche d’enseignements si on analyse le comportement de chacun de ses acteurs. D’abord, il faut mentionner l’ONU, puisqu’elle est l’institution incontournable en cas de contentieux entre deux pays. Il est un préjugé tenace selon lequel cette dernière est une organisation qui génère des résolutions stériles n’améliorant jamais la situation. Pourtant, Anthony Parsons, représentant le Royaume-Uni à l’ONU durant le conflit, explique le contraire[8] : selon lui, il était essentiel de gagner à New York avant de gagner aux Malouines. En tant que nation membre du bloc de l’ouest, les Anglais étaient attachés à faire valoir leurs droits statués dans l’article 51 de la Charte onusienne autorisant la légitime défense. Face aux Argentins qui semblaient sûrs d’eux grâce au narratif qu’ils avançaient, autrement dit une nation non alignée qui reprenait son territoire légitime à une nation impérialiste, les Anglais ont réussi à faire voter une résolution adoptée par la grande majorité du conseil du moment[9].
Pour les Argentins, le plan était de faire durer la guerre, en montrant qu’ils étaient les prétendues victimes d’une nation coloniale, et non les agresseurs. Les tractations infinies à New York devaient épuiser le Royaume-Uni qui aurait dû composer avec une opinion internationale et intérieure hostile. Au lieu de cela, les Anglais ont fait adopter la résolution légitimant leur réponse militaire, en brisant deux mythes. Le premier est que l’Occident, et plus particulièrement les ex-puissances coloniales, n’était pas seul à croire au droit international face à un tiers-monde prétendument obsédé par la décolonisation. Le deuxième concerne l’ONU. Parsons y souligne la qualité des débats malgré le préjugé d’impuissance de l’institution, ceux-ci étaient écoutés avec attention par la communauté diplomatique internationale. Il conclut en qualifiant la victoire à New York « d’essentielle» pour la Royal Navy en route pour l’Atlantique Sud. Et ce serait sans oublier le prestige obtenu qui a permis de rassurer les alliés du Royaume comme impressionner ses rivaux.
Il est évident de mentionner que la France ne saurait se passer de l’ONU et d’une résolution. Néanmoins, force est de constater que cette institution n’a jamais été aussi peu écoutée. De plus, les Malouines se considéraient anglaises à 98%, affaiblissant le narratif argentin. Un sondage mettant en difficulté la France dans un de ses territoires ultra-marins fragiliserait au contraire sa posture aux Nations-Unies. La question du sentiment d’appartenance à la métropole semble alors cruciale aux yeux de l’ONU dans ses arbitrages. Sommes-nous donc sûrs, à moyenne échéance comme dans le long terme, d’être capables de maintenir ce sentiment au vu des troubles sociaux actuels dans nos outre-mer ?
Le poids des grands compétiteurs
Ensuite, cette guerre ne saurait être abordée sans évoquer le rôle des superpuissances de l’époque. Dans ce monde bipolaire, les Anglais ont habilement manœuvré en raccordant les Américains à leurs côtés, tout en impressionnant les Soviétiques avec un show of force habile en pleine reprise de la Guerre froide avec le mandat Reagan.
Pour les Falklands, les États-Unis ont sacrifié leur politique sud-américaine afin de conserver l’intégrité du bloc occidental face à l’URSS. À ce titre, le sénateur du Delaware en 1982, Joe Biden[10], déclare que les États-Unis soutiendront leur allié, au prix du traité de Rio signé en 1947 avec l’Amérique du Sud qui constituait la clé de voûte de leur stratégie régionale. Les Américains fournissent ainsi un appui économique, logistique, et militaire par le biais de renseignements offerts aux Anglais, mais s’aliènent une bonne partie du continent par la même occasion en trahissant leurs engagements.
À l’heure du pivot vers l’Asie de l’administration américaine, et de l’élection de Trump, il faut rappeler qu’un soutien étasunien n’est jamais désintéressé. Les conséquences d’un déclin français dans l’Indo-Pacifique seraient dommageables et enverraient un signal clair aux Chinois qui lorgnent sur Taïwan. En somme, les Américains n’ont aucun intérêt à ce qu’une des rares puissances otaniennes en mesure de projeter de la puissance dans la région soit fragilisée.
Quant à l’URSS, son implication dans le conflit est restée marginale. Les Soviétiques furent très impressionnés par la capacité de la Grande-Bretagne à projeter sa puissance à des milliers de kilomètres, impression à rapprocher de la fascination des Russes pour le domaine naval depuis des siècles[11]. La superpuissance de l’époque en vint même à questionner sa relation avec son plus grand « allié », la Pologne, qu’elle venait de placer sous loi martiale à cause de la gronde générée par le syndicat Solidarność. La « relation spéciale » entre le Royaume-Uni et les États-Unis renforça donc la dissuasion otanienne et fut utile à la reprise de la guerre froide sous Reagan.
Le signalement stratégique n’est donc pas un concept stérile. En s’affirmant auprès de ses alliés, notamment par la conduite d’exercices impliquant l’arme nucléaire, la France participe également à démontrer sa force auprès de ses compétiteurs. L’opération Serval a par exemple suscité un certain émoi outre-Atlantique, les Américains y reconnaissant un savoir-faire expéditionnaire unique[12]. Autrement dit, il ne faut pas sous-estimer l’impression créée par nos armées auprès de nos compétiteurs.
Mais si le signalement stratégique est important pour notre pays, savoir décrypter le comportement de nos alliés, compétiteurs et rivaux l’est tout autant. Comment alors interpréter les propos du président malgache, Andry Rajoelina, qui déclarait que les îles Éparses faisaient partie de Madagascar[13] ? La France étant chassée du Mali et du Niger par des juntes appuyées par Moscou, il ne fait aucun doute que le tempo semble opportun pour revendiquer les Éparses de manière plus active.
Nouer des alliances avec des pays aux enjeux similaires
Enfin, la France fut un point essentiel de la stratégie de riposte britannique. Les deux pays partageaient un certain nombre de points communs : ex-puissances coloniales, les deux nations comptaient encore de nombreux territoires à travers le monde, en étant à la fois dans l’OTAN et soucieuses de préserver leur autonomie stratégique. Paris fut d’une grande aide pour Londres. En bloquant l’approvisionnement d’Exocet à l’Argentine d’abord, puis en faisant pression sur le Pérou pour empêcher le don des leurs. François Mitterrand proposa à la Navy d’utiliser Dakar comme point d’appui, fourni du renseignement, et assura par des gestes forts Margaret Thatcher de son soutien diplomatique. Les pilotes anglais s’entrainèrent même contre les Super-Étendard français aussi en service dans l’armée argentine.
Quelle leçon pour la diplomatie française ? Cultiver des relations cordiales avec des pays aux mêmes affinités stratégiques paraît être essentiel. Au moment où le Zeitenwende fait regarder l’Allemagne à l’est, est-il envisageable de penser à un soutien européen fort sur la question de nos outre-mer, spécificité nationale rare à l’échelle du continent ? L’article 42 du traité de l’Union ne statue même pas sur la forme que doit revêtir l’aide des pays européens en cas d’agression d’un membre. Les alliances bilatérales, et surtout celle avec le Royaume-Uni qui possède toujours des intérêts similaires, doivent être fructifiées par un renforcement de notre culture opérationnelle commune : c’est le sens des accords de Lancaster House, signés en 2010.
Pour finir, il est important de noter que le scénario d’une puissance étrangère déstabilisant nos outre-mer a fait les gros titres avec l’ingérence azerbaïdjanaise en Nouvelle-Calédonie. La place que cet épisode a occupée dans les médias témoigne d’une progressive prise de conscience collective de la vulnérabilité de nos territoires. Ces scenarii, hypothèses soutenues depuis longtemps par Conflits[14], ou issus de la Red Team, intéressent désormais des médias grand public, comme le témoigne l’enquête[15] réalisée par Alexandra Saviana. Elle y détaille notamment une offensive malgache pour récupérer à son compte la ZEE des îles Éparses, revendiquées de longue date. Appuyé par la Chine et ses capacités hybrides (cyberattaques, soutien logistique et économique), ce scénario présente de nombreuses similitudes avec l’attaque des Malouines quarante-deux ans auparavant.
Maintenant que les États-Unis se tournent résolument vers le Pacifique, ils n’iront pas contre la France si, en agissant pour ses intérêts, elle œuvre pour conserver une crédibilité sur le théâtre européen. Paradoxalement, la crédibilité des acteurs de ce théâtre est testée par des stratégies indirectes et périphériques sur nos outre-mer, comme le montre l’implication de l’Azerbaïdjan. Chez nos alliés, la solidarité officielle sera nécessaire à défaut d’enjeux conduisant à leur implication active à nos côtés. Les Malouines proposent à ce titre un dernier enseignement : les alliés soutiennent volontiers, mais l’action de guerre se fait seul, de sorte que conserver les capacités d’intervenir est la garantie de nos souverainetés. C’est ce qui s’est passé pour les Français au Sahel, et la capacité à agir seul devra être éprouvée. Pour cela, la triade clausewitzienne politique/armée/peuple devra être entretenue dans une même culture de la profondeur stratégique française à travers ses territoires ultra-marins. Profondeur qui est la source de sa puissance, et qui, associée à l’arme nucléaire, permet de conserver ce statut de pays puissant parmi ses pairs.
[1] Voir la MISSION GOUVERNEMENTALE – redéfinition du dispositif de flotte stratégique – juillet 2023, par le Député Yannick Chenevard.
[2] Alors secrétaire d’État à la Défense.
[3] Ships Taken Up From Trade, Navires Réquisitionnés Dans la Flotte Commerciale.
[4] Forces et faiblesses de la France maritime, Académie de marine, septembre 2024.
[5] Special Boat Service, pendant naval du SAS.
[6] Anti-Access Area Denial ou Dénie d’accès et interdiction de zone.
[7] Henri Masse, Une guerre pour les Malouines, thèse de doctorat, 1996 dir. Prof. Alfred Wahl, 1996, p. 180.
[8] A. Parsons, « The Falklands Crisis in the United Nations, 31 March-14 June 1982 », International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), vol. 59, no 2, p. 169‑178, 1983.
[9] Résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1982 | Conseil de sécurité https://main.un.org/securitycouncil/fr/content/resolutions-adopted-security-council-1982
[10] https://www.youtube.com/watch?v=3C9hxsRO7pI
[11] V. Mastny, « The Soviet Union and the Falklands War », Naval War College Review, vol. 36, no 3, p. 46‑55, 1983.
[12] M. Shurkin, « France’s War in Mali : Lessons for an Expeditionary Army », 2014.
[13] https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/iles-eparses-0/madagascar-les-iles-eparses-sont-malgaches-1528034.html
[14] Voir par exemple « Les îles Eparses, un enjeu stratégique pour la France » par Paul VILLATOUX, 6 juillet 2021
[15] A. Saviana, Les Scénarios noirs de l’armée française. Groupe Robert Laffont, 2024.
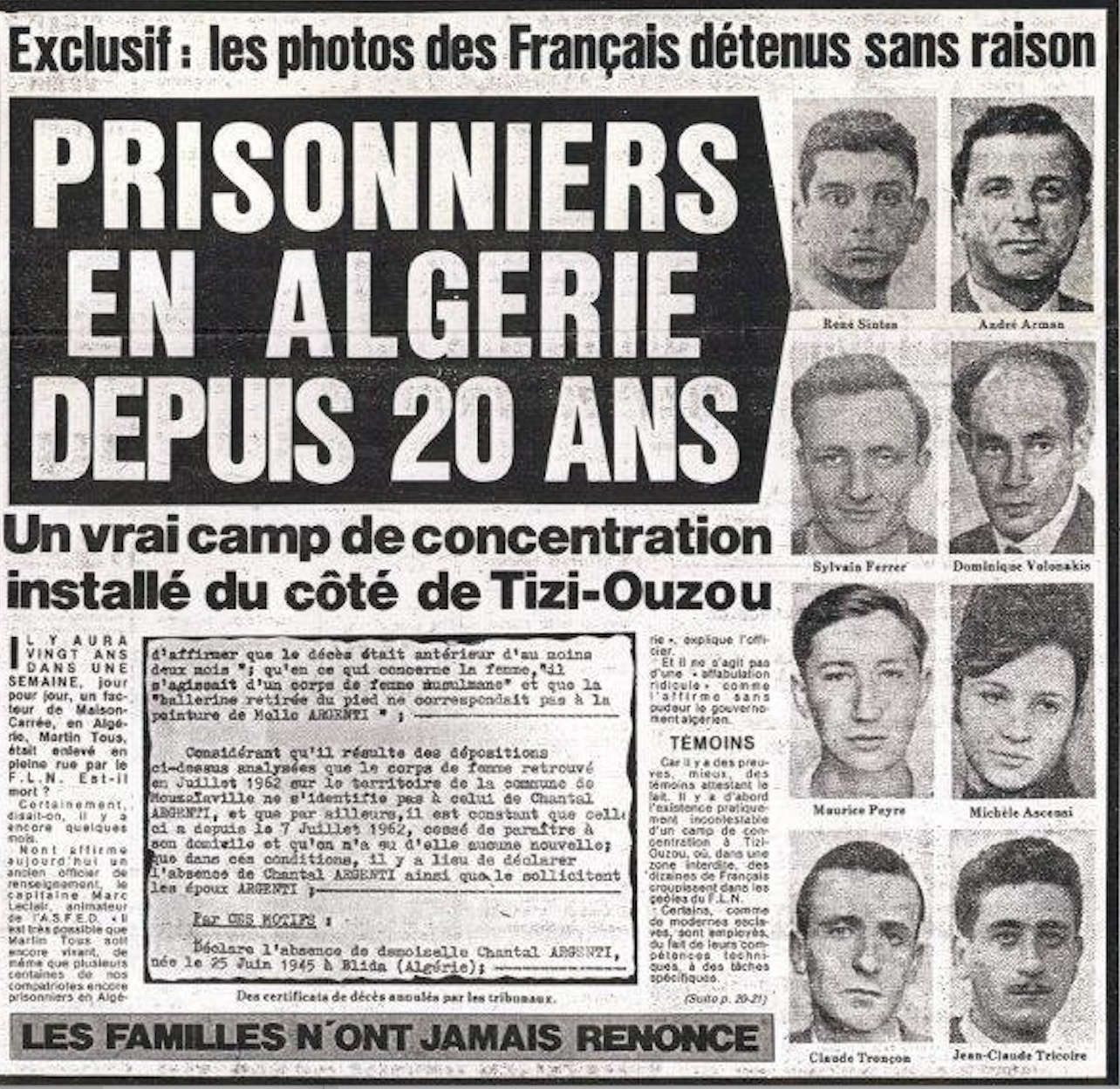















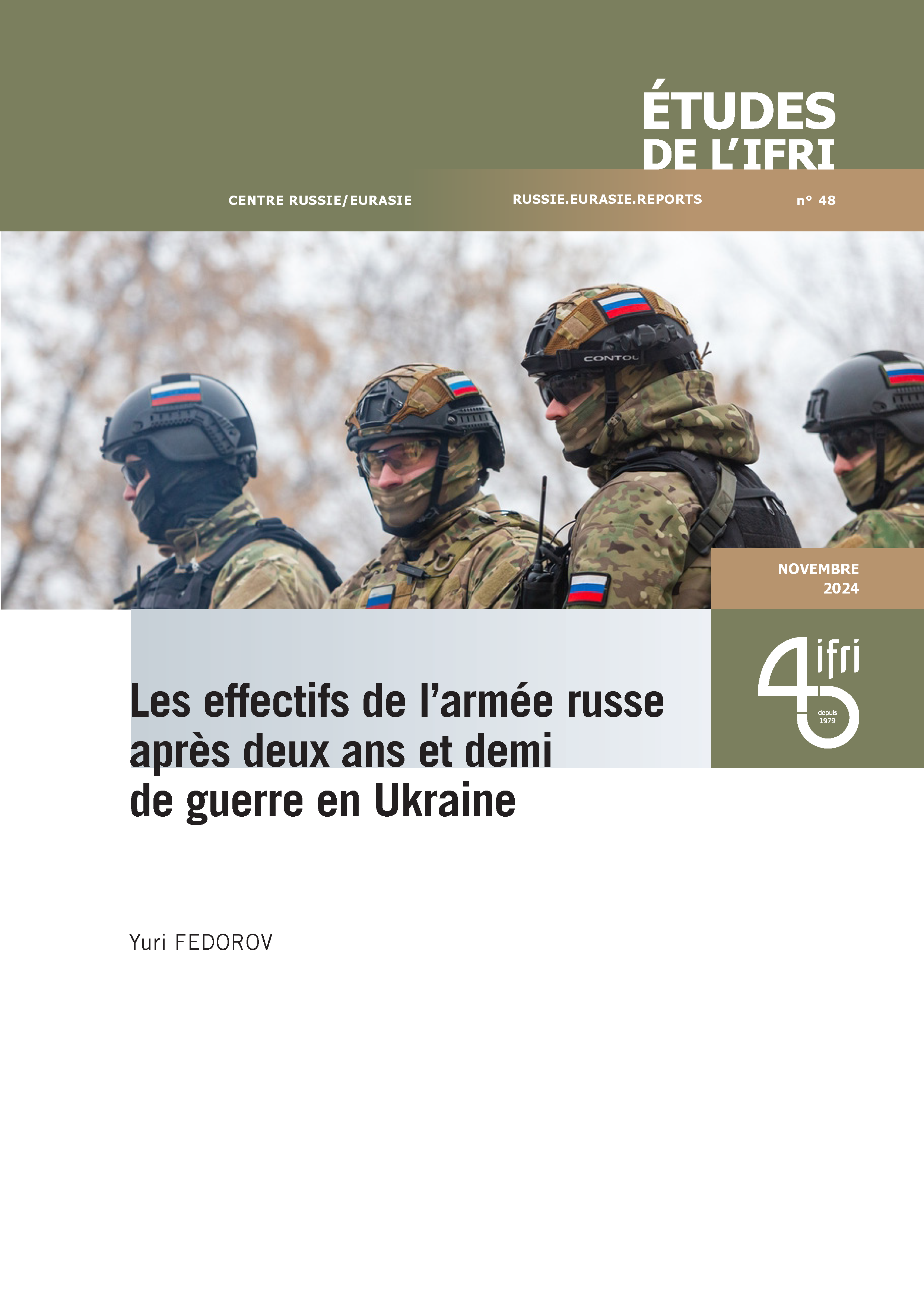




 SBU
SBU