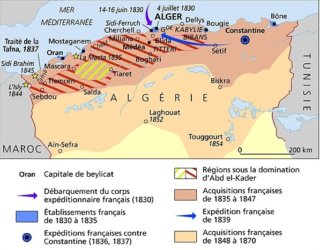Armée et contre-terrorisme. Retour sur l’expérience de la bataille d’Alger

par Michel Goya – La Voie de l’épée – publié le 10 mai 2021
https://lavoiedelepee.blogspot.com/2021/05/armee-et-contre-terrorisme-retour-sur.html
Fiche au chef d’état-major des armées, 2007
Il y a juste cinquante ans, l’armée de terre était engagée aux côtés des forces de police pour éradiquer le terrorisme dans une grande ville française. On connaît le résultat : une victoire acquise en quelques semaines, mais un désastre stratégique et psychologique dont l’armée s’est difficilement remise. À l’heure où la menace du terrorisme est présentée à nouveau comme menace majeure, voire unique, et où la tentation est forte d’employer tous les moyens pour s’en préserver, il n’est peut-être pas inutile de revenir sur cette expérience.
Pourquoi l’armée ?
En 1957, le gouvernement fait appel à l’armée parce qu’il est désemparé face au phénomène du terrorisme urbain qui frappe Alger, menace nouvelle et d’une grande ampleur non pas par le nombre de victimes qu’occasionne chaque attentat, très inférieur par exemple aux attaques de Madrid en 2004 ou à New York en 2001, mais par leur multiplication. A partir de septembre 1956 et pendant plus d’un an, cette ville de 900 000 habitants est en effet frappée en moyenne chaque jour par deux attaques qui font, toujours en moyenne, un mort et deux blessés.
Les forces de police ne parviennent pas à faire face au problème, car elles sont paralysées par trois facteurs : la multiplicité et la rivalité des services (RG, sécurité militaire, PJ, DST, gendarmerie), la méconnaissance du phénomène et la compromission avec la population européenne dont elle est majoritairement issue. Elle se retrouve donc à la fois décrédibilisée pour son inefficacité du côté « européen », selon les appellations de l’époque, et pour sa partialité du côté « musulman », 400 000 habitants dont 80 000 dans le labyrinthe de la Casbah. Le 10 août 1956, les Musulmans ont été victimes rue de Thèbes dans la Casbah du pire attentat de toute la période avec officiellement 16 morts mais sans aucun doute beaucoup plus, une attaque dont les auteurs, des « ultras » partisans de l’Algérie française, ont été mollement poursuivis. Les Musulmans sont exaspérés aussi de l’inaction policière face aux « ratonnades » qui suivent souvent les attentats et qui occasionnent au moins autant de victimes innocentes que ces mêmes attentats. De ce fait et autant que par sympathie idéologique ou par peur, cette population musulmane accepte bon gré mal gré la mainmise du FLN.
Dans ces conditions et alors que le FLN lance la menace d’une grève générale, le ministre-résidant Robert Lacoste, estime n’avoir pas d’autre solutions que de faire appel à l’armée et notamment à la 10e division parachutiste du général Massu, dont on a pu constater l’efficacité dans le « djebel ». Dans son esprit, c’est la suite logique du glissement opérée depuis 1954 lorsque les militaires ont été engagées dans des opérations ipso facto de sécurité intérieure puisqu’on leur refusait le titre de « guerre ». Cette décision ne suscite que peu d’opposition politique.
Le 7 janvier 1957, le préfet du département d’Alger signe une délégation de pouvoirs au général Massu dont l’article premier est rédigé ainsi : « Sur le territoire du département d’Alger, la responsabilité du maintien de l’ordre passe […] à l’autorité militaire qui exercera, sous le contrôle supérieur du préfet d’Alger, les pouvoirs de police normalement impartis à l’autorité civile ». Les premières unités parachutistes arrivent dans la nuit pour se lancer immédiatement dans une énorme perquisition au sein de la Casbah. A la fin du mois de janvier, ils brisent par la force la grève générale, au mépris de la loi et à la satisfaction de tous.
Logique militaire contre logique policière
Dès son arrivée à Alger, le général Massu donne la méthode à suivre : « Il s’agit pour vous, dans une course de vitesse avec le FLN appuyé par le Parti Communiste Algérien, de le stopper dans son effort d’organisation de la population à ses fins, en repérant et détruisant ses chefs, ses cellules et ses hommes de main. En même temps, il vous faut monter votre propre organisation de noyautage et de propagande, seule susceptible d’empêcher le FLN de reconstituer les réseaux que vous détruirez. Ainsi pourrez-vous faire reculer l’ennemi, défendre et vous attacher la population, objectif commun des adversaires de cette guerre révolutionnaire !
Ce travail politico-militaire est l’essentiel de votre mission, qui est une mission offensive. Vous l’accomplirez avec toute votre intelligence et votre générosité habituelles. Et vous réussirez. Parallèlement se poursuivra le travail anti-terroriste de contrôles, patrouilles, embuscades, en cours dans le département d’Alger. »
Toute l’ambiguïté de l’action policière effectuée par des militaires est dans ce texte. Pour les parachutistes, qui reviennent amers de l’expédition ratée à Suez, Alger est un champ de bataille, au cadre espace-temps précis, dans lequel ils s’engagent à fond, sans vie de famille et sans repos, jusqu’à la victoire finale et en employant tous les moyens possibles.
En réalité, cette opération mérite difficilement le qualificatif de « bataille » tant la dissymétrie des adversaires est énorme, à l’instar de la police face aux délinquants qu’elle appréhende. La logique policière agit alors de manière linéaire ne cherchant pas à surmonter une dialectique adverse qui n’existe pas ou peu, mais à déceler et appréhender tous ceux qui ont transgressé la loi. Cette logique est soumise à la tendance bureaucratique à rechercher le 100 % d’efficacité et donc à réclamer toujours plus de moyens pour y parvenir et plus de liberté dans l’emploi de la force, avec cet inconvénient qu’à partir d’un certain seuil, les dépenses s’accroissent plus que proportionnellement aux résultats. La tentation est alors forte de les justifier en élargissant la notion de menace. Cette tendance reste cependant étroitement contrôlée de manière explicite par la loi, mais aussi normalement par une culture policière d’emploi minimal de la force.
Dans la logique militaire, selon l’expression de Clausewitz, c’est chaque adversaire qui fait la loi de l’autre et c’est cette dialectique qui freine la montée en puissance. En Algérie, après quelques succès, les grandes opérations motorisées de bouclage menées en 1955 ont rapidement perdu toute efficacité dès que les combattants ennemis ont appris à les déjouer. Sans cet échec, on aurait probablement éternellement continué dans cette voie jusqu’aux fameux et finalement inatteignables 100 % de succès.
A Alger, la dialectique est très réduite et la force militaire tend donc à monter très vite aux extrêmes d’autant plus que les freins qui existent pour la police sont beaucoup moins efficaces avec des militaires qui n’ont pas du tout le même rapport au droit. Dès les premières opérations de contre-guérilla en 1954, les unités de combat étaient stupéfaites de voir des gendarmes devoir les accompagner, dresser des procès-verbaux et compter les étuis après les combats. Dans le combat, elles restaient dans une logique militaire de duel entre adversaires respectables, mais dès la fin du combat elles entraient dans une logique policière contraire. L’ennemi anonyme mais honorable devenait un individu précis mais contrevenant à la loi, à condition toutefois de le prouver. Lorsqu’elles ont vu par la suite que les prisonniers étaient souvent libérés « faute de preuves », la plupart des unités ont simplement conservé leurs ennemis dans la logique guerrière en les tuant. Ce faisant, elles ont franchi une « ligne jaune » bafouant ouvertement un droit en retard permanent sur la logique d’efficacité militaire.
Avec les attentats d’Alger, l’ennemi n’apparaît même plus respectable puisqu’il refuse la logique de duel pour frapper de manière atroce des innocents. Ajoutons enfin l’importance de la notion si prégnante pour les militaires du sacrifice, à la différence près que dans le cas de la « bataille » d’Alger, on ne sacrifiera pas sa vie (il n’y aura que deux soldats tués et cinq blessés) mais son âme.
La continuation de l’action policière par d’autres moyens
Le cadre légal de l’action de la division parachutiste est très large. Les quatre régiments parachutistes engagés peuvent appréhender en flagrant délit ou contrôler des groupes et agir sur renseignement avec des OPJ affectés à chacun d’eux.
Le général Massu, nommément désigné, a le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Normalement, les individus arrêtés doivent être remis à l’autorité judiciaire ou à la gendarmerie dans les 24 heures, mais le préfet délègue à l’autorité militaire le droit d’assignation à résidence surveillée pendant au maximum un mois. Cette assignation à résidence permet d’arrêter de simples suspects et de constituer ensuite le dossier qui permettra éventuellement de les présenter au parquet, à l’inverse des méthodes de la Police judiciaire. Le tribunal militaire du corps d’armée de la région peut également juger les affaires de flagrant délit suivant une procédure très rapide, dite de traduction directe, où un simple procès-verbal de gendarmerie suffit. Le tribunal militaire peut également revendiquer les poursuites exercées par les tribunaux civils et de fait, dans la presque totalité des cas, les HLL (« hors-la-loi ») sont présentés devant lui.
Forte de ces pouvoirs, la division parachutiste met en place progressivement et de manière pragmatique plusieurs structures. Le premier système, dit « de surface », consiste à protéger les sites sensibles et à quadriller la ville par des points de contrôle et plus de 200 patrouilles quotidiennes. Les régiments sont affectés à des quartiers particuliers qu’ils finissent par connaître parfaitement et la Casbah est complètement bouclée. Ce contrôle constant en impose et rassure la population, tout en entravant les mouvements du FLN, mais il ne permet pas d’effectuer beaucoup d’arrestations.
Le démantèlement des réseaux est le fait de l’organisation « souterraine », c’est-à-dire d’abord de la structure de renseignement. Les renseignements proviennent de trois sources : la documentation, c’est-à-dire les fichiers (mais les services compétents sont réticents à coopérer) ou les documents du FLN ; la population, mais les langues ne commencent à se délier que lorsque l’emprise du FLN se desserre, et surtout les interrogatoires de suspects. Dans l’ambiance qui règne alors d’urgence, de lutte implacable contre un ennemi invisible et détesté et il faut bien le dire, de mépris vis-à-vis d’une population musulmane « moins française que les autres », les notions de suspects et d’interrogatoire se brouillent très vite. Tout musulman tend à être suspect et tout interrogatoire tend à devenir torture. Au sein de cette structure de renseignement, le commandant Aussaresses, est chargé des exécutions extrajudiciaires maquillées le plus souvent en suicide, comme celles du leader FLN Mohamed Larbi Ben M’hidi ou de l’avocat Ali Boumendjel.
Où s’arrête la sécurité globale ?
Comme le souligne le général Massu dans son ordre d’opération, la traque des terroristes selon des méthodes inspirées de celle de la police n’est qu’un aspect du problème. Il faut aller beaucoup plus loin. Dans la trinité clausewitzienne, la force armée, le gouvernement et le peuple se renforcent et se contrôlent mutuellement. Lorsqu’une guerre est déclarée, les deux armées ennemies s’affrontent dans un duel gigantesque, et lorsqu’un vainqueur se dessine, le gouvernement vaincu et le peuple à sa suite se soumettent. Dans la « guerre contre-terroriste », on détruit les cellules tactiques ennemies mais aussi les chefs, avec qui il est hors de question de négocier. Si l’on veut mener une guerre, le seul pôle sur lequel on peut agir est donc la population. Combinant la recherche policière du 0 terroriste et la vision militaire de lutte collective, l’armée se lance dans le contrôle étroit du « peuple de l’ennemi » pour éviter qu’il sécrète à nouveau des « malfaisants ».
On s’engage donc dans une voie dont on ne cerne pas la fin et les contradictions. Outre que l’on n’hésite pas à brutaliser la population musulmane (plusieurs dizaines de milliers de suspects, innocents pour la très grande majorité, passeront par les centres de triage), on lui impose, sur l’initiative du colonel Trinquier, un dispositif d’autosurveillance inspiré des régimes totalitaires communistes qui ont tant marqué les vétérans d’Indochine. Dans le cadre de ce dispositif de protection urbaine (DPU), aussitôt surnommé Guépéou. Chaque maison de la Casbah ou des bidonvilles est numérotée et chacun de ses habitants est fiché. Des chefs d’arrondissements, îlots, buildings ou maisons sont désignés (7 500 au total) avec l’obligation de tenir à jour des fiches de présence et de signaler tout mouvement, sous peine de sanctions. La mise en place du DPU permet ainsi de découvrir Ben M’Hidi.
Le DPU sert aussi de relais pour l’encadrement psychologique et administratif de la population. En s’immisçant dans tous les aspects de la vie, avec la création de sections administratives urbaines (SAU), d’organisations d’anciens combattants, de « cercles féminins » (où les femmes reçoivent un enseignement pratique sous l’impulsion d’équipes médico-sociales) et en inondant la ville de photos, affiches, tracts, messages par radio, journaux ou cinémas itinérants, on espère gagner « la bataille des cœurs et des esprits ». Cette mainmise permet aux parachutistes de devenir à leur tour des « poissons dans l’eau » même s’il s’agit surtout de poissons prédateurs.
Cela n’empêche pas Yacef Saadi, le chef du réseau « bombes » à Alger d’organiser à nouveau une série d’attentats atroces. Les 4 et 9 juin, Saadi et ses poseurs de bombes, souvent des porteuses pour moins attirer la méfiance, tuent 18 personnes et en blessent près de 200. Cette fois le général Massu fait appel au colonel Godard pour organiser les opérations. Godard, futur membre de l’OAS, est très hostile aux méthodes employées précédemment et notamment l’usage de la torture. Trinquier et Aussaresses sont écartés au profit du capitaine Léger qui parvient à organiser de spectaculaires opérations d’infiltration et d’intoxication des réseaux du FLN, la fameuse « bleuite ». Même s’il y aura quelques attaques l’année suivante, la bataille d’Alger se termine en octobre 1957, avec l’arrestation de Yacef Saadi et la mort du tueur Ali-la-pointe.
Où est la victoire ?
La méthode, souvent brutale, a été tactiquement efficace. Le réseau « bombes » est démantelé une première fois en février 1957 puis à nouveau en octobre. Le comité exécutif du FLN, privé de Ben M’Hidi s’est enfui pour la Tunisie. Officiellement, jusqu’à la fin mars, la 10e DP a tué 200 membres du FLN et arrêté 1 827 autres, mais beaucoup plus selon d’autres sources comme Paul Teitgen, secrétaire général de la police à Alger, qui font aussi l’objet de controverses.
Mais si la victoire immédiate sur le terrorisme est flagrante, il est probable que les méthodes employées, quoique souvent moins dures que celles du camp d’en face y compris contre les siens, ont contribué encore à pousser la population musulmane dans le camp ennemi. La polémique qui naît sur les méthodes employées va également empoisonner l’action militaire jusqu’à la délégitimer gravement.
En interne, le malaise est aussi très sensible du fait du mélange des genres. D’un côté, certains ne se remettront pas de leur engagement dans l’action policière poussée à fond alors que d’autres souffriront au contraire de ce non-combat si contraire à l’éthique militaire et si frustrant. Cela se traduit parfois par des bouffées de violence comme en juin 1957, lorsque trois parachutistes agressés depuis une voiture se ruent dans un hammam et tuent plusieurs dizaines d’innocents. Bien qu’infiniment moins meurtrière pour eux que les batailles de 1944-1945 par exemple, les soldats français gardent un souvenir détestable de cette période jusqu’à l’incruster profondément dans l’inconscient collectif.