Trump et l’arme tarifaire : l’économie au service d’une géopolitique offensive

par Camille Boulenguer * – IRIS – publié le 23. avril 2025
*Camille Boulenguer est économiste, chercheuse à l’IRIS. Ses travaux se situent à la confluence entre l’économie industrielle et la fiscalité, et interrogent les imbrications entre économie légale et économie illégale (évasion fiscale, blanchiment d’argent, corruption). Ses thèmes de recherche se concentrent notamment autour des enjeux et de l’évolution des pratiques économiques illicites avec l’arrivée des nouvelles technologies (intelligence artificielle, cryptomonnaies, robotique). Elle est par ailleurs co-responsable pédagogique du parcours Risques géoéconomiques et intelligence stratégique d’IRIS Sup’.
Camille Boulenguer est doctorante en économie de l’Université Picardie Jules Verne. Elle est également titulaire de deux masters : l’un en économie (Université de Paris Dauphine) et l’autre en intelligence économique (Université Gustave Eiffel).
La remise en cause du principe de la Nation la plus favorisée (NPF)
Depuis sa création en 1995, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) repose sur un ensemble de principes destinés à encadrer le libre-échange entre ses membres. Parmi eux, celui de la Nation la plus favorisée (NPF) constitue l’un des fondements du multilatéralisme commercial : il impose que toute concession tarifaire accordée à un pays membre soit automatiquement étendue à l’ensemble des autres membres, assurant ainsi une égalité de traitement. Ce principe stipule que toute concession tarifaire accordée à un pays membre doit être automatiquement étendue à l’ensemble des autres membres de l’OMC. Bien que des exceptions existent, notamment pour les zones de libre-échange (USMCA, UE), les mesures de rétorsion commerciale et les accords préférentiels pour les pays en développement, la NPF assure un traitement non discriminatoire et une uniformité des tarifs entre pays membres de l’OMC. Or, ce principe a été frontalement remis en cause par l’administration Trump, qui y voit un facteur d’injustice dans les relations commerciales bilatérales des États-Unis. Portée par une vision plus unilatérale et transactionnelle des échanges internationaux, l’équipe Trump, soutenue par la Heritage Foundation, a développé une stratégie de « réciprocité tarifaire » visant à corriger ce qu’elle considère comme des déséquilibres persistants. Dans son Projet 2025, le think tank conservateur met en avant l’existence d’asymétries tarifaires : de nombreux partenaires commerciaux des États-Unis appliqueraient des droits de douane plus élevés aux produits américains qu’ils n’en subissent sur leurs propres exportations vers les États-Unis. Cette situation serait responsable, pour l’administration Trump, de déséquilibres commerciaux persistants. Face ces distorsions commerciales, Washington entend imposer un principe de « réciprocité tarifaire ». Concrètement, les droits de douane seraient relevés de manière ciblée afin de compenser les écarts identifiés avec les partenaires commerciaux.
Cette remise en cause du multilatéralisme commercial pose de sérieuses questions sur l’avenir de la coopération économique internationale et sur la capacité des institutions comme l’OMC à encadrer les ambitions protectionnistes croissantes.
Une méthode de calcul controversée
La méthode de calcul retenue pour déterminer les nouveaux droits de douane au 2 avril 2025[1] soulève de vives critiques parmi les spécialistes. Elle repose sur une formule sommaire : il s’agirait de diviser le déficit commercial bilatéral par le montant des importations états-uniennes en provenance du pays concerné, puis de diviser ce résultat par deux pour obtenir le taux de droit de douane à appliquer. Cette approche est jugée arbitraire par la majorité des économistes, car elle ne tient compte ni de la structure des échanges ni des effets de substitution ou de contournement. Elle revient à taxer les produits importés en fonction de déséquilibres macroéconomiques globaux, sans analyse fine des chaînes de valeur ou des comportements des agents économiques. En effet, les calculs avancés par l’administration Trump négligent les effets de répercussion des droits de douane sur les agents économiques, qu’il s’agisse d’une compression des marges des exportateurs étrangers ou, plus fréquemment, d’un renchérissement des prix supporté par les consommateurs américains.
En 2024, les déficits commerciaux bilatéraux les plus marqués sont enregistrés avec :
- Chine : -338 milliards USD
- Union européenne : -192 milliards USD
- Mexique : -108 milliards USD
- Vietnam : -99 milliards USD
- Canada : -72 milliards USD
- Japon : -55 milliards USD
- Irlande : -54 milliards USD
- Taïwan : -41 milliards USD
La politique commerciale défendue par Donald Trump repose sur une lecture du commerce international simpliste dominée par la notion de déséquilibre bilatéral. L’administration Trump considère ainsi que les déficits commerciaux doivent être imputés aux partenaires commerciaux et, à ce titre, que ceux-ci doivent en assumer le coût. L’application de cette méthode de calcul conduit à certaines aberrations : le Cambodge, par exemple, se verrait imposer un tarif de 49 %. On peut également s’étonner de certains choix de découpage géographique : si la France métropolitaine est intégrée à l’ensemble « Union européenne », ses territoires d’outre-mer comme la Polynésie française, la Guyane, la Martinique ou la Guadeloupe apparaissent, eux, en dehors de l’UE, avec des droits de douane estimés à 10 % et 76 %. Est-ce une incohérence d’ordre mathématique, une méconnaissance géographique ou bien un signal politique lancé à la France ?
Des conséquences difficilement évaluables
S’il est encore prématuré d’en anticiper pleinement les retombées, il est certain que la mise en œuvre de ces nouveaux tarifs entraînerait des effets économiques et géopolitiques majeurs.
Sur le plan économique
L’administration Trump affirme que la hausse généralisée des droits de douane pourrait générer jusqu’à 600 milliards de dollars par an en recettes supplémentaires. Celles-ci serviraient à financer une réduction du taux de l’impôt sur le revenu des sociétés, passant de 21 % à 15 %, conformément aux promesses de campagne. Plusieurs instituts de recherches tels que Tax Fondation ou le Oxford Economics ont exprimé des doutes quant à la faisabilité des projections de l’administration Trump concernant les recettes générées par les nouveaux tarifs douaniers. L’administration estime que ces tarifs pourraient rapporter environ 600 milliards de dollars par an, soit 6 000 milliards sur une décennie. Cependant, des analyses indépendantes suggèrent des chiffres nettement inférieurs. Le Tax Foundation prévoit une augmentation des recettes fiscales fédérales de 258,4 milliards de dollars en 2025, ce qui représente 0,85 % du PIB. De plus, le Congressional Budget Office (CBO) estime que les tarifs pourraient générer environ 800 milliards de dollars sur dix ans, soit environ 80 milliards par an, sans prendre en compte les éventuelles mesures de rétorsion. Pour compenser une réduction significative de l’impôt sur le revenu, il serait nécessaire d’imposer des tarifs moyens très élevés sur toutes les importations, ce qui pourrait avoir des effets économiques négatifs considérables. Erica York, économiste au Tax Foundation, souligne qu’une taxe uniforme de 70 % sur toutes les importations serait requise pour égaler les recettes de l’impôt sur le revenu de 2023, une mesure jugée irréaliste. Ainsi, les projections de l’administration semblent optimistes et ne tiennent pas pleinement compte des réactions du marché et des partenaires commerciaux, ni des conséquences économiques potentielles. Par ailleurs, l’annonce de cette réforme tarifaire a immédiatement provoqué une onde de choc sur les marchés financiers. Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé de manière significative : le S&P 500 a enregistré une baisse de 2 %, tandis que le Nasdaq 100 a chuté de 3 %, illustrant les craintes des investisseurs face à une possible escalade protectionniste et à la perspective d’une guerre commerciale prolongée.
Sur le plan géopolitique et commercial
La stratégie tarifaire états-unienne semble s’inscrire dans une logique de remise en cause du multilatéralisme commercial. L’introduction de droits de douane différenciés selon les pays – avec des exceptions notables pour certains partenaires géostratégiques – reflète une volonté de redéfinir les rapports de force au sein du commerce mondial, en dehors des cadres institutionnels traditionnels comme l’OMC. Cette politique pourrait redéfinir les alliances et ouvrir la voie à des représailles de la part des puissances ciblées, notamment la Chine et l’Union européenne, déjà évoquées comme prêtes à répondre par des mesures de rétorsion.
L’annonce de droits de douane très élevés à l’encontre de Taïwan — à hauteur de 32 % — constitue un signal diplomatique particulièrement fort, aux implications potentiellement explosives. Ce choix suscite d’autant plus d’inquiétudes que Taïwan occupe une position stratégique dans les chaînes de valeur mondiales, notamment dans le secteur des semi-conducteurs, un domaine crucial pour l’économie numérique globale. Bien que certaines industries, comme celle des semi-conducteurs, bénéficient pour l’instant de dérogations partielles ou d’exemptions temporaires, le message politique reste clair : une fois que la production de composants critiques aura été suffisamment relocalisée aux États-Unis, un désengagement états-unien vis-à-vis de Taïwan ne peut être exclu. Cette évolution traduit une volonté de réduire la dépendance technologique à l’égard de l’Asie de l’Est, au profit d’une plus grande autonomie stratégique.
Le secteur pharmaceutique, quant à lui, bénéficie également d’une exclusion provisoire de ces nouvelles mesures. Cette exemption vise à éviter des perturbations dans l’approvisionnement en médicaments essentiels. Néanmoins, cette situation est susceptible d’évoluer, et le secteur demeure vigilant quant aux futures décisions en matière de politique commerciale. Ces tarifs ont été maintenus indépendamment des nouvelles mesures annoncées, reflétant une approche distincte pour les industries considérées comme stratégiques pour la sécurité nationale. En 2023, les principaux exportateurs de médicaments vers les États-Unis étaient l’Allemagne, la Suisse, la Belgique, l’Irlande et l’Inde. Ce dernier en particulier, joue un rôle crucial en fournissant des médicaments génériques aux États-Unis, avec des exportations atteignant environ 9 milliards de dollars en 2023, représentant près d’un tiers des exportations pharmaceutiques totales de l’Inde.
Enfin, les produits liés à la défense, tels que l’acier et l’aluminium, sont déjà soumis à des tarifs spécifiques de 25 % en vertu de la Section 232. Cependant, des développements récents suggèrent que ces tarifs pourraient avoir des implications plus larges sur la production d’armes aux États-Unis. En effet, les nouvelles mesures tarifaires imposées par l’administration Trump, notamment une taxe de 20 % sur les produits de l’Union européenne et de 10 % sur les importations du Royaume-Uni et de l’Australie, risquent de perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales essentielles à la fabrication de systèmes d’armement américains. Ces perturbations pourraient entraîner une augmentation des coûts et des retards dans la production d’armes, compromettant potentiellement les partenariats de sécurité internationaux et les projets de défense conjoints tels que le chasseur F-35 et l’alliance sous-marine AUKUS.
On note également l’absence de la Russie et de la Corée du Nord dans le tableau des hausses tarifaires. La Maison-Blanche a justifié cette exclusion en soulignant que les sanctions économiques en vigueur limitaient déjà fortement les échanges commerciaux avec ces pays, rendant ainsi superflue l’instauration de nouveaux droits de douane. Par ailleurs, concernant la Russie, l’administration Trump a exprimé sa volonté de renouer un dialogue diplomatique. En février 2025, des discussions ont été engagées entre représentants américains et russes en vue de rétablir le fonctionnement normal des missions diplomatiques. L’imposition de nouvelles mesures tarifaires aurait alors compromis cette tentative de rapprochement.
Conclusion
La rhétorique protectionniste de Donald Trump contribue à justifier une montée en puissance tarifaire généralisée, présentée comme une réponse légitime aux pratiques commerciales jugées déloyales. Elle s’inscrit dans une logique de souveraineté économique, mais non sans risque pour l’équilibre du système international de commerce et pour la stabilité diplomatique globale. L’effectivité de la nouvelle politique tarifaire reste, en outre incertaine. Toutefois, il est probable que ces mesures soient utilisées comme instruments de négociation dans d’autres dossiers géopolitiques sensibles, notamment celui du trafic de fentanyl avec le Canada. Cette approche, caractéristique d’une diplomatie économique offensive, témoigne d’une volonté assumée de faire des droits de douane un levier de pression stratégique.
[1] Le 9 avril, D. Trump annonce d’un moratoire de 90 jours et maintient un taux mondial de 10 % sur tous les pays touchés par ses nouveaux droits, à l’exception notable de la Chine.





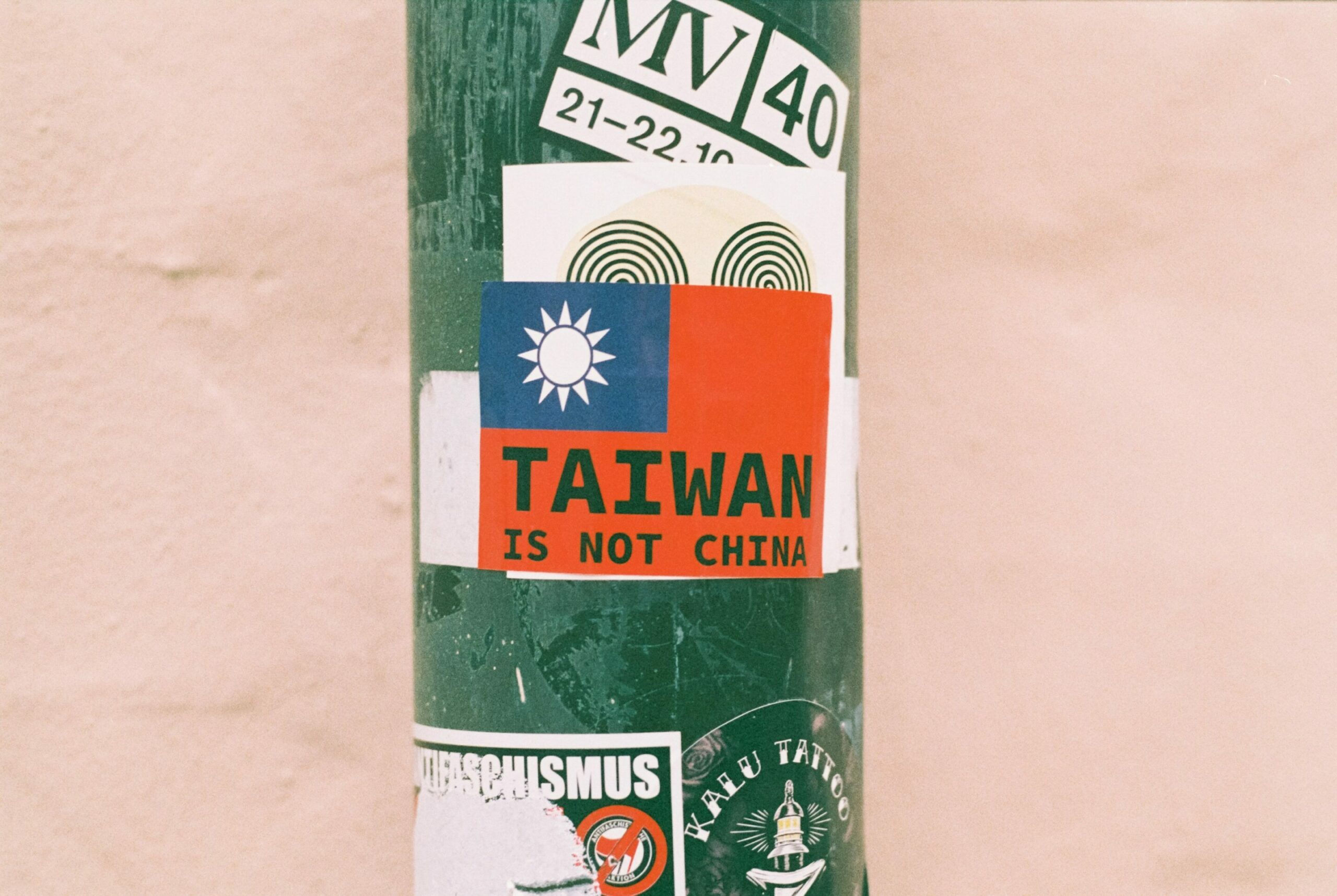








Alors que le président ukrainien rappelait que l’invasion russe remontait à l’annexion de la Crimée en 2014 et que l’Ukraine a déjà signé un cessez-le-feu que la Russie n’a pas respecté, le vice-président américain J.D. Vance l’a violemment interrompu, lui reprochant de plaider sa cause devant les médias américains, exigeant qu’il remercie Trump pour son soutien et insistant sur le fait que l’Ukraine manquait de soldats.
La forme est choquante.
L’objet du débat n’a pourtant rien de trivial.
Il est crucial pour l’Ukraine et pour l’Europe : un cessez-le-feu — que Donald Trump veut obtenir au plus vite — doit-il être précédé de garanties de sécurité ?
Du côté ukrainien et européen, on craint que tout accord qui ne serait qu’un gel des lignes de front — une sorte de Minsk — ne serve qu’à permettre à la Russie de se réarmer et regrouper dans un moment où son économie montre des signes de faiblesse.
Cette séquence, assez visiblement orchestrée, intervient alors que, dans les dix derniers jours, Donald Trump a traité Zelensky de dictateur et que les États-Unis ont voté aux Nations Unies avec la Russie et la Corée du Nord contre une résolution demandant la fin des hostilités ainsi qu’une résolution pacifique du conflit et réaffirmant l’engagement de l’organisation pour l’intégrité territoriale du pays.
Elle a fait réagir la plupart des chancelleries européennes en soutien à l’Ukraine dans la soirée.
Un haut fonctionnaire européen a déclaré au Grand Continent dans la soirée qu’il s’agissait « d’une embuscade pour les caméras ».
En diplomatie, chaque mot compte — ils comptent même double lorsqu’ils sont prononcés face caméra. Pour que chacun puisse avoir connaissance de ceux qui viennent d’être prononcés à Washington, de leur brutalité mais aussi de leur portée, nous publions une transcription non altérée, non éditée des échanges.