A méditer en cas d’embrouille avec Trump: la France aussi est dépendante aux armes et technologies militaires américaines

Les tensions croissantes avec l’administration Trump doivent-elles inquiéter les pays de l’Union européenne dont la dépendance en matière d’armement d’origine américaine constitue une fragilité stratégique? L’Europe est effectivement lourdement dépendante des États-Unis en matériel militaire, comme l’a admis la Commission européenne dont le récent livre blanc prône la préférence européenne en matière d’acquisition d’armement.
Si les deux tiers des armements achetés par les pays de l’Union européenne sont acquis auprès des États-Unis, ce n’est pas le cas de la France dont l’industrie de défense, globalement florissante, permet au ministère des Armées de s’équiper sur le marché français.
Il reste toutefois un certain nombre de domaines où Paris doit se tourner vers l’allié américain et son complexe militaro-industriel pour acquérir des technologies ou des équipements (certains avec des restrictions). Ces achats se font dans le cadre de Foreign Military Sales (FMS) dont le montant récent est chiffré à 6,2 milliards de dollars par le Département d’Etat.
Petite revue de détail des technologies ou des armements en cours de livraison ou fournis au cours des quinze dernières années par les équipementiers US avec la bénédiction du Pentagone. Cet état des lieux, qui ne prend pas en compte la multitude des composants et autres hardware/software américains intégrés aux armements français, montre qu’une éventuelle brouille avec les Etats-Unis aurait des conséquences néfastes dans au moins trois domaines regardant la défense.
Des lance-roquettes unitaires
En 2016, selon la DSCA (la Defense Security Cooperation Agency), la France a acheté aux Etats-Unis 13 Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) pour un coût de 90 millions de dollars. Ces lance roquettes unitaires équipent le 1er régiment d’artillerie mais quatre pièces ont été fournies à l’armée ukrainienne. Le reste, vieillissant, mériterait d’être remplacé.
C’est ce que prévoit la LPM 2024-30. Avec une solution souveraine dans le cadre du programme « Frappe longue portée terrestre » (FLP-T) sur lequel travaillent deux consortiums, l’un formé par MBDA et Safran, l’autre par Thales et Ariane Group. A moins que l’urgence opérationnelle ne pousse à acheter des M142 HIMARS américains (un matériel éprouvé) proposés par l’américain Lockheed-Martin ou des PULS du groupe israélien Elbit Systems. A moins encore que le programme ELSA (European Long Range Strike Approach), qui rassemble la France, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni, ne soit choisi à cause de son actuelle pertinence politique.
Des missiles
Des commandes ad hoc de bombes Paveway (5 000 à partir de 1999, selon le SIPRI) et de missiles ont été faites par Paris dans le cadre de besoins ponctuels liés aux activités opérationnelles lors des opex. Selon les chiffres de la DSCA, Washington a ainsi livré 260 missiles antichars Javelin après un feu vert du Congrès en 2010.
Pour armer ses hélicoptères Tigre et ses drones MQ-9 (lire ci-dessous), Paris a acheté des missiles AGM-114R2 Hellfire (200 en 2015, 260 en 2016, 1 515 en 2023).
Plus récemment, en 2023, la France a été destinataire d’un lot de munitions rôdeuses Switchblade 300 dans le cadre d’un contrat passé entre l’US Army et la firme américaine AeroVironment, Inc. Un premier contrat d’une valeur initiale de 231 millions de dollars au profit de l’armée de Terre US a été augmenté de 64,5 millions de dollars en mars 2023 de façon à permettre la fourniture de systèmes au profit de deux armées étrangères, dont les armées françaises.
Des drones MQ-9
Après une décision prise en 2013 par Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, l’armée de l’Air a été équipée en drones Reaper construits par la société américaine General Atomics Aeronautical Systems, Inc. Le Congrès avait donné son feu vert pour 16 drones mais 12 seulement ont été achetés. Le marché d’une valeur de 1,5 milliard de dollars incluait les drones, des pièces détachées, les software, la formation des personnels français et un soutien technique américain (le contractor logistics support). Pour les douze drones Reaper MQ-9 de l’armée de l’Air et de l’Espace qui dépendent de la 33e escadre Escadre de surveillance, de reconnaissance et d’attaque (ESRA), installée sur la base aérienne 709 de Cognac, ce CLS coûtera en 2025 48,5 millions de dollars.
Cette dépense annuelle somme toute limitée s’inscrit toutefois dans une vraie dépendance de l’AAE. Pour Cédric Perrin, sénateur et président de la commission défense du Sénat, cette dépendance envers les États-Unis est vraiment forte. Cité par mon confrère Pascal Samama, il a rappelé que « nous ne sommes pas propriétaire des images. Si les Américains récupèrent la boite à images qui est dans le Reaper, ils peuvent le faire, nous priver de ces images et même nous empêcher de survoler tel ou tel territoire. Les Américains peuvent décider de l’usage que l’on fait de nos drones ».
Des catapultes électromagnétiques
2025 sera l’année du « dossier de lancement et réalisation » (DLR) avant la commande effective du futur porte-avions, le PA-Ng. Je rappelle que Naval Group et les Chantiers de l’Atlantique réaliseront la plateforme et TechnicAtome les chaufferies nucléaires.
Les catapultes seront fournies par le groupe américain General Atomics qui fournira trois « Electromagnetic Aircraft Launch Systems » (EMALS), pour un coût estimé à plus de 1,3 milliard de dollars. Ces trois catapultes électromagnétiques de nouvelle génération ont été développées par General Atomics pour les porte-avions de la classe Gerald R. Ford de l’US Navy.
Comme l’a bien résumé Guillaume Aigron dans le blog Secret Défense, « la France se trouve dans une position délicate car ces systèmes sont actuellement produits uniquement par les États-Unis. Le constructeur américain General Atomics est le seul à maîtriser ces technologies, déjà déployées sur le porte-avions USS Gerald R. Ford. Cette situation place la France dans une position de dépendance technologique vis-à-vis de son allié transatlantique. »

Les catapultes électromagnétiques qui équiperont le PA-Ng reposent sur le principe de l’induction magnétique. Des circuits électriques, situés de part et d’autre des rails de catapultage, génèrent un champ magnétique mettant en mouvement un chariot mobile sur lequel est fixé l’aéronef. L’alimentation de ce moteur linéaire est contrôlée de manière à être ajustée à la masse de l’avion ou du drone à catapulter et à la vitesse finale nécessaire à son catapultage. Des systèmes de stockage et de restitution d’énergie, situés en amont des moteurs, permettent de lisser les appels de puissance vis-à-vis de l’installation de production électrique du navire lors de l’utilisation des EMALS.
Guet et transport aériens
Restons dans le domaine aéronautique avec un trio de contrats. D’abord celui des avions de guet aérien AWACS (Airborne Warning and Control Systems) qui date des années 1990. L’armée de l’Air et de l’Espace dispose de quatre E-3F (des Boeing 707 modifiés de 35 ans d’âge) basés à Avord, sur la base aérienne 702 où ils sont exploités au sein de la 36e escadre de commandement et de conduite aéroportés. Eux aussi vieillissants, ils pourraient être remplacés par des E-7A Wedgetail, développés par l’Américain Boeing (et retenus par l’Otan), ou par le système GlobalEye du Suédois Saab.
Deuxième contrat, celui deux C-130J et des deux KC-130J désormais installés à Evreux avec des appareils similaires de l’armée de l’Air allemande. Soit cinq aéronefs C-130J-30 et cinq aéronefs KC-130J achetés aux États-Unis en 2015 et livrés à partir de septembre 2018. A noter que le soutien technique de la flotte des C-130 français a un coût annuel d’une cinquantaine de millions de dollars versée à l’entreprise américaine Lockheed Martin Aeronautics Co.

Enfin, un autre contrat, lui en cours depuis 2020, concerne la livraison à la Marine nationale de trois avions de guet aérien E-2D Advanced Hawkeye Aircraft pour remplacer l’actuelle flotte française d’E-2C Hawkeye 2000 entrés en service dans la Marine nationale en 1998. Le premier des E-2D est en construction aux USA depuis décembre dernier. Livraison prévue en 2027. La valeur initiale du marché était estimée à deux milliards de dollars mais l’addition s’est déjà alourdie de quelques 450 millions de dollars.


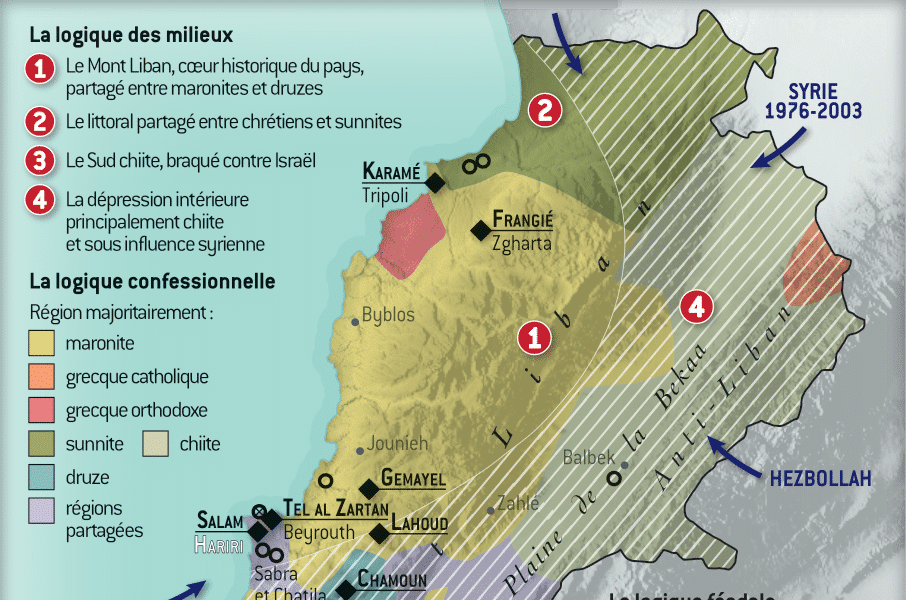
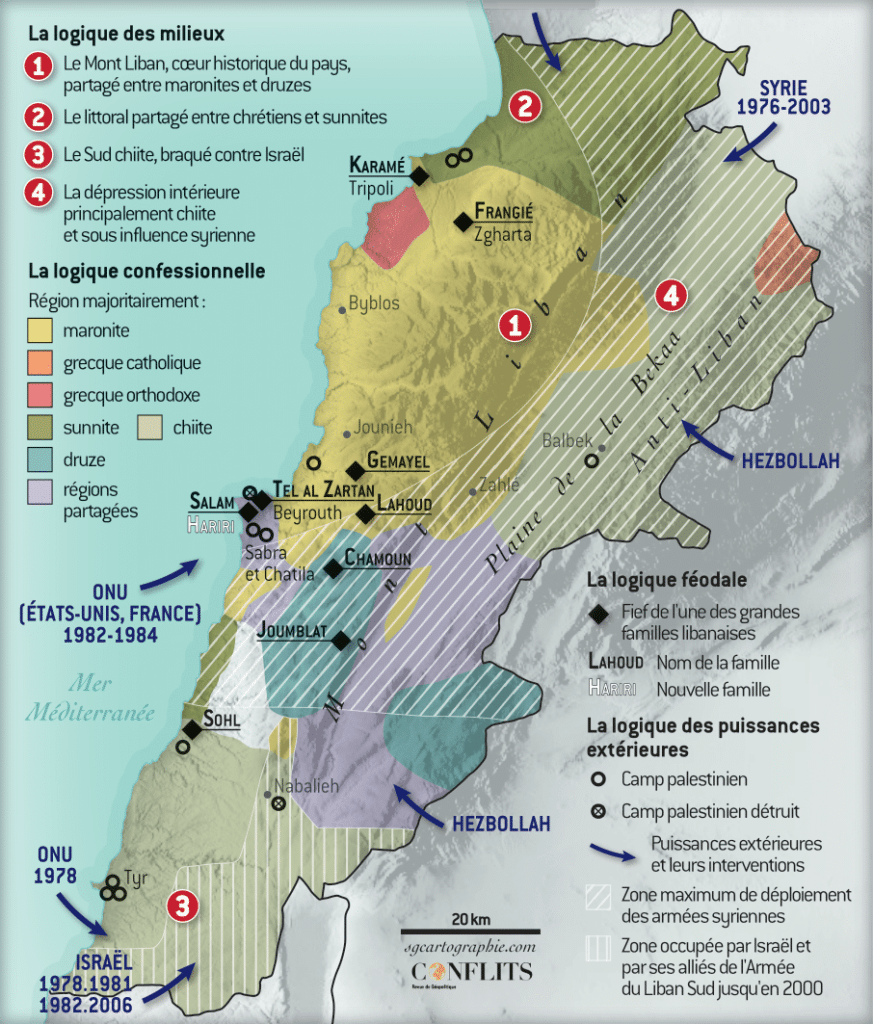
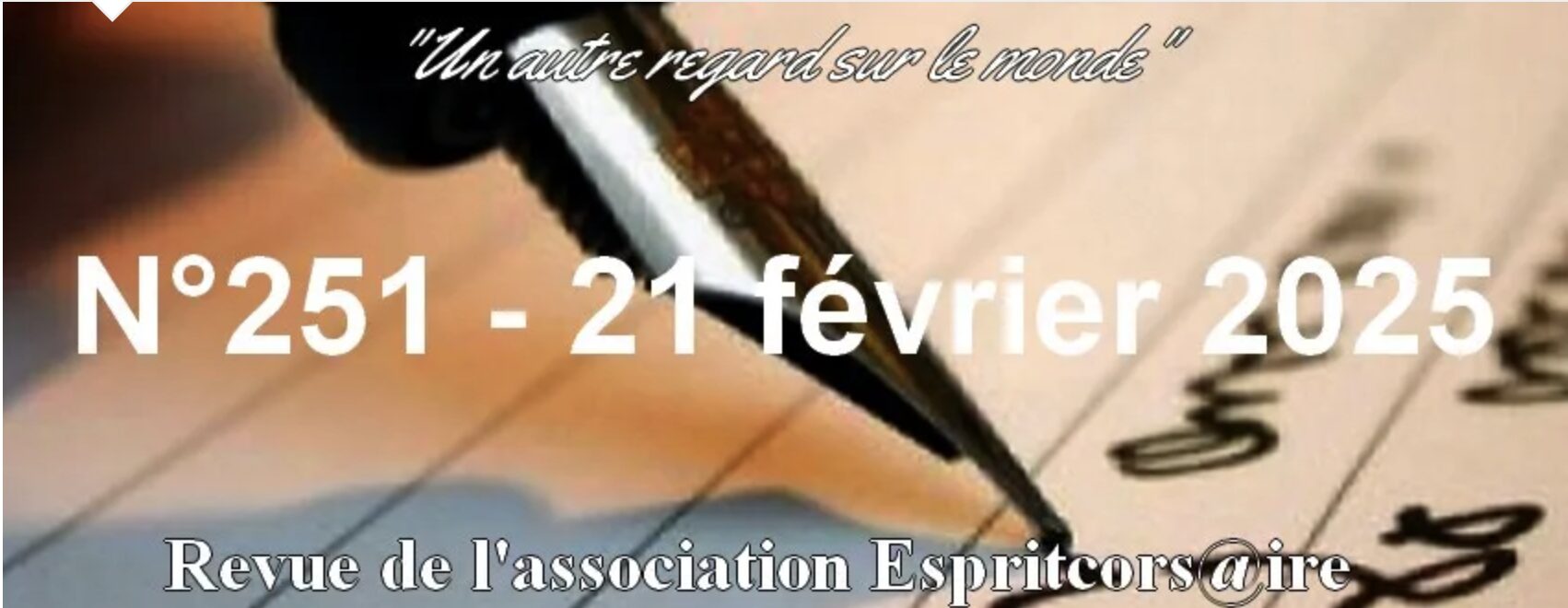

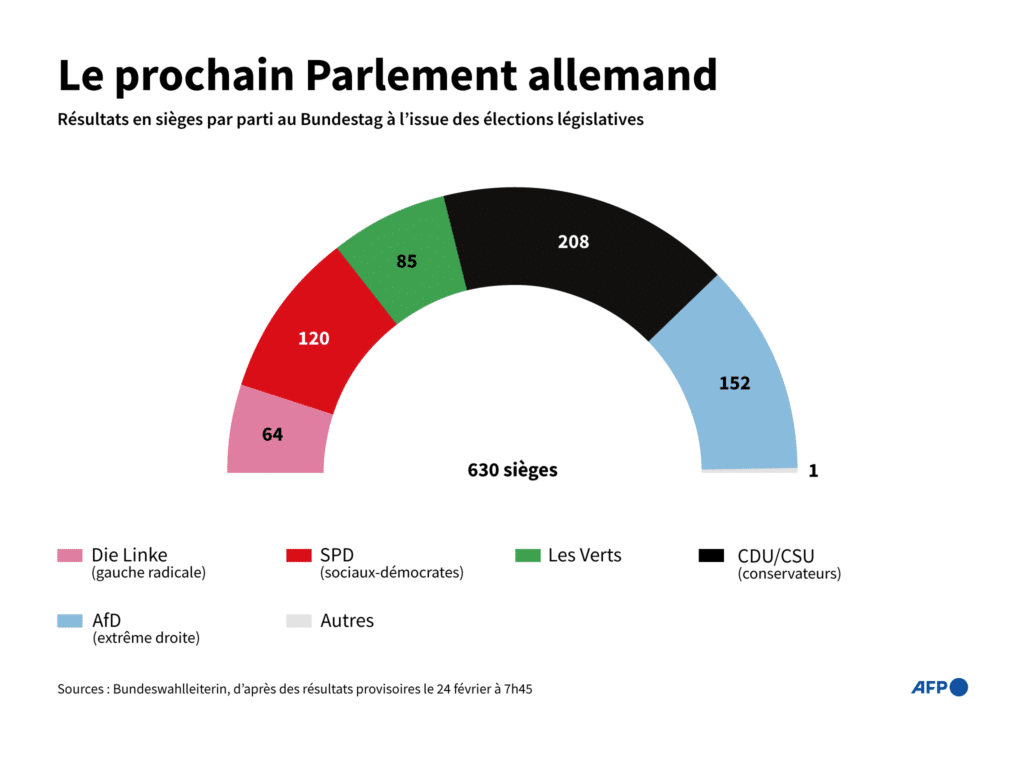
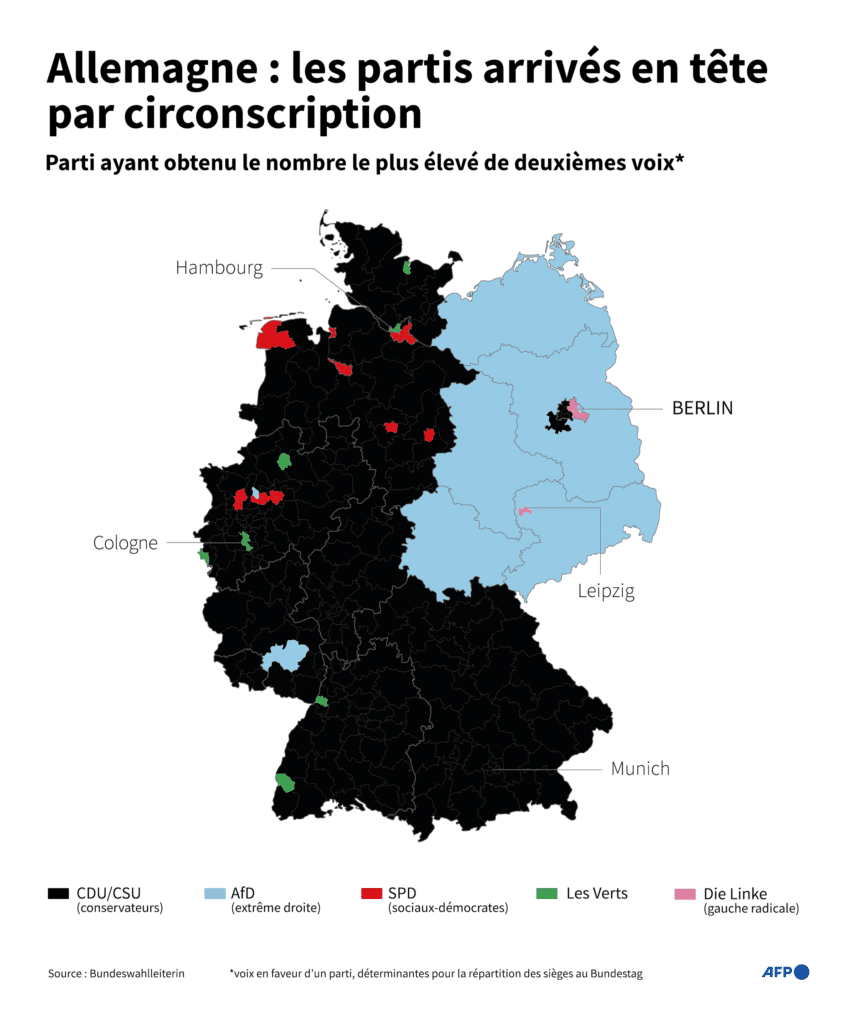
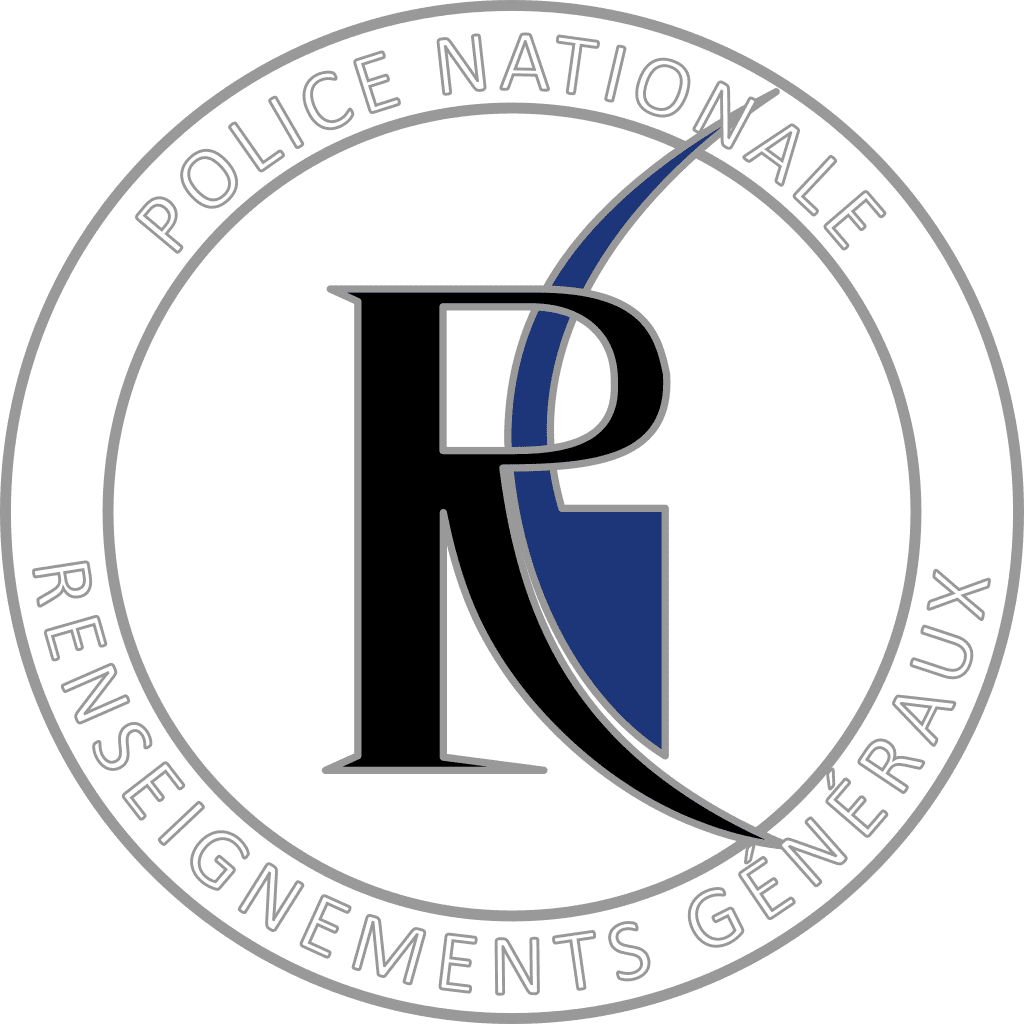




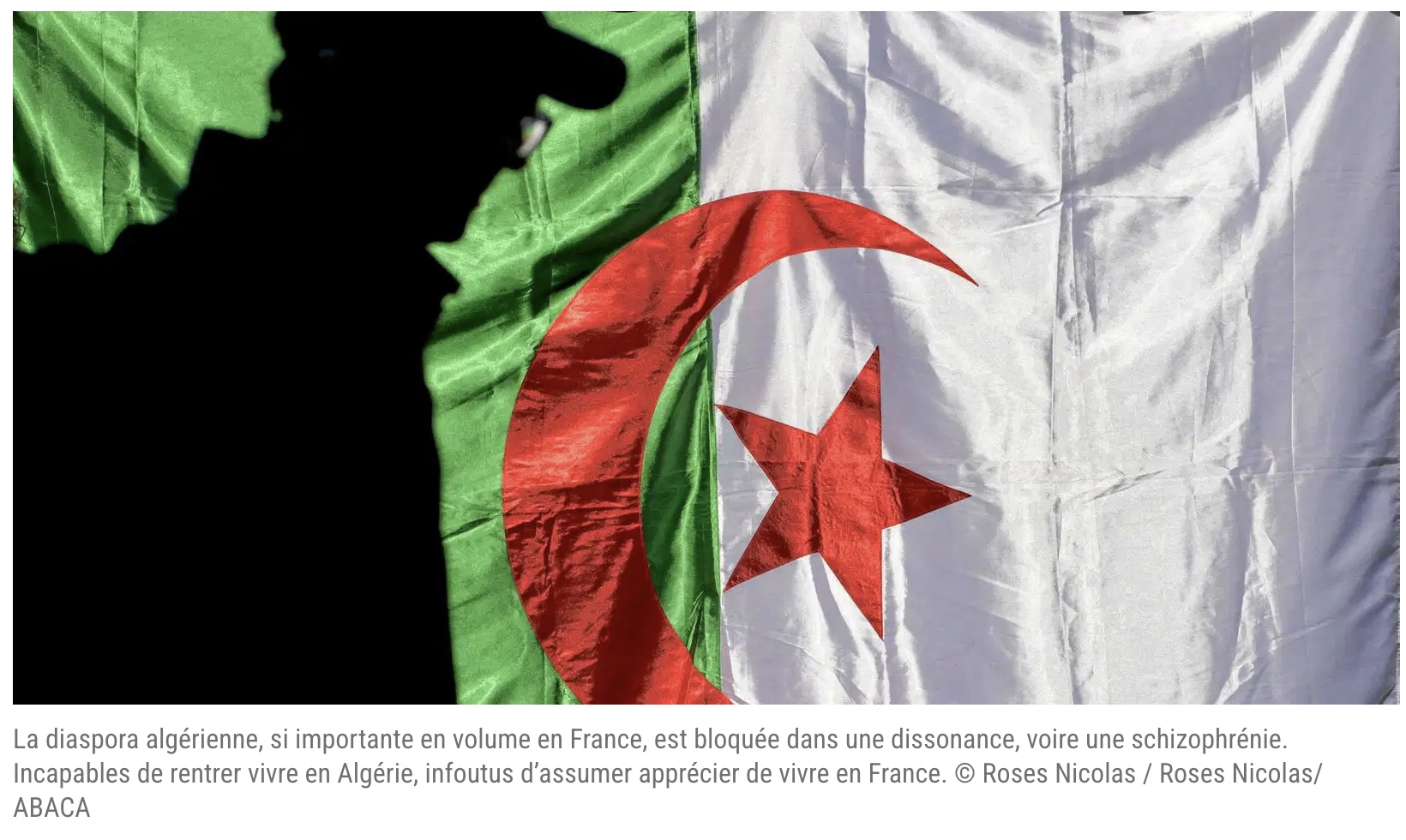
Alors que le président ukrainien rappelait que l’invasion russe remontait à l’annexion de la Crimée en 2014 et que l’Ukraine a déjà signé un cessez-le-feu que la Russie n’a pas respecté, le vice-président américain J.D. Vance l’a violemment interrompu, lui reprochant de plaider sa cause devant les médias américains, exigeant qu’il remercie Trump pour son soutien et insistant sur le fait que l’Ukraine manquait de soldats.
La forme est choquante.
L’objet du débat n’a pourtant rien de trivial.
Il est crucial pour l’Ukraine et pour l’Europe : un cessez-le-feu — que Donald Trump veut obtenir au plus vite — doit-il être précédé de garanties de sécurité ?
Du côté ukrainien et européen, on craint que tout accord qui ne serait qu’un gel des lignes de front — une sorte de Minsk — ne serve qu’à permettre à la Russie de se réarmer et regrouper dans un moment où son économie montre des signes de faiblesse.
Cette séquence, assez visiblement orchestrée, intervient alors que, dans les dix derniers jours, Donald Trump a traité Zelensky de dictateur et que les États-Unis ont voté aux Nations Unies avec la Russie et la Corée du Nord contre une résolution demandant la fin des hostilités ainsi qu’une résolution pacifique du conflit et réaffirmant l’engagement de l’organisation pour l’intégrité territoriale du pays.
Elle a fait réagir la plupart des chancelleries européennes en soutien à l’Ukraine dans la soirée.
Un haut fonctionnaire européen a déclaré au Grand Continent dans la soirée qu’il s’agissait « d’une embuscade pour les caméras ».
En diplomatie, chaque mot compte — ils comptent même double lorsqu’ils sont prononcés face caméra. Pour que chacun puisse avoir connaissance de ceux qui viennent d’être prononcés à Washington, de leur brutalité mais aussi de leur portée, nous publions une transcription non altérée, non éditée des échanges.