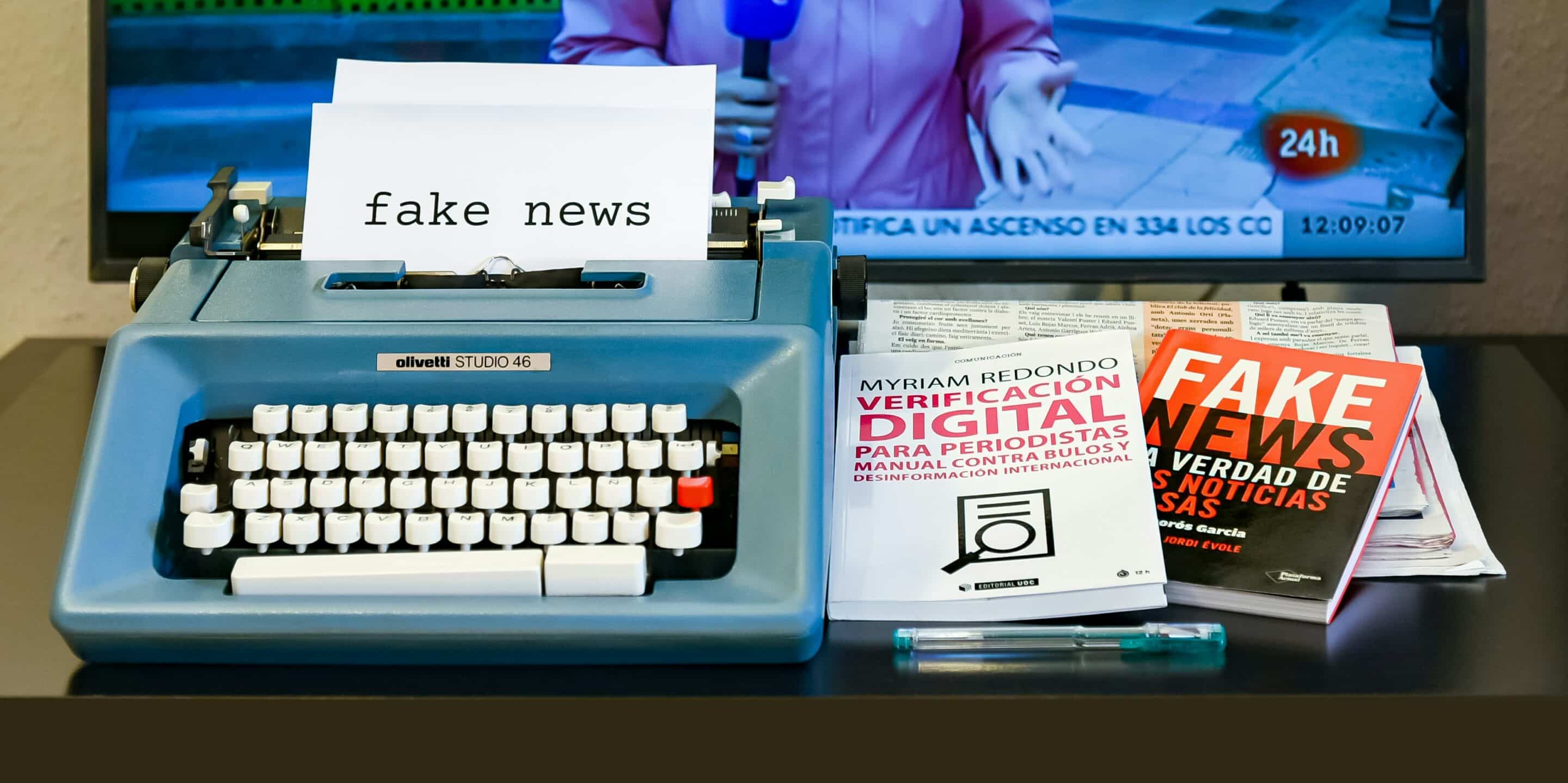La lutte contre la désinformation se concentre souvent sur des mesures à court terme, en la traitant comme un problème isolé. Cependant, cette approche néglige les causes profondes telles que la solitude, la défiance envers les institutions et la polarisation sociale. Il est crucial de compléter les réponses immédiates par des politiques de fond pour traiter ces origines structurelles.
La lutte contre la désinformation se focalise souvent sur son atténuation immédiate, la traitant comme un fléau isolé, alors qu’elle est le symptôme de dysfonctionnements profonds dans nos écosystèmes sociaux et institutionnels. En effet, la diffusion, la force de persuasion et l’efficacité de la désinformation reposent principalement sur l’épidémie de solitude, la défiance grandissante envers les institutions et les médias, ainsi que sur l’intensification de la polarisation, des tensions entre groupes et de la précarité économique. Il est en conséquence impératif de compléter les réponses curatives spécifiques à court et moyen terme actuellement déployées par des politiques de fond, capables de traiter directement le mal à la racine.
La guerre de l’information a été déclarée. C’est du moins la perception qui prévaut, le Forum économique mondial identifiant la désinformation comme le plus important risque global à court terme dans son rapport 2025 [1]. Cette préoccupation est partagée au niveau institutionnel international : l’Organisation mondiale de la santé qualifie la prolifération de fausses informations d’« infodémie » [2], et Richard Stengel, ancien sous-secrétaire d’État américain à la diplomatie publique, évoquait dès 2019 une « guerre de l’information » [3]. Sur le plan national, la France multiplie les initiatives face à cette menace, l’exemple le plus récent étant la nomination d’une conseillère dédiée à la lutte contre la désinformation au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Si l’ingérence informationnelle est aussi ancienne que la guerre elle-même, le sursaut actuel s’explique par une recrudescence d’actes d’ingérence récents : pour ne citer que les plus emblématiques, le scandale Cambridge Analytica – impliqué dans l’élection de Donald Trump en 2016 [4], via l’exploitation massive de données personnelles -, ou encore l’opération « Matriochka », détectée par VIGINUM en France [5], visant à relayer de faux contenus pro-russes via un réseau de sites et de comptes fictifs se faisant passer pour des médias locaux.
Lignes de défense immédiates : Soigner les symptômes, ignorer la fièvre.
À l’instar de plusieurs démocraties occidentales, l’État français a engagé une série de mesures pour se doter d’armes dans le champ cognitif. Un premier axe vise les producteurs de désinformation, à travers leur identification, leur traçabilité et, lorsque possible, leur neutralisation. La création de VIGINUM en 2021 s’inscrit dans cette logique : ce service technique rattaché au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale a pour mission de détecter et d’analyser les opérations de manipulation informationnelle d’origine étrangère – une réponse structurelle à une menace désormais constante. À l’échelle européenne, le Digital Services Act (2022) impose aux très grandes plateformes numériques une obligation de vigilance : évaluer, documenter et atténuer les risques systémiques liés aux contenus nuisibles. Ce texte prévoit notamment un code de bonnes pratiques pour encadrer la désinformation et limiter l’amplification algorithmique des contenus mensongers. Mais sa mise en œuvre reste semée d’embûches : définitions juridiques floues, responsabilités diluées, et frilosité réglementaire sur certains volets freinent encore sa portée réelle.
Un second volet de mesures cible spécifiquement les consommateurs de désinformation afin de renforcer la « résilience » de la population française face aux ingérences informationnelles. L’idée est de rendre les citoyens moins crédules et plus vigilants pour qu’ils puissent distinguer eux-même les informations fiables de celles ne l’étant pas. Parmi ces nombreux dispositifs inspirés des sciences comportementales, plusieurs interventions peu coûteuses et complémentaires sont efficaces. Par exemple, l’inoculation – ou « prebunking » – consiste à exposer le public à une version atténuée des arguments mensongers, renforçant ainsi sa capacité à repérer et à contrecarrer les fausses informations, de la même manière qu’un vaccin prépare le système immunitaire à combattre une infection. Une étude de Roozenbeek et al. (2022) a ainsi démontré que de courtes vidéos animées présentant des tactiques de manipulation amélioraient significativement la capacité des utilisateurs à distinguer les fake news des informations véridiques [6]. Une deuxième approche fréquente consiste en des formations à la littératie médiatique et à la pensée critique, pour doter les citoyens d’outils d’évaluation de la crédibilité des sources. Une étude randomisée aux États-Unis et en Inde a ainsi révélé qu’un module de formation à l’esprit critique permettait de réduire de 20 à 25 % l’acceptation des fausses nouvelles [7]. Enfin, les nudges – ces « coups de pouces » à l’esprit pouvant être intégrés directement aux interfaces – encouragent des comportements plus réfléchis avant de partager du contenu, comme l’initiative « lire avant de retweeter » sur Twitter, qui a significativement freiné la diffusion de contenus mensongers [8].
Pourtant, ces interventions demeurent, dans leur grande majorité, centrées sur la gestion immédiate du symptôme, abordant la désinformation comme un phénomène isolé que l’on pourrait endiguer à coups de correctifs techniques ou éducatifs. Mais la désinformation n’est pas qu’un objet à combattre en aval : elle est le miroir, souvent déformant mais révélateur, de fractures plus profondes au sein de nos sociétés – solitude, défiance, désengagement, précarité. La traiter uniquement comme une anomalie à rectifier, c’est verser sans fin dans le tonneau des Danaïdes, s’épuiser à colmater sans jamais tarir la source [9]. Il devient dès lors urgent de déplacer le regard vers les causes structurelles qui alimentent sa persistance et son pouvoir de persuasion, et d’engager des politiques de fond, capables d’agir en amont, là où le mal prend racine.
Solitude, défiance, inégalités : les racines sociales de la vulnérabilité face à la désinformation.
Qui croit à la désinformation ? Et pourquoi celle-ci semble-t-elle se propager plus vite, frapper plus fort, et diviser plus profondément qu’auparavant ? La recherche contemporaine converge vers un constat : la désinformation n’opère pas dans un vide. Sa réception et sa diffusion sont moins le produit d’une naïveté individuelle que d’un terreau social fertile, fait de solitude, de défiance, de détresse ou de polarisation. Autrement dit, la croyance en des récits faux, partiels ou manipulateurs n’est pas un « accident de parcours » cognitif, mais souvent une réponse – parfois même une stratégie de survie [10] – face à des contextes marqués par l’exclusion ou le désenchantement. Si les interventions actuelles (vérification des faits, régulation des plateformes, éducation aux médias) permettent de contenir les symptômes, elles restent insuffisantes tant qu’elles ne s’attaquent pas aux conditions sociales, économiques et politiques qui rendent certains publics plus réceptifs à ces récits trompeurs. C’est à ces facteurs structurels de vulnérabilité à la désinformation que nous nous tournons maintenant.
La désinformation s’enracine d’abord là où les liens sociaux se sont effondrés et où le mal-être psychique prolifère. De nombreuses études convergent vers un même constat : la solitude chronique et la souffrance mentale affaiblissent les « défenses » cognitives, rendant les individus plus perméables aux récits complotistes. Une étude longitudinale publiée dans Nature Communications [11], portant sur plus de 2 000 participants suivis sur trois décennies, révèle que les personnes ayant souffert de solitude à l’adolescence ou dont l’isolement s’est aggravé avec le temps sont significativement plus susceptibles d’adhérer à des visions complotistes à l’âge adulte. L’isolement n’est pas seulement un manque de relations : il engendre un sentiment de perte de contrôle, que certaines personnes compensent en se tournant vers des récits qui offrent une grille d’explication et un sentiment d’appartenance. Cette dynamique s’est intensifiée durant la pandémie de COVID-19 : les confinements ont exacerbé l’isolement, et une autre étude, réalisée en 2022 [12] montre que la solitude pendant cette période prédisait la croyance aux théories du complot liées au virus, en lien avec des expériences paranoïaques légères. Le besoin de sens, dans un monde perçu comme chaotique et menaçant, pousse alors vers des récits alternatifs, fussent-ils mensongers. Or, la solitude n’est pas une condition marginale : elle est alimentée par le déclin des formes traditionnelles d’engagement [13], la hausse des foyers monopersonnels, l’éclatement des réseaux de proximité, et, selon certains, par la substitution des relations physiques par des connexions numériques, souvent creuses. Par exemple, aux États-Unis, la proportion de personnes dînant seules chaque soir a doublé entre 2000 et 2023, passant de 15 % à 30 % [14]. À cela s’ajoutent un urbanisme du repli et des rythmes de travail fragmentés, qui laissent peu de place à la sociabilité.
À cette fragilisation individuelle s’ajoute une dynamique plus systémique : la défiance envers les institutions, nourrie par des décennies de scandales, de promesses trahies et de fractures politiques, affaiblit les garde-fous informationnels et favorise la circulation de contenus non vérifiés. Lorsque l’autorité est perçue comme corrompue ou indifférente, ce sont les sources marginales – souvent porteuses de désinformation – qui gagnent en crédibilité. Une vaste enquête menée dans 21 pays [15] a montré que la méfiance envers les gouvernements et les autorités sanitaires prédisait fortement l’adhésion aux fausses informations sur la COVID-19. Or, en France, seuls 34 % des citoyens déclaraient en 2023 faire confiance à leur gouvernement, un chiffre nettement inférieur à la moyenne de l’OCDE (39 %) [16] – symptôme d’une défiance structurelle qui fragilise les fondements démocratiques. Ce phénomène s’auto-entretient : moins on fait confiance aux médias traditionnels, plus on se tourne vers des canaux alternatifs, souvent biaisés. Ainsi, seuls 32 % des Français estiment encore pouvoir faire confiance à ce que disent les médias sur les grands sujets d’actualité. Comme le rappelle Sacha Altay, cognitiviste français spécialiste de la désinformation, la majorité des vérifications factuelles étant publiées par ces mêmes médias, elles sont perçues comme suspectes par ceux-là même qui en auraient le plus besoin. Là où la confiance est rompue, l’efficacité des correctifs s’effondre.
Sur ce terreau de défiance croissante prospèrent les conflits identitaires et la polarisation politique. La dynamique partisane et les tensions intergroupes déforment les perceptions, brouillent le jugement, et renforcent l’adhésion à des récits partisans – qu’ils soient vrais ou faux. Plus la distance affective entre les groupes s’accroît, plus les individus acceptent sans réserve les informations qui confortent leur camp, tout en rejetant a priori celles issues du camp opposé. Une étude scientifique marquante [17] montre que les personnes les plus polarisées sur le plan émotionnel sont aussi les plus enclines à croire des informations favorables à leur parti, même lorsqu’elles sont fausses – y compris, paradoxalement, parmi les individus les plus politisés. Dans les contextes de tension entre groupes ethniques, religieux ou nationaux, la désinformation devient un instrument stratégique : elle attise les peurs, légitime l’hostilité, et prépare le terrain à des violences bien réelles. Ainsi, les campagnes russes de désinformation sur les réseaux sociaux ciblaient délibérément les lignes de fracture raciales et religieuses aux États-Unis, en diffusant de faux récits conçus pour exacerber les antagonismes [18]. Le débat public cesse alors de reposer sur la recherche de vérité : il devient un champ de loyautés conflictuelles, imperméables aux rectifications les plus rigoureuses.
Enfin, la précarité économique et l’aggravation des inégalités nourrissent puissamment cette vulnérabilité collective à la désinformation. Lorsque les conditions de vie se détériorent et que les perspectives s’évanouissent, l’espace mental se rétracte – laissant place aux récits simplificateurs, souvent fallacieux, qui offrent des coupables, une explication et un sens. Ainsi, les croyances conspirationnistes sont plus répandues dans les sociétés marquées par une faible croissance et de fortes inégalités [19]. Ces théories fonctionnent comme des catalyseurs émotionnels : elles transforment un sentiment diffus d’injustice en grille de lecture, parfois en appel à la revanche. Dans ces contextes, la désinformation ne promet pas seulement une explication : elle offre une riposte symbolique à un système vécu comme inique. La crise informationnelle, ici, n’est que l’écho d’une crise sociale plus profonde, où la désillusion prépare le terrain à la crédulité.
Plus inquiétant : ces dynamiques ne se juxtaposent pas, elles s’entrelacent et s’intensifient. La solitude prédit la défiance, qui elle-même alimente la polarisation ; les inégalités et l’absence de mobilité sociale creusent une méfiance structurelle envers les élites. Face à cette spirale, il ne suffit pas de corriger les contenus : seules des politiques de fond – sociales, économiques, éducatives – peuvent restaurer les conditions de la confiance, sans lesquelles aucun écosystème informationnel ne peut tenir.
De la réaction à la prévention : reconstruire un écosystème informationnel et cognitif résilient.
Combattre la désinformation suppose d’agir non seulement sur ses manifestations visibles, mais sur les conditions structurelles qui favorisent son enracinement. Cela implique de reconstruire la confiance institutionnelle, retisser les liens sociaux, réduire les inégalités et apaiser les clivages politiques. La restauration de la confiance passe par une gouvernance plus transparente : publication systématique des données publiques, traçabilité des financements politiques, sanctions effectives en cas de conflits d’intérêts. Elle suppose aussi des dispositifs de participation citoyenne concrets, comme les budgets participatifs à l’échelle locale ou les jurys citoyens délibératifs dans les grandes politiques publiques, qui renforcent le sentiment d’écoute et de représentation. Contre l’isolement, il s’agit de revitaliser les espaces de sociabilité – bibliothèques, maisons de quartier, cafés associatifs – et d’étendre les dispositifs de prescription sociale, où les soignants orientent vers des activités collectives plutôt que vers des traitements médicamenteux. Sur le front économique, le renforcement des filets de sécurité, la relance de la formation continue et des investissements ciblés dans les territoires laissés pour compte – à l’image du Just Transition Fund en Europe – permettent de désamorcer les récits de trahison et de bouc-émissaire [20]. Enfin, pour atténuer la polarisation, des programmes de rencontres intergroupes – échanges scolaires entre zones opposées socialement ou politiquement, projets civiques co-construits entre habitants de quartiers différents – ont montré leur efficacité pour réduire les stéréotypes et ouvrir à d’autres récits. Ces politiques de fond ne relèvent pas d’une stratégie parallèle à la lutte contre la désinformation : elles en sont la condition. À l’heure où les États réinvestissent massivement dans le champ sécuritaire, il serait périlleux d’affaiblir l’État social. Car c’est précisément sur ses piliers – confiance, égalité, solidarité – que repose l’immunité démocratique face aux fausses vérités.
Ces politiques de long terme, exigeantes et structurelles, doivent être complétées par des leviers plus ciblés, moins coûteux, et déployables à moyen terme, notamment dans le champ médiatique. Pour restaurer la confiance dans les médias – fondement d’un espace public sain – deux axes d’action s’imposent. D’une part, renforcer l’indépendance et la régulation du secteur : cela implique de lutter contre la concentration des groupes de presse, de doter l’ARCOM de véritables moyens d’investigation, mais aussi de créer un statut indépendant d’ombudsman médiatique, garant de la transparence et de la déontologie journalistique. D’autre part, il est crucial de soutenir activement le journalisme local, dont l’effacement a laissé le terrain libre aux rumeurs, à la défiance et à la désaffiliation civique. Là où les titres de proximité disparaissent, les fake news se répandent plus facilement, la participation démocratique s’érode, et les citoyens perdent le lien avec leur environnement immédiat. Des aides publiques pérennes, des incitations fiscales ciblées, ou encore des fonds d’innovation territoriale pourraient redonner souffle à ces acteurs décisifs de la vie démocratique [21]. Il ne suffit pas de traquer les fausses informations : il faut investir dans les conditions de leur marginalité. Car dans l’asymétrie structurelle entre la vitesse virale d’une rumeur et la lenteur coûteuse de sa réfutation, seule une information robuste, proche et digne de confiance peut durablement contenir la désinformation – et de telles politiques doivent donc être déployées en complément de celles aujourd’hui mises en oeuvre.
En conséquence, dans la lutte contre la désinformation, il ne suffit pas d’éteindre les départs d’incendies : encore faut-il assainir les sous-sols. Car tant que la solitude, la défiance et l’injustice continueront de miner nos fondations collectives, les fausses vérités y trouveront toujours un terreau fertile – prêtes à reprendre feu à la moindre étincelle.
Références :
- Elsner, M., Atkinson, G., & Zahidi, S. (2025). Global risks report 2025 (20th ed.). World Economic Forum. https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2025/
- https://www.who.int/health-topics/infodemic#tab=tab_1
- Richard Stengel, Information Wars. How We Lost the Global Battle Against Disinformation and What Can We Do About It, New York, Grove Press, 2019, p. 13.
- Wylie, Christopher (October 2019). Mindf*ck: inside Cambridge Analytica’s plot to break the world. London, United Kingdom: Profile Books. ISBN978-178816-506-8. Export edition.
- (2024). Matriochka: Une campagne prorusse ciblant les médias et la communauté des fact-checkers. Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
- van der Linden, S., Roozenbeek, J., & Compton, J. (2022). Inoculation theory: Using misinformation vaccines to prebunk misinformation and fake news. _Harvard Kennedy School Misinformation Review, 1_(Preprint). https://doi.org/10.37016/mr-2020-8; Roozenbeek, J., & van der Linden, S. (2024). _The psychology of misinformation._ Cambridge University Press.
- Guess A, Lerner M, Lyons B, et al. A digital media literacy intervention increases discernment between mainstream and false news in the United States and India. Proceedings of the National Academy of Sciences 2020; 117: 15536–15545.
- Pennycook G, Epstein Z, Mosleh M, et al. Shifting attention to accuracy can reduce misinformation online. Nature 2021; 592: 590–595.
- Altay, S. (2022). _How effective are interventions against misinformation?_ PsyArXiv Preprint. https://doi.org/10.31234/osf.io/sm3vk
- Mercier H. Not Born Yesterday : The Science of Who We Trust and What We Believe. Princeton University Press, 2020.
- Bierwiaczonek, K., Fluit, S., von Soest, T., & Hornsey, M. J. (2024). Loneliness trajectories over three decades are associated with conspiracist worldviews in midlife. _Nature Communications, 15_(1), Article 3629. https://doi.org/10.1038/s41467-024-47113-xTerenzi et al. (2022)
- Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Touchstone Books/Simon & Schuster. https://doi.org/10.1145/358916.361990
- Turkle, Sherry. (2011). Alone together : why we expect more from technology and less from each other. New York :Basic Books
- Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D.,De Neve, J.-E., Aknin, L. B., & Wang, S. (Eds.). (2025). World Happiness Report 2025. University of Oxford: Wellbeing Research Centre. Cité par Y. Algan.
- Roozenbeek, J., Schneider, C. R., Dryhurst, S., Kerr, J., Freeman, A. L. J., Recchia, G., van der Bles, A. M., & van der Linden, S. (2020). Susceptibility to misinformation about COVID-19 around the world. Royal Society Open Science, 7_(10), 201199. https://doi.org/10.1098/rsos.201199.
- (2024). Enquête de l’OCDE sur les déterminants de la confiance dans les institutions publiques – Résultats 2024. Organisation de coopération et de développement économiques. © OCDE.
- Jenke, L. (2023). Affective Polarization and Misinformation Belief. Political Behavior. https://doi.org/10.1007/s11109-022-09851-w
- Freelon, D., & Lokot, T. (2020). Russian Twitter disinformation campaigns reach across the American political spectrum. Harvard Kennedy School (HKS) Misinformation Review. https://doi.org/10.37016/mr-2020-003
- Casara, B. G. S., Suitner, C., & Jetten, J. (2022). The impact of economic inequality on conspiracy beliefs. Journal of Experimental Social Psychology, 98, 104245. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2021.104245
- https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/just-transition-fund_en
- Bateman, J., & Jackson, D. (2024). Countering disinformation effectively: An evidence-based policy guide. Carnegie Endowment for International Peace.