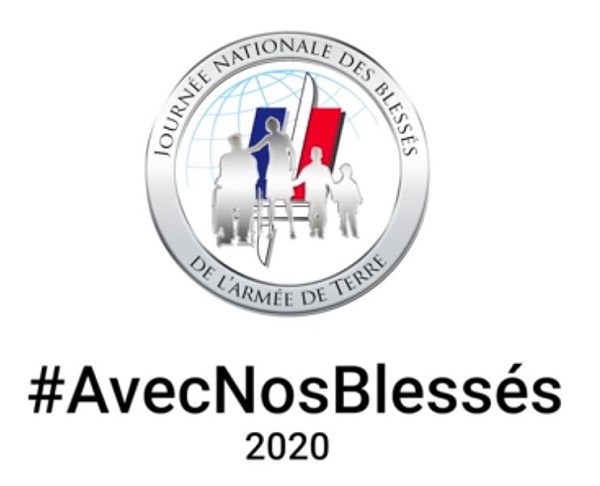Quelles sont tout d’abord les caractéristiques de cette crise ? J’en identifie deux principales. La première est que l’armée de Terre a dû composer avec deux impératifs apparemment contradictoires : protéger nos soldats contre le virus et continuer de préparer nos opérations. L’impératif le plus évident est de protéger nos soldats contre le virus et d’éviter que ces derniers participent à sa diffusion en interne, dans nos unités, et en externe, dans le reste de la population. Cette priorité que nous nous sommes fixés a été confirmée par la ministre des Armées. Pour autant, le télétravail n’a pas grand sens pour 80 % des militaires de l’armée de Terre. De même, d’un régiment à l’autre, nous devons également prendre en compte de multiples métiers et des configurations de casernes très différentes. Il a donc fallu inventer une nouvelle manière de travailler qui a changé le quotidien de toute l’armée de Terre. Grâce à l’autonomie laissée à nos formations, l’armée de Terre a su trouver des solutions adaptées pour protéger ses soldats.
L’autre impératif, qui est aussi une priorité, est de préparer le mieux possible mes hommes à s’engager. Vos propos introductifs rappellent que nos opérations se poursuivent et qu’elles ne sont pas moins dangereuses. Or une contamination massive de l’armée de Terre ne permettrait plus de remplir nos missions. Ces deux impératifs qui sont moins contradictoires qu’il n’y paraît doivent donc être combinés. Protéger nos hommes et nos femmes du virus ne suffit pas car le Covid n’arrête pas nos ennemis. Vis-à-vis de la Nation, l’armée de Terre a le devoir d’être prête à s’engager en opérations. J’ai aussi un devoir vis-à-vis de mes hommes qui doivent être déployés avec toutes les chances de réussir leurs missions. Pour concilier ces deux exigences, il faut faire preuve de pédagogie, en interne et en externe, car certains se sont étonnés que nos soldats continuent de s’entraîner au lieu de rester confinés. Il s’agit bien de préparer nos soldats à l’exécution des missions que le Gouvernement nous confie. Et en voulant les protéger à court terme contre le risque du Covid, en stoppant tout entraînement, nous leur ferions prendre, ultérieurement, des risques plus grands en opérations.
En outre, cette crise a exigé de la réactivité et de l’imagination. Cette réactivité de l’armée de Terre a d’abord consisté, le temps d’évaluer la situation, à « jeter un premier dispositif » permettant de faire face à toutes les options possibles. Avant même le lancement de l’opération Résilience, une mise en alerte a été déclenchée pour se préparer à d’éventuelles prochaines missions, tout en renforçant et en adaptant le fonctionnement pour protéger nos soldats. Il s’agissait de se tenir prêts à déployer sans délai les militaires et les moyens dont le pays avait besoin et d’adapter les activités de formation et de préparation opérationnelle indispensables à nos unités. Être capables de produire un engagement important en hommes et en matériels au profit de l’opération Résilience était bien notre objectif. Personne n’aurait compris que l’armée de Terre reste confinée et n’intervienne pas pour aider nos concitoyens et appuyer la résilience de l’État.
Il a également fallu être imaginatif pour soutenir au mieux les Français et les services de l’État. Il n’existe aucun manuel pour qu’une section d’infanterie agisse en appui d’un hôpital. Nous avons donc engagé un dialogue étroit avec les acteurs locaux pour répondre à leurs attentes.
Des sections ont aussi été déployées pour monter des tentes à l’entrée de certains EHPAD pour permettre aux visiteurs de s’équiper avant de retrouver leurs aînés. Vous vous en doutez, cela ne s’improvise pas et nécessite un vrai dialogue entre civils et militaires.
Je voudrais maintenant vous faire une appréciation de situation sur l’engagement de l’armée de Terre et sur les conséquences de la crise sur notre armée.
Auparavant, je voudrais dire combien les soldats de l’armée de Terre sont admiratifs devant l’action du personnel de santé ; ils ont mesuré la force de leur engagement et l’ampleur des risques qu’ils prennent. C’est admirable et nous étions heureux de les aider et de les appuyer.
Dans cette crise, l’engagement de l’armée de Terre a été « multi-domaines », sur un très large spectre de missions. L’opération Résilience est beaucoup plus diverse que Sentinelle. En effet, l’armée de Terre s’est déployée depuis l’Assemblée nationale jusqu’à des hôpitaux de toutes petites villes, en passant par des entreprises et des centres d’action sociale. L’armée de Terre a ainsi montré qu’elle était un peu « l’armée des territoires », s’appuyant sur la densité de son maillage géographique.
Pour vous donner quelques exemples de la diversité des missions, nous avons appuyé les structures médicales et hospitalières par des unités d’active et des unités de réserve, en particulier à Paris. Vous avez cité le 2e régiment étranger de génie à l’hôpital de La Conception. Des militaires, spécialisés dans le secourisme, au 68e régiment d’artillerie d’Afrique ont aussi contribué, aux côtés du SAMU, à la régulation médicale à Bourg‑en‑Bresse. Nous avons également apporté un appui logistique auprès des services de l’État en transportant des malades, en distribuant des équipements sanitaires ou en sécurisant des sites sensibles. Tout le monde a vu les évacuations par hélicoptères, une cinquantaine de patients transportés au total. Il y a eu des actions moins visibles comme la distribution de plusieurs dizaines de millions de masques dans l’ensemble du pays. Le 8e régiment de parachutistes d’infanterie de marine a assuré la protection du site hospitalier de Toulouse. Le 92e régiment d’infanterie a assuré la protection de l’hôpital de Limoges et la sécurisation de la livraison de matériels. Mais au-delà des effets produits sur le terrain, la participation de l’armée de Terre à l’opération Résilience a permis la « réassurance » de certaines structures hospitalières, dont le personnel de santé a ressenti, au travers de l’aide des armées, l’appui de l’ensemble du pays. L’armée de Terre doit montrer l’exemple en appuyant psychologiquement la résilience de la nation.
Le 2e régiment de dragons, régiment d’appui NRBC a exécuté 250 opérations de désinfection, principalement d’administrations, et une dizaine d’équipes a été déployée outre‑mer. Son expertise n’aurait pas été maintenue à ce niveau si, dès février, son chef de corps n’avait pas pris l’initiative de constituer des stocks de produits de désinfection !
Une action moins visible a été l’appui aux structures de commandement et de gestion de crise. L’armée de Terre a déployé assez vite des officiers en scolarité à l’école de guerre ou affectés en état-major, en renfort des structures de l’État, comme au ministère des solidarités et de la santé ou dans les agences régionales de santé (ARS), avec lesquelles il a fallu dialoguer et avec lesquelles nous étions assez peu familiarisés.
Je vous ai décrit l’engagement. J’identifie deux facteurs qui l’ont rendu possible : notre chaîne de commandement et le maillage territorial.
Si nos unités ont bien réagi, c’est d’abord lié à une chaîne de commandement, qui est solide, efficace et qui repose sur trois principes : la subsidiarité, le contrôle et l’appui aux subordonnés. Ce triptyque est fondamental pour construire une confiance qui ne se décrète pas mais se travaille en permanence. Dans l’incertitude, nos soldats se tournent vers leur chef et attendent des réponses à leurs interrogations. Dans cette crise, la chaîne de commandement a donc réussi à jouer ce rôle : donner du sens à la mission. C’est ce que nos hommes attendent des chefs : réduire et éclairer l’incertitude.
L’efficacité de la réponse réside également dans notre maillage territorial qui rend possible le contact à tous les niveaux : il y a d’abord Paris au niveau central, il y a ensuite les officiers généraux de zone de défense et de sécurité en contact avec le préfet de zone de défense et de sécurité, il y a enfin les délégués militaires départementaux en contact avec les préfets de département et les chefs de corps avec les maires, les parlementaires, les conseillers régionaux et les chefs d’entreprise.
La dynamique de rayonnement local que nous construisons et que nous entretenons avec soin dans nos garnisons depuis des années, s’est muée, durant cette crise, avec l’aide des acteurs locaux, en dynamique opérationnelle.
Cette crise nous apprend aussi que nous gagnerions à diversifier le panel de nos contacts. Mais n’oublions pas que le rôle du préfet doit rester central, la connaissance interpersonnelle et la confiance mutuelle pouvant accélérer la réponse à la crise.
Je voudrais maintenant évoquer l’impact de la crise sur l’armée de Terre. L’armée de Terre reste en mesure d’exécuter les missions qui lui sont fixées. Pour autant, il ne faut être ni catastrophiste ni naïf mais deux mois de crise Covid avec beaucoup d’activités gelées ne peuvent pas être sans conséquence. Elles sont multiples. Dans le domaine des ressources humaines, l’interruption du recrutement, qui reprendra la semaine prochaine, entraîne un déficit potentiel de mille à deux mille jeunes engagés. Ce retard ne sera pas rattrapé en intégralité mais nous avons pris des mesures pour faciliter les engagements et permettre à ceux qui ne voudraient pas quitter l’armée de rester.
S’agissant de la préparation opérationnelle, nous avons réduit des deux tiers nos activités d’entraînement interarmes et interrompu une bonne partie de nos formations pour nous concentrer sur les relèves et sur l’opération Résilience. Il y a donc un déficit de préparation opérationnelle que nous allons chercher à résorber.
Malgré un entraînement moins important que prévu, nous n’avons pas réduit le niveau d’engagement en OPEX. La prise de risque est maîtrisée pour la relève de juin et devrait être acceptable pour celle de fin d’année. Si le niveau de contrainte continue à être très fort l’an prochain et si le périmètre des opérations change – une nouvelle crise qui se déclare par exemple – la prise de risque sera plus forte et devra être finement évaluée.
La situation du maintien en condition opérationnelle (MCO) apparaît comme satisfaisante à court terme. Les ateliers ont continué de travailler en utilisant les stocks de pièces dont nous disposons. Certains véhicules ayant moins roulé, nous avons donné la priorité technique à des véhicules engagés dans l’opération Résilience. La disponibilité technique opérationnelle (DTO) s’améliore, mais au prix d’un fort recours aux stocks. Si l’industrie de défense ne rouvre pas rapidement les flux, nous serons en difficulté, à moyen terme. Je suis donc très vigilant.
L’armée de Terre est prête à s’engager et à exécuter ses missions. Il y a toutefois des inquiétudes et des incertitudes bien normales. Les soldats se posent les mêmes questions que tous les Français, mais cela ne remet pas en cause l’engagement opérationnel. Nos soldats et leurs familles s’interrogent sur la sortie du confinement, la scolarisation, les vacances d’été et les mutations, etc.
J’en viens maintenant aux enseignements. Le premier, c’est qu’un modèle d’armée complet n’est pas une assurance inutile. Il y a six mois, certains auraient peut-être jugé le 2e régiment de dragons, qui aligne 800 à 900 hommes, un peu trop coûteux. Mais ce n’est pas au moment du déclenchement d’une crise que l’on peut acquérir une telle expertise, rassembler des hommes et des matériels, etc.
Deuxième enseignement : la résilience n’est pas un luxe même si elle ne fait pas toujours bon ménage avec l’efficience. Et l’autonomie stratégique est bien évidemment une composante de cette résilience. Nous devons donc identifier nos équipements les plus stratégiques dont il faudra sécuriser toute la chaîne de valeur. En cas de guerre ou même de crise, nos ennemis feront tout pour nous empêcher de compléter nos stocks de munitions et de pièces de rechange. On ne saurait en constater l’insuffisance, comme cela a été le cas pour les stocks de masques, que seule la loi de l’offre et de la demande nous a empêchés de reconstituer plus rapidement.
Troisième enseignement : notre mode de fonctionnement est devenu trop complexe. L’accumulation de normes et de directives multiples nous empêche de fonctionner de manière souple et réactive. Nous devons retrouver une forme d’agilité au service de l’opérationnel, à l’instar de la procédure des urgences opérationnelles qui nous permet d’obtenir rapidement certains équipements qui nous font défaut. C’est donc possible. L’état d’esprit qui consiste à trouver la solution plutôt que d’expliquer pourquoi les choses ne devraient pas être faites devrait être un peu plus répandu. Beaucoup réglementent mais les armées à qui l’on demande de remplir ses missions en tout temps, en tous lieux, sont enfermées dans un excès de normes. Il faut être vigilant à ce que celles-ci ne nous étouffent pas. C’est une de mes priorités car l’armée de Terre n’est pas exempte de reproches dans ce domaine, nous devons aussi trouver des solutions, simplifier nos procédures et faire évoluer certaines mentalités.
Cette crise inédite n’est pas finie, nous continuerons à vivre sous cette menace, mais le monde n’a pas changé : loin de se substituer aux autres défis sécuritaires, la pandémie peut les exacerber ou en créer de nouveaux. Nous n’en mesurons pas encore toutes les conséquences, notamment économiques. Nous pourrions d’ailleurs être un acteur du plan de relance gouvernemental et nous nous préparons à faire des propositions dans ce sens.
Cette crise conforte mon point de vue sur les orientations du plan stratégique de l’armée de Terre. Le monde est dangereux, la crise contribue à cette dangerosité et un conflit majeur n’est pas improbable – on voit en Libye quelque chose qui s’en approche. Face à une crise majeure, il faut être prêts d’emblée, et il faut être résilients, savoir encaisser les chocs, sinon nous serons balayés.