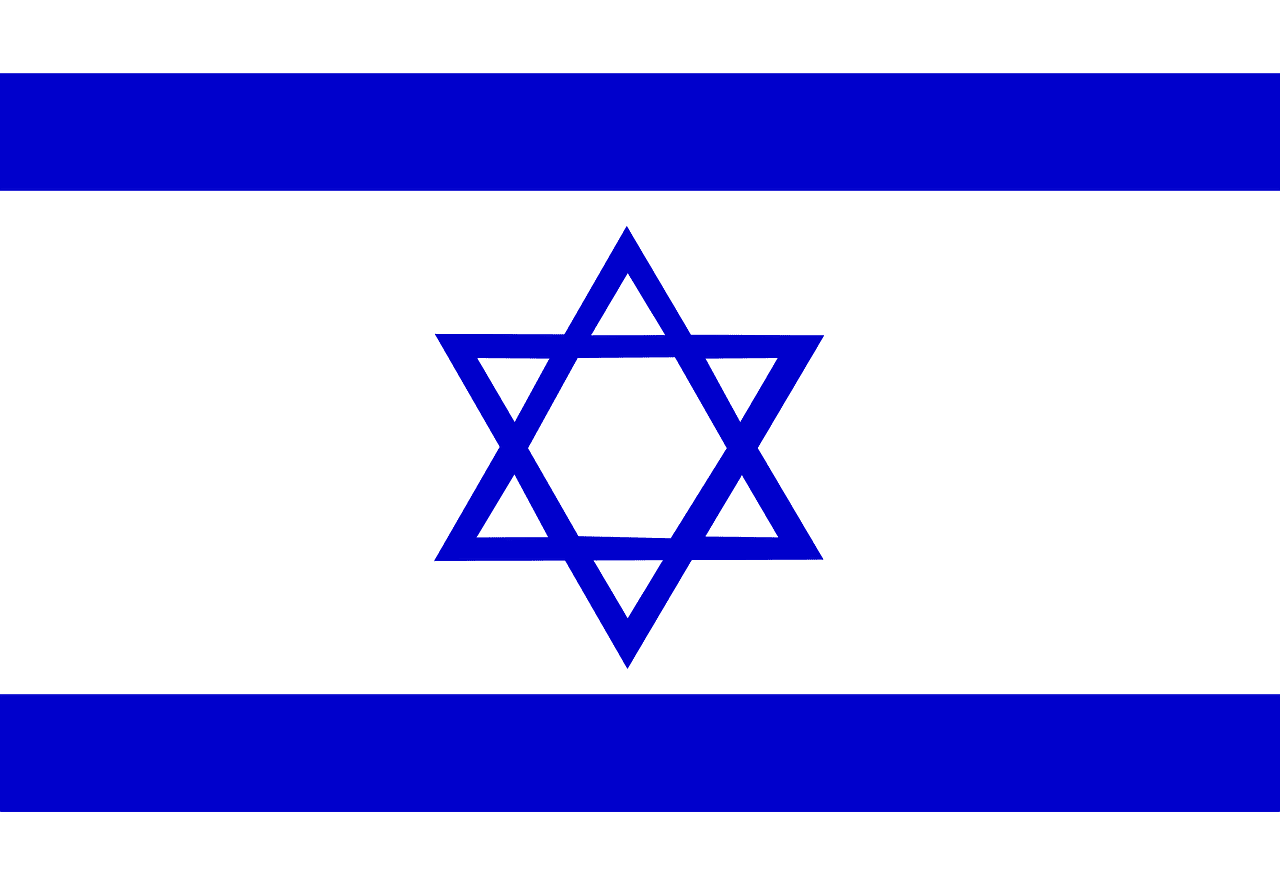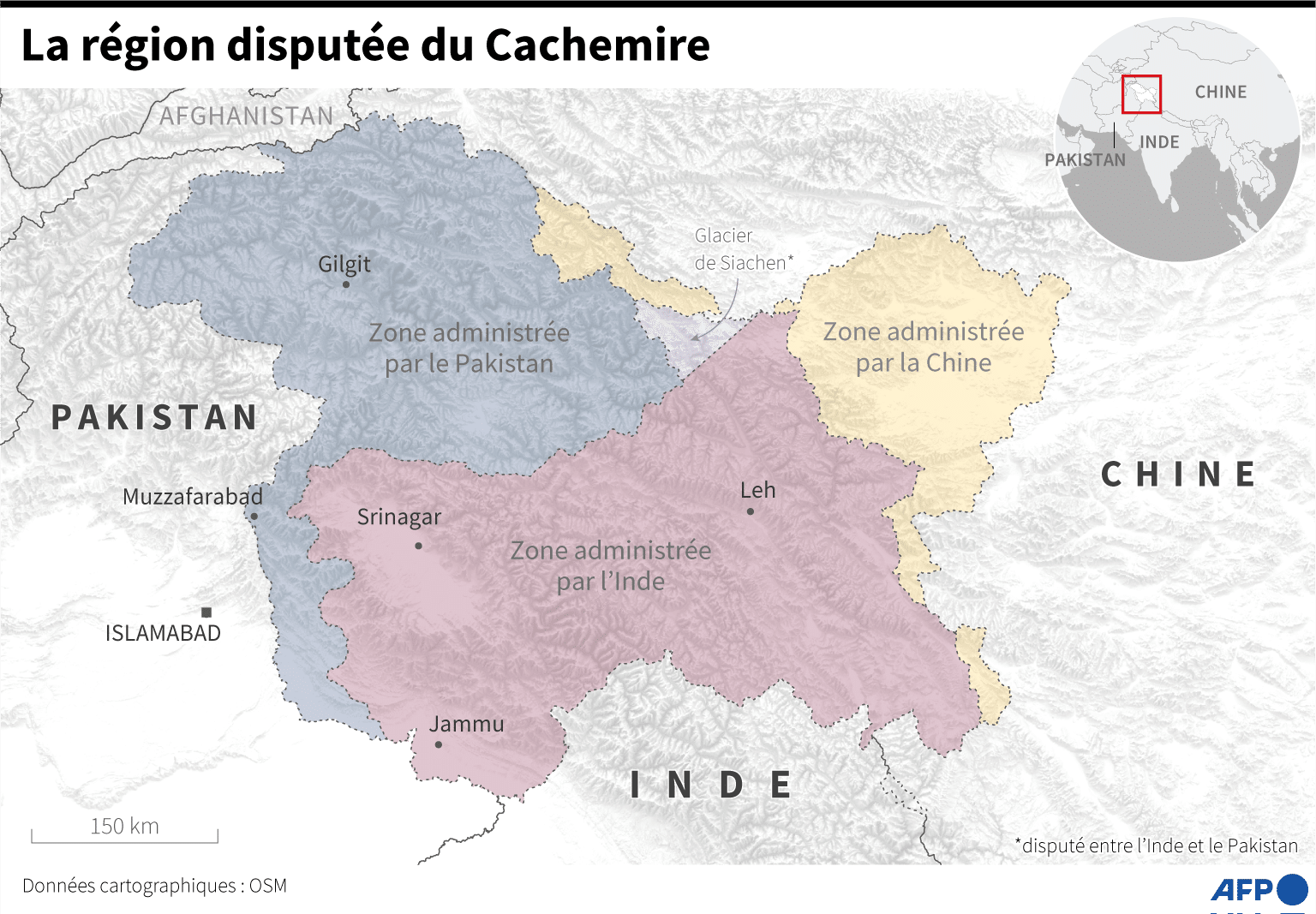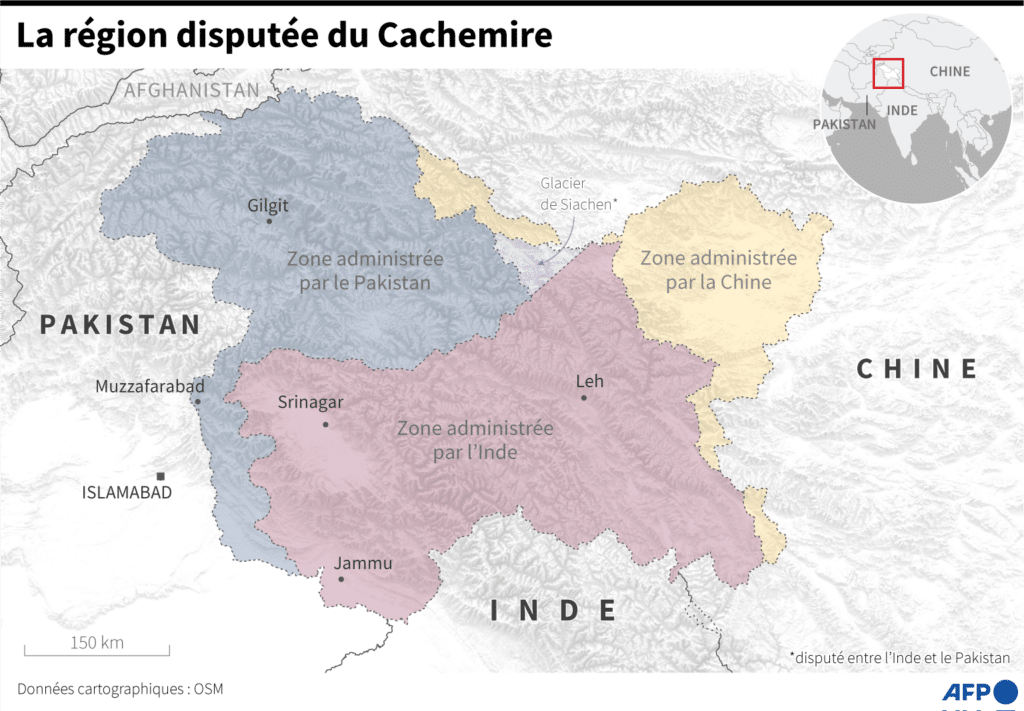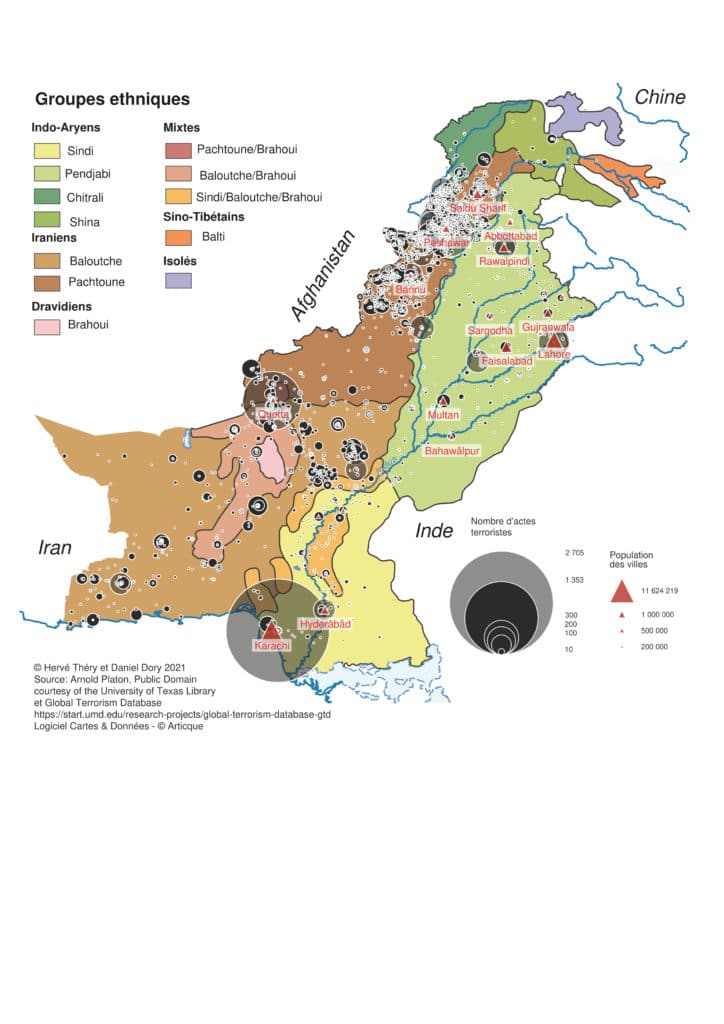Otages : et si l’on parlait du Qatar
Jean Daspry* – CF2R – TRIBUNE LIBRE N°188 / juin 2025
« Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes » (Bossuet). Et, c’est malheureusement le cas de la diplomatie du « en même temps » chère à Emmanuel Macron ! Un jour, il approuve ; le lendemain il condamne. Un jour, il met en avant un principe pour expliquer sa position à l’instant « T » ; le lendemain, il sort de son chapeau un principe opposé pour justifier son évolution à l’instant « T+1 ». Nous avons un exemple éclairant de cette diplomatie du zigzag avec sa politique au Proche et au Moyen-Orient. Le vocabulaire qu’il emploie pour caractériser certains protagonistes du conflit israélo-palestinien est aussi inapproprié que contre-productif. L’on souhaiterait comprendre pour y voir un peu plus clair. Sévère avec l’un, complaisant avec l’autre. Notre idylle avec l’émir du Qatar est aussi touchante que problématique. C’est pourquoi, nous serions bien inspirés d’enseigner sur les bancs des écoles diplomatiques et autres instituts formant les grands serviteurs de la République la faiblesse de la diplomatie française comparée à la force de la diplomatie à la qatarie. Elle pourrait se conceptualiser autour de trois grands axes : influence, compromission et « complicité », concept pris au plus mauvais sens du terme.
Le Qatar ou la diplomatie de l’influence
Certains États se targuent de pratiquer une « diplomatie d’influence » sans en avoir les moyens. D’autres États ne se targuent de rien, mais savent et peuvent y mettre les moyens pour parvenir à leurs fins avouables ou pas. Leur influence est diffuse mais efficace.
Dans cette catégorie, nous rangeons le Qatar, sorte de Janus bifrons. Grâce à ses énormes ressources financières, il peut tout acheter – au sens propre et figuré du terme – biens matériels de grand luxe et êtres humains cupides. En contrepartie, l’émir Tamim ben Hamad Al Thani peut s’acheter une bonne conduite à vil prix. Oubliées ses turpitudes intérieures (traitements dégradants et inhumains de certains et certaines) et extérieures (appui aux mouvements fréristes tels que le Hamas qui pratique avec brio la « diplomatie des otages »).
La victoire du PSG en Ligue des champions de football, le 31 mai 2025 à Munich par un score sans appel, représente un aboutissement pour les Qataris. Une question mérite dès lors d’être posée. Qui a gagné ? Le PSG, sans doute, c’est à dire le Qatar, mais la France, elle, a encore perdu. Le PSG, par ses propriétaires, est un élément de Soft Power (diplomatie de l’influence) islamique et identitaire. Des hordes de supporters drogués à l’élixir « Football » arpentent les rues de la capitale, soumise à la loi des casseurs en ayant revêtu le maillot de leur équipe fétiche. À quoi ressemble-t-il ? Un maillot bleu orné d’un modeste écusson du PSG au niveau du cœur et barré de Qatar Airways. Tout un symbole de la soumission d’un Paris humilié, outragé… mais libéré par une victoire sans appel contre l’équipe italienne ! Qui plus est, certains de ces tristes sires n’étaient pas venus pour célébrer le succès de l’équipe parisienne, mais pour dégrader, casser et, pour les mieux inspirés, crier « Free Palestine from the river to the sea ». D’autres préféraient s’en prendre au Mémorial de l’holocauste et autres lieux de culte juifs. On ne saurait être plus clair. La politique n’est jamais très éloignée du sport.
Mais, le président de la République, Emmanuel Macron salue à sa manière cette victoire par un superbe « Champion mon frère ! », idiome issu du rap et des banlieues. L’Émirat ne pouvait rêver mieux. Emmanuel Macron ne se transforme-t-il pas en meilleur ambassadeur du Qatar et de son idéologie mortifère qu’il distille déjà à travers une diplomatie de la compromission ?
Le Qatar ou la diplomatie de la compromission
Reconnaissons-le ! Le prince du Qatar est grand seigneur. Il n’est pas avare de ses deniers, de ses compliments à l’orientale. Rien n’est trop beau pour attirer dans ses rets la valetaille politique, économique, culturelle, médiatique hexagonale et européenne.
Nombreux sont, en effet, les hommes politiques, de droite comme de gauche, qui apprécient depuis belle lurette, ses largesses sans limite. Un ancien Premier ministre, au verbe haut et apprécié par ses discours enflammés à New York devant le machin, ne jure que par la magnificence et la munificence de l’Émirat des mille et une nuits. Il en est le meilleur VIP. Une distinguée ministre de Jupiter n’hésite pas à faire souvent le voyage au pays d’Aladin. Elle apprécie les belles robes, les beaux bijoux et autres gâteries. Peut-on le lui reprocher ? Toutes ces éminentes personnalités oublient à l’occasion la notion de conflits d’intérêts, de compromission, leur signification et les risques qu’ils encourent sur le plan pénal à pratiquer la diplomatie des petits arrangements entre amis. Ils préfèrent voyager aux frais de la princesse.
Lassé des critiques de certains mécréants « gwers » qu’il jugeait infondées, un ancien ambassadeur du Qatar à Paris se fait un devoir de mettre les choses au point. Il leur rappelle tout bonnement qu’il n’est pas poli de cracher dans la main de celui qui vous nourrit. Et pour étayer son propos, il dresse une liste des « collabos » qui viennent régulièrement dans les locaux de sa mission diplomatique pour y recevoir quelques espèces sonnantes et trébuchantes. Pour enfoncer le clou, s’il en était encore besoin, il s’autorise à jouer les persiffleurs. Qu’avons-nous appris de sa bouche suave ? Que certains lui font remarquer que le contenu de l’enveloppe n’est pas suffisamment garni ? Qu’ils attendent des invitations à des voyages tous frais payés. On reste coi aux pays des droits de l’homme, de l’État de droit, de la démocratie, des valeurs et autres fadaises de cet acabit. Dans une démocratie digne de ce nom, après vérification et enquête, tous ces personnages auraient dû être déchargés de leur mandat électif et, pourquoi pas, condamnés à des peines infâmantes (emprisonnement, qui sait ?). Mais, ne rêvons pas. Notre Douce France est loin d’être exempte de tout reproche.
La situation n’est pas meilleure au plan de la très honnête et très vertueuse Union européenne, si prompte à faire la leçon de morale aux républiques bananières et autres dictatures corrompues. Le Qatargate du Parlement européen n’est que la partie émergée de l’iceberg du système de clientélisme politique et de lobbying bâti par le Qatar depuis trente ans. On ne sait pour quelles raisons crédibles les poursuites judiciaires traînent. Des personnalités politiques françaises sont concernées, sans parler du monde des affaires si complaisant avec la finance islamique, les valises de billets et autres cadeaux qataris. Plus c’est gros, plus çà passe. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil dans l’Orient compliqué.
À Paris, le prince est reçu comme un roi. Il est comme chez lui. On lui déroule le tapis rouge… de la couleur du sang qu’il a sur les mains. Oubliés les otages détenus à Gaza par le Hamas dans des conditions sordides qui n’émeuvent pratiquement personne. Ils l’ont bien cherché, murmure-t-on, dans les cénacles de la bien-pensance. Ne devenons-nous pas, sans le vouloir, les idiots utiles, les complices de cette diplomatie de la « complicité » ?
Le Qatar ou la diplomatie de la « complicité »
Ce n’est un secret pour personne, les principaux dirigeants du Hamas – organisation considérée comme terroriste au sens juridique du terme – sont hébergés et financés par le Qatar. Il s’agit d’une réalité objective, un fait incontestable. De deux choses l’une :
– soit, nous considérons que la prise d’otages est un crime de guerre, un crime contre l’humanité et nous en tirons toutes les conséquences qui s’imposent. Dès lors, il nous revient, seuls ou collectivement avec les États membres de l’Union européenne, de sanctionner durement un État qui est complice des preneurs d’otages et financier d’une organisation terroriste. Nous pourrions également saisir la Cour internationale de justice (CIJ) et/ou la Cour pénale internationale (CPI) pour qu’elles délivrent des mandats d’arrêt contre la cohorte princière qatarie. Nous le faisons si bien avec le Premier ministre israélien et le président russe. Nous pourrions également geler les avoirs du Qatar en France. Cela permettrait à François Bayrou de combler son déficit budgétaire de 40 milliards d’euros. Nous apparaitrions en conformité avec notre statut de patrie auto-proclamée des droits de l’homme et avec toutes nos péroraisons martiales sur le sujet. Pareille démarche suppose courage, cohérence et constance dans l’action diplomatique de moyen et long terme d’Emmanuel Macron dont la statue au Musée Grévin vient d’être dérobée ;
– soit, nous considérons, au terme d’un raisonnement de pure Realpolitik, que l’argent n’a pas d’odeur et que nous en manquons. Au passage, le PSG est propulsé au firmament de la galaxie footballistique européenne. La victoire est belle. Ne boudons pas notre plaisir ! Elle a un effet cathartique. De plus, le Qatar doit alors être considéré comme un allié fidèle, un partenaire stratégique, un amiable compositeur sur le dossier de Gaza et des otages et « tout va très bien madame la marquise ». Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Peu nous chaut que cet agréable pays soit le sponsor des Frères musulmans et de leur entrisme sur notre sol. Au diable, les avertissements inquiétants lancés sur le sujet par la chercheuse Florence Bergeaud-Blackler et le récent rapport adressé au ministre de l’Intérieur. Peu importe que, sans la manne financière qatari et sa stratégie de conquête depuis trois décennies, les structures françaises de l’islam politique n’auraient pas la force acquise aujourd’hui, ni cette emprise sur nos compatriotes musulmans.
Pour justifier la seconde branche de l’alternative, Barbara Lefebvre pose de nouveau le problème en termes clairs lorsqu’elle écrit : « En Occident et dans le monde musulman, le Qatar diffuse l’islam frériste via son business, ses médias, sa diplomatie. Un fonds souverain de 450 milliards de dollars, 2,7 millions d’habitants dont seulement 300 000 nationaux, la deuxième puissance gazière mondiale (…). Avant les massacres du 7 octobre, le Qatar était isolé par les chancelleries sunnites, en particulier l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Après le 7 octobre et les 250 otages retenus par les djihadistes du Hamas, les Qataris sont revenus au premier plan notamment en faisant habilement croire aux Occidentaux (l’administration Biden et l’Union Européenne) qu’ils pourraient être d’efficaces médiateurs ». Tout est dit et bien dit. Voulons-nous être dupes encore longtemps ou bien sommes-nous prêts à dessiller les yeux pour nous confronter au réel sur le plan international et intérieur ?
Le prix de nos mensonges
« On ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment » (Cardinal de Retz). Nous touchons ainsi aux limites de la diplomatie du en même temps. Mais les génies, qui entourent et conseillent Jupiter 1er, nous expliquent doctement que leur gourou excelle dans la diplomatie de l’ambigüité constructive. Comme le relève si justement, Barbara Lefebvre précitée : « Quel dirigeant politique, quel ministre, quel candidat à une élection locale ou nationale, quel journaliste de sport, quel chef d’entreprise du CAC 40, aura le courage de dénoncer le double jeu du Qatar en France ? Le Qatar est un acteur central de l’islam politique français. Sans lui, jamais les Frères n’auraient pu infiltrer nos institutions, nos entreprises, nos médias, notre espace public. Le pragmatisme diplomatique et politique, les « bons deals », les victoires rafraichissantes du PSG, tout cela a ses limites quand l’ordre public et la sécurité nationale sont en jeu ». Quand accepterons-nous de livrer à un authentique et objectif exercice d’introspection de notre relation toxique avec cet Émirat ? En dernière analyse, la problématique est d’une simplicité biblique. Elle peut se résumer en quelques mots : otages : et si l’on parlait du Qatar ?