Al-Jolani, le nouveau maître de la Syrie, présente une allure de modéré. Mais il demeure un homme formé dans la matrice islamiste. Il faut encore du temps pour voir s’il tolérera la liberté dans le pays ou s’il va exercer un régime de répression.
David Daoud est chercheur principal à la Foundation for Defense of Democracies, spécialisé dans le Liban et le Hezbollah. Auparavant, il a travaillé comme chercheur non résident à l’Atlantic Council, directeur de la recherche sur Israël, le Liban et la Syrie à United Against Nuclear Iran (UANI), et analyste de recherche à la FDD. Il a également travaillé en tant que membre du personnel au Capitole, où il a fourni des analyses sur des questions liées au Moyen-Orient, à Israël et à l’Iran.
Propos recueillis par Henrik Werenskiold
Que pensez-vous du djihadiste Abu Mohammed al-Jolani et de sa promesse d’être un islamiste modéré réformé ? Il dit toutes ces bonnes choses : qu’il protégera les minorités, que les femmes ne seront pas obligées de se couvrir. Il a même indiqué qu’il pourrait autoriser l’alcool. Est-il sincère ou n’est-ce qu’une façade ?
Je suppose que le problème n’est pas qu’il soit simplement un islamiste. C’est qu’il s’agit d’un ancien terroriste d’ISIS et d’Al-Qaïda, de sorte que l’histoire d’al-Jolani n’est pas très prometteuse en ce qui concerne son comportement futur. En ce qui concerne ce qu’il a dit au sujet de l’alcool, il n’a pas nécessairement dit que l’alcool serait autorisé. Il a dit qu’il appartiendrait aux assemblées législatives de décider de ce qui se passera, et qu’il se conformerait à leur décision.
Aujourd’hui, bien sûr, il fait tous ces gestes qui semblent prometteurs et positifs. Quelle est la part de sincérité et quelle est la part de pragmatisme tactique ? Difficile à dire. Nous sommes à peine deux semaines après la chute du régime d’Assad, ce qui n’est pas assez pour que nous puissions nous prononcer sur cet homme.
Il est en effet possible qu’il ait véritablement changé d’avis, mais c’est néanmoins peu probable. A-t-il eu sa propre vision sur le chemin de Damas, pour ainsi dire, et a-t-il changé complètement sa vision du monde ? Tout est possible, mais il est encore trop tôt pour l’affirmer avec certitude. Je pense donc que nous devons être prudents et attendre une action cohérente sur une certaine période, avant d’engager al-Jolani d’une manière qui le traite comme quelqu’un qui s’est repenti, qui a fondamentalement changé.
À l’heure actuelle, il prend le contrôle d’une Syrie fracturée, paralysée par des années de sanctions et de guerre civile. Ses besoins immédiats sont l’aide à la reconstruction, la levée des sanctions, le retour des affaires dans le pays. Tout cela nécessite de bonnes relations avec les pays extérieurs.
Si l’on considère deux exemples historiques de groupes islamistes terroristes, le Hezbollah et l’ISIS, le premier a réussi, tandis que le second n’a pas réussi. Lorsque ISIS est arrivée, il a dirigé ce qui était censé être un État, mais il l’a fait d’une manière ouvertement brutale, pour ne pas dire plus. Leur approche consistait à se battre avec le monde entier en même temps, et ils n’ont pas duré longtemps en tant qu’entité politique à cause de cela. Le modèle alternatif est le Hezbollah.
Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par là ?
Dans les années 1980, le Hezbollah, en tant que force révolutionnaire, n’acceptait même pas la légitimité de l’État libanais. Techniquement, ce n’est toujours pas le cas. Pendant un certain temps, il a même tenté d’imposer la loi islamique aux chiites dans les régions qu’il contrôlait, mais rien de tout cela n’a fonctionné pour lui. Ainsi, lorsqu’il s’est agi d’élargir leur soutien aux chiites libanais, ou de tenter d’imposer la loi islamique, ils se sont heurtés à un refus.
Les Libanais ne voulaient pas soutenir le groupe sous cette forme, et le Hezbollah a donc renoncé à son idéologie pour des raisons pragmatiques. Aujourd’hui, lorsque l’on se rend dans les zones contrôlées par le Hezbollah au Liban, comme Tyr et ailleurs, on consomme de l’alcool et l’on peut voir des femmes en bikini sur les plages. Mais cela ne signifie pas que le Hezbollah s’est modéré – il s’agit simplement d’un jeu tactique.
Ils ont également cessé de s’appeler la « révolution islamique » au Liban, se rebaptisant la « résistance islamique » du pays. Cela leur a permis d’opérer dans le cadre du consensus libanais, plutôt que comme un groupe marginal, et d’accroître leur force à l’intérieur du système existant. Cela a également permis d’alléger la pression étrangère sur le groupe. Le Hezbollah a cessé d’enlever des fonctionnaires et des ressortissants étrangers au Liban. Au lieu de cela, il a concentré ses attaques terroristes et ses opérations militaires sur les Israéliens. Au cours des années 1990 et au début des années 2000, beaucoup ont dit que le Hezbollah s’était « libanisé », qu’il avait changé : il participait au processus politique et s’exprimait dans la langue de la politique libanaise.
Mais ces changements étaient entièrement tactiques, toujours pour les mêmes raisons. Ils ne voulaient pas unir le monde entier contre eux : les anciennes factions politiques du Liban, la Syrie, qui contrôlait le Liban, et la communauté internationale – à l’exception des États-Unis et d’Israël. Cette stratégie leur a donné la longévité et la marge de manœuvre nécessaire pour survivre. Elle leur a donné la marge de manœuvre nécessaire pour mettre progressivement en œuvre un programme politique islamiste dont la finalité est un modèle théocratique. Ils l’admettent, n’est-ce pas ? Ils veulent un État islamique au Liban basé sur le modèle iranien.
Quelle est la comparaison avec al-Jolani ?
Donc, si je suis al-Jolani, j’étudie ces deux modèles et ce à quoi ils ont conduit. Et si je suis intelligent, j’opte pour le modèle du Hezbollah après la guerre civile libanaise, parce que c’est celui qui a de la longévité. C’est celui qui promet de mettre en œuvre mon programme politique islamiste, même si cela prend plus de temps, mais cela ne signifie pas qu’il est modéré. Je considère toujours qu’il joue un jeu à très long terme.
Y a-t-il une chance qu’il ait réellement changé d’avis ? Peut-être, mais il faudra du temps pour le savoir. Il faut donc au moins attendre le mois de mars, date à laquelle l’actuel gouvernement intérimaire dirigé par le HTS est censé lancer un processus de transition, et voir comment les choses se dérouleront. Al-Jolani et le HTS permettront-ils la tenue d’élections libres et équitables ? Permettront-ils à toutes les forces politiques syriennes de s’affronter sur un pied d’égalité ? Lorsque les élections auront lieu, s’ils perdent, céderont-ils le pouvoir ? Aucune de ces questions ne peut trouver de réponse à court terme, il faudra un processus de contrôle et de vérification sur plusieurs années.
Mais commençons à voir quelques mesures avant de dire : « Il porte un costume, et c’est un si beau costume, et il s’est taillé la barbe. Il a dit qu’il allait permettre aux femmes d’aller à l’école, il a donc dû se modérer ». Ce sont des choses agréables à dire, mais cela ne veut pas dire qu’il a vraiment changé d’avis. Je veux dire, encore une fois, si l’on regarde le modèle iranien, le pourcentage de femmes dans les universités a considérablement augmenté sous la théocratie islamique par rapport à ce qu’il était sous le Shah. Mais cela ne veut pas dire que nous parlons d’un pays modéré, loin de là.
Vous dites donc qu’il ne s’agit peut-être que d’un jeu tactique visant à maximiser la possibilité d’atteindre l’objectif d’établir le célèbre califat mondial à un moment ultérieur ?
Oui, c’est tout à fait possible, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il y parviendra ou qu’il cherchera à instaurer un État islamique dans les cinq années à venir. Encore une fois, nous partons du principe que parce que ces groupes ont une certaine idéologie, ils vont poursuivre cet objectif final de manière irrationnelle. Je pense, encore une fois, qu’il existe des moyens plus intelligents de poursuivre cet objectif, et c’est ce qui me rend sceptique quant à sa nouvelle image de modéré.
Ce n’est pas parce qu’il est un musulman religieux. Ce n’est pas parce qu’il porte la barbe. C’est parce qu’il est issu d’un courant spécifique du salafisme-djihadisme. Il est issu d’un groupe et d’une idéologie spécifiques dont l’objectif final est une théocratie brutale. Et je ne pense pas que ces choses soient abandonnées très facilement, surtout en si peu de temps.
Alors, que pensez-vous de l’argument selon lequel il a un nouveau protecteur en Turquie et, dans une moindre mesure, au Qatar, qui va essentiellement le modérer ? Qu’ils remplaceront ses convictions salafistes et jihadistes par une branche de la politique des Frères musulmans. Pensez-vous qu’ils exerceront une influence modératrice sur lui ?
Je ne sais pas si je considère nécessairement les Frères musulmans comme modérés au sens propre du terme. Par rapport au salafisme-djihadisme à l’extrême, il s’agit d’un autre type d’islam extrême, mais ils poursuivent toujours les mêmes objectifs par des moyens pragmatiques, peut-être plus doux. Ceci étant dit, je ne sais pas à quoi ressemblerait un État purement Frères musulmans.
Nous avons un exemple à Gaza, car le Hamas est une émanation des Frères musulmans, une émanation autoproclamée des Frères musulmans. Ils ont imposé une sorte d’État de type Frères musulmans à Gaza, et ce n’était pas nécessairement une expérience agréable pour les habitants de Gaza eux-mêmes – indépendamment de ce qui se passait entre eux et Israël.
Je considère le modèle du Hezbollah comme un modèle approprié, parce qu’il me ramène à une interview que l’actuel secrétaire général Naim Qassem (alors secrétaire général adjoint) a donnée à Mayadeen en janvier 2016. On lui a demandé : « Quel est votre objectif final ? ». Et il a répondu quelque chose comme ceci :
Eh bien, écoutez, je suis un islamiste. Je suis un croyant. Bien sûr, je veux un État islamique. Et en tant qu’islamiste, je crois que la loi islamique est la meilleure façon d’organiser la société humaine. Et pas seulement pour les musulmans, mais aussi pour les chrétiens et les juifs, pour qu’ils obtiennent leurs droits et ce qu’il y a de mieux pour eux au sein du gouvernement et de la société. Mais je ne cherche pas à leur imposer cela par la force. Je cherche à les convaincre que c’est la meilleure façon pour eux de vivre leur vie.
Ils veulent donc que ce système soit imposé par le bulletin de vote plutôt que par la balle. Et cela les fait passer pour des modérés et des démocrates, n’est-ce pas ? Mais ils en sont loin. Une fois qu’ils sont au pouvoir, leur idéologie les oblige à abandonner la démocratie, même si elle est lente et pas nécessairement sanglante comme l’a fait, par exemple, ISIS. Il s’agit d’une sorte de coup d’État sans effusion de sang, où les gens portent leur oppresseur au pouvoir, parce que ce dernier les a convaincus que leur modèle est le seul qui fonctionne : C’est le seul modèle qui mettra de la nourriture sur votre table, qui fournira de l’électricité, et ainsi de suite.
Ainsi, en ce qui concerne les Qataris et les Turcs, je ne suis pas sûr que ce modèle soit plus modéré dans ses objectifs finaux. Il est plutôt plus pragmatique dans la poursuite de ces objectifs.
La Turquie joue un peu avec le feu. Je vois des liens avec la façon dont le Pakistan a été le protecteur des talibans, et ils ont fini par se retourner contre eux. Pensez-vous qu’Erdogan joue avec le feu ici, que les HTS pourraient venir le mordre plus tard ? Qu’il ne sera pas en mesure de les contrôler autant qu’il le pense ?
C’est un jeu intéressant que de jouer avec les forces politiques islamiques. Je sais qu’avec les Qataris, au moins, leur influence régionale passe par l’exploitation des forces de la religion, qui sont très fortes dans la région. Même si les gens ne prient pas cinq fois par jour ou ne boivent pas d’alcool, il existe toujours un certain traditionalisme et une nostalgie de la tradition. Et le Qatar a su exploiter cela. Cela ne s’est pas encore retourné contre le Qatar.
Avec la Turquie, ils font quelque chose de similaire. Les Turcs essaient de se positionner comme l’Iran des sunnites et de jouer sur la corde sensible des sunnites, pour simplifier un peu les choses. C’est pourquoi, pendant la guerre de Gaza, ils se font les champions de la Palestine et d’autres choses de ce genre.
À cet égard, je considère deux modèles. Le modèle saoudien et le modèle iranien. Les Iraniens choisissent très intelligemment leurs mandataires, car ils ne se basent pas nécessairement sur des incitations financières. Le Hezbollah et les milices chiites irakiennes qui sont fidèles à l’Iran ne le sont pas sur la base d’incitations financières, mais sur la base d’une idéologie. Ils croient sincèrement qu’Ali Khamenei est le Wali al-Faqih, c’est-à-dire le représentant de Dieu sur terre.
Par conséquent, si les sources de financement sont coupées, s’il y a un désaccord ou quoi que ce soit d’autre, il ne s’agit pas d’une relation normale entre deux acteurs qui ont des intérêts finalement divergents. Il s’agit d’une relation de type patron-serviteur où le second est loyal envers le premier, quoi qu’il arrive. En effet, les Iraniens ont bâti leur loyauté sur un système de croyances, et ils ont commodément cette figure religieuse qui est censée être la voix de Dieu. Encore une fois, je simplifie un peu les choses, mais c’est en gros ce à quoi cela se résume. Il existe un véritable système de croyances.
En quoi cela diffère-t-il de la Turquie ?
En ce qui concerne la Turquie, je sais qu’Erdogan veut se présenter comme une sorte de leader sunnite, mais il n’a pas la légitimité qu’Ali Khamenei a créée parmi les chiites. Il n’a pas nécessairement le même contrôle sur al-Jolani qu’Ali Khamenei sur ses pions. Je ne pense donc pas qu’al-Jolani se tourne vers lui comme les Frères musulmans idéalisent la vision du calife : l’ancien chef spirituel et mondain de l’islam sunnite combiné en un seul.
Il est donc toujours possible que les choses se passent comme elles se sont passées avec les Saoudiens. Les Saoudiens ont commencé à financer l’islamisme sunnite et les groupes extrémistes afin de contrer la révolution islamique en Iran et l’islamisme chiite politique. Mais cela leur a échappé, car leurs mandataires ne leur étaient pas subordonnés par l’idéologie, mais uniquement pour des raisons matérielles, contrairement aux Iraniens et à leurs mandataires.
Ces groupes et ces mosquées que les Saoudiens finançaient, cette idéologie dans laquelle ils injectaient de l’argent, ne regardaient pas la monarchie et la famille royale saoudiennes de la même manière que, par exemple, le Hezbollah regarde Ali Khamenei. Ils finançaient donc cette idéologie de plus en plus puriste et, lorsque les porteurs de cette idéologie ont examiné la famille royale saoudienne, ils ont constaté qu’elle n’était pas à la hauteur des idéaux de l’islam. Cette idéologie conclut que la famille royale saoudienne est corrompue, qu’elle est de mèche avec l’Occident infidèle, etc. C’est ainsi que l’on aboutit aux attaques d’ISIS contre l’Arabie saoudite.
Et au fur et à mesure que l’on progresse, c’est la conclusion logique. Je ne dis pas que les Saoudiens ont financé ISIS, mais ils ont financé la genèse d’une idéologie qui, au fil des années et des étapes, s’est métastasée en ISIS – sans doute de manière imprévisible – et cette idéologie s’est finalement retournée contre eux. Et à son apogée, il y a eu des attentats suicides et différentes attaques en Arabie saoudite même.
C’est donc une réelle possibilité pour la Turquie également. Si Erdogan continue à jouer ce jeu et que cette idéologie devient de plus en plus puriste, elle pourra alors se tourner vers la Turquie et dire : « Vous êtes tout aussi décadents et corrompus que tous les autres pays auxquels nous sommes censés nous opposer ». Et peut-être que cela ne se produira pas sous al-Jolani ou dans un avenir immédiat, mais dans une génération ou plus.
Je pense donc qu’il y a un élément de jeu avec le feu parce que la Turquie n’a pas le même contrôle sur une telle entité que, disons, l’Iran sur ses mandataires, quoi qu’il arrive. J’exagère un peu ici, mais si Khamenei décide soudainement de boire de l’alcool, cela serait presque perçu comme la bonne chose à faire par les mandataires, car il est considéré comme l’ombre de Dieu sur terre, pour ainsi dire. Erdogan, quant à lui, n’a pas cette autorité, loin de là.
Mais revenons à al-Jolani. Il compte dans ses rangs des combattants djihadistes très extrémistes, notamment des Ouzbeks, des Tadjiks, des Afghans et des Ouïghours. Comment réagiront-ils s’il devient trop modéré ? Risque-t-il que quelqu’un d’autre cherche à prendre sa place s’il ne répond pas à leur vision d’un État islamique puriste ?
Je pense que cela dépend vraiment de ce qu’il leur a promis et de leurs attentes, mais il y a ce risque. Cela dépend de ce qu’il leur a dit. Peut-être qu’il a eu ces discussions avec eux et qu’il a fixé les attentes comme il se doit, à savoir qu’ils ne chercheront pas à imposer ou à réaliser immédiatement leur objectif final ou leur vision d’un État islamique.
J’imagine qu’il a préparé quelque chose pour répondre à ces questions en interne. Peut-être en disant : « L’Émirat islamique que nous avions l’intention d’imposer ne peut pas l’être immédiatement. Il s’agira d’un processus, et les processus prennent du temps, mais nous poursuivrons ce processus en fonction des conditions de la Syrie plutôt que de rallumer une guerre civile ».
En outre, il est important de savoir comment il est perçu par ceux qui suivent l’autorité religieuse. Sont-ils prêts à faire preuve de pragmatisme dans la poursuite de leurs objectifs ? En ce qui concerne ses partisans djihadistes étrangers, il a déclaré qu’il fallait faire quelque chose pour démontrer la gratitude du peuple syrien à l’égard de ces personnes qui ont combattu et sont mortes pour la Syrie. Cela pourrait inclure la nationalité syrienne.
J’imagine que s’il est arrivé là où il est aujourd’hui, il s’est probablement préparé à cela, tout comme il joue ce long jeu avec l’Occident. Mais je ne pense pas que le Syrien moyen, même les plus traditionalistes, veuillent vivre sous la loi islamique. Donc, si al-Jolani est un dirigeant intelligent, ce que je pense, il comprend cet environnement.
C’est ce qui donne la longévité. C’est ce qui donne la durabilité. Si vous sortez d’une expérience de guerre civile, vous comprenez que même un tyran, même un autocrate qui n’est pas en phase avec la majorité de son peuple, sera déposé. C’est la leçon de Bachar el-Assad. Je veux dire, pour le dire très légèrement, qu’Assad est allé trop loin au-delà de ce que son peuple, le peuple syrien, pouvait tolérer. Cela a pris du temps, mais il a fini par être déposé.
Si al-Jolani a retenu ces leçons de l’histoire, il sait qu’il ne peut pas trop s’écarter de la ligne de démarcation avec les Syriens. Ses combattants en tiendront-ils compte ou le considéreront-ils comme un traître à la cause ? Cela reste à voir. Je pense que cela dépend du respect qu’ils lui portent, de son charisme interne et des attentes qu’il a créées. Il est donc difficile de dire ce qu’il faudra pour qu’ils l’assassinent ou se retournent contre lui.
Du point de vue des djihadistes extrémistes, il semble qu’ils gagnent sur tous les fronts. Ils ont gagné en Afghanistan, maintenant ils ont gagné en Syrie, ils gagnent au Sahel, ils poussent au Pakistan et ailleurs. Il semble que tout aille dans leur sens, et si vous êtes une personne très religieuse, pourriez-vous même avoir ce genre de considération ? Ne serait-ce pas comme une mission divine que d’imposer un État islamique strict, quelles qu’en soient les conséquences ?
Bien sûr, je comprends exactement ce que vous dites. Il est raisonnable de supposer que l’Afghanistan – ou toute autre théocratie islamique prise d’assaut par les djihadistes sunnites – représente un type de modèle qu’ils cherchent à poursuivre en fin de compte. Cependant, je pense que l’erreur que nous commettons est de supposer que leur idéologie conduit nécessairement à une poursuite irrationnelle d’un objectif final qui peut être irrationnel. Cela dit, je reconnais que l’objectif final lui-même est en effet très irrationnel.
Cela mis à part, les djihadistes peuvent être rationnels dans la poursuite de ces objectifs. Si leur but est de réussir, et de réussir vraiment – pas seulement de déposer quelqu’un et d’avoir ensuite un État islamique dans le chaos, mais d’enraciner véritablement un modèle -, alors ils feront preuve de patience. Et pour y parvenir, il existe différents modèles : le modèle du Hezbollah, mais aussi celui des Frères musulmans.
En Égypte, les Frères musulmans ont gagné par la voie des urnes, mais ils ont été déposés assez rapidement pour que nous n’ayons pas vu la plénitude du modèle qu’ils cherchaient à imposer au fil du temps. Mais nous avons des modèles où ils ont gagné par la voie des urnes, et Erdogan, dans une certaine mesure, est un Frère musulman discret. Il a gagné élection après élection, mais il a aussi terni la réputation de son pays. Il a gagné élection après élection, mais il a aussi bricolé le système au point qu’il ne peut plus être destitué. Il a mis en place des règles du jeu très strictes.
Donc, si je suis Jolani et que mon objectif final est un émirat islamique et que je m’assois avec ces types, je comprends. Mon objectif ne sera pas atteint du jour au lendemain. La Syrie est une société qui avait, dans une certaine mesure, la laïcité comme idéologie d’État. On peut dire que le baasisme est antireligieux. C’est une société où les femmes ne se couvrent pas, où l’alcool est autorisé, etc. Le pays est donc habitué à certaines normes qui ne changent pas facilement, même si le sunnite syrien moyen respecte l’islam et les traditions à sa manière. Par conséquent, si les HTS tentent de poursuivre immédiatement leur objectif final d’un État islamique, cela ne fonctionnera pas, car ils sont trop faibles à l’heure actuelle.
Ils pourraient subir un retour de bâton et perdre tout ce qu’ils ont accompli. Je ne pense donc pas que le djihadisme soit synonyme d’irrationalité. Nous supposons que ces personnes poursuivront leurs objectifs de manière irrationnelle plutôt que pragmatique parce qu’il s’agit d’extrémistes djihadistes visant à établir une théocratie brutale, mais ce n’est pas nécessairement le cas.
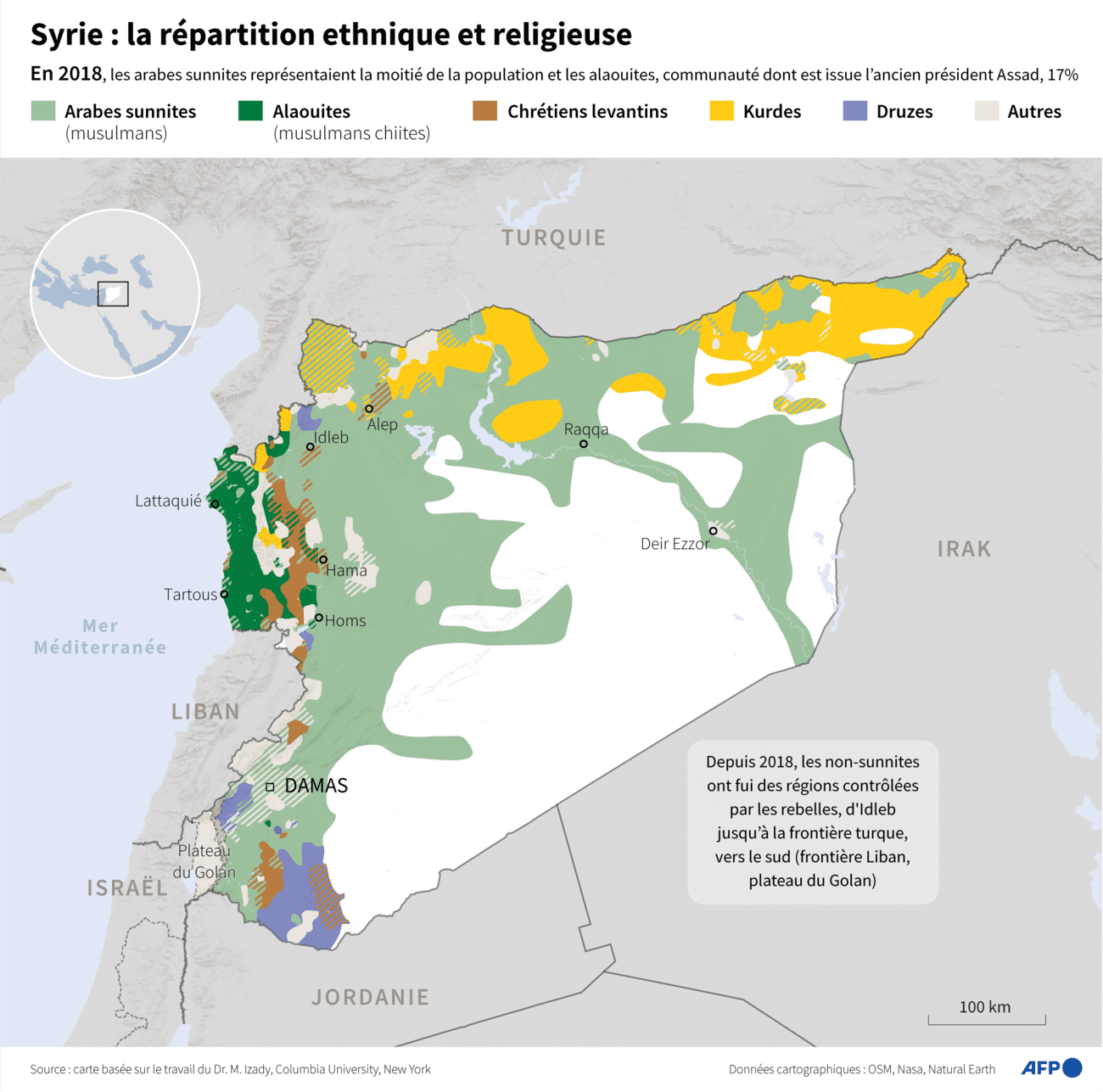
Qu’en est-il d’une organisation comme l’État islamique ? Était-elle rationnelle lorsqu’elle ravageait la région à l’époque ?
Non, donc je dirais que l’ISIS est le modèle irrationnel – le modèle qui a poursuivi ses objectifs irrationnels avec des moyens tout aussi irrationnels. Donc, si je suis Jolani et que je regarde l’histoire pour trouver un modèle qui maximise mes chances de réussite, je ne veux pas suivre le modèle de l’État islamique dès le départ. C’est peut-être mon objectif final, mais je ne veux pas commencer par-là, car je dois consolider mon emprise sur la société. Je dois habituer les gens à un certain mode de vie auquel ils ne sont pas habitués. Si je viens leur imposer cela, ce sera très probablement un échec.
Je voudrais à nouveau évoquer le modèle du Hezbollah. L’objectif final du Hezbollah est sans aucun doute d’imposer au Liban une théocratie de type islamique basée sur le modèle iranien. C’est leur objectif final, mais ils savent que cela doit se faire progressivement. Donc, pour l’instant, il y a de l’alcool, des femmes en bikini sur les plages, elles vont à l’université, etc.
Mais ils n’imposent pas, ils n’interdisent pas un certain style de vie pour l’instant, parce que leur objectif est de maximiser le lien de la société avec le parti, de maximiser son lien avec l’organisation. Ils créent alors ces « mécanismes de tapis roulant », comme j’aime à les appeler. Il y a les scouts, les écoles, les chaînes de télévision qui propagent leurs idées, les systèmes d’éducation religieuse. En bref, différentes choses qui fournissent aux gens toutes les nécessités d’une vie civile, mais ils endoctrinent lentement mais sûrement leur base de soutien, peut-être sur plusieurs générations, avec leur idéologie religieuse.
Les écoles gérées par le Hezbollah sont excellentes par rapport au système scolaire de la plupart des pays du Liban. Et si vous êtes un chiite pauvre, ils vous aideront à y envoyer votre enfant. Et peut-être que vous êtes un chiite qui est un Libanais typique – peut-être que vous priez parfois, peut-être que vous ne buvez pas d’alcool, mais vous n’êtes pas religieux au sens propre du terme. Vous ne cherchez pas à vivre pleinement le style de vie religieux.
Mais vous envoyez votre fils dans cette école parce qu’ils l’ont subventionnée pour vous, et il en sortira peut-être 5 % plus idéologique et plus engagé religieusement que vous. Super, c’est un succès pour eux. Et le Hezbollah travaillera à nouveau sur son fils pour le rendre encore plus religieux et conforme à ses préférences idéologiques. Je pense que c’est un modèle qui a plus de durabilité et de longévité.
Et encore, l’objectif final pourrait être barbare. Je ne nie pas que l’objectif final puisse être cauchemardesque. Je dis simplement que nous ne devrions pas supposer que parce que ces gens sont des djihadistes et des gens terribles, ils vont poursuivre leur objectif final d’une manière qui n’est pas intelligente. Et c’est en fait plus inquiétant pour moi, parce que cela donne aux Syriens un faux sentiment de sécurité, et à la communauté internationale un faux sentiment de sécurité.
Du point de vue des djihadistes, la prochaine étape logique pourrait être de s’implanter en Jordanie, ou peut-être en Égypte, pour propager leur révolution. Qu’en pensez-vous ?
Qui sait ? Je sais que les Jordaniens sont inquiets. Je ne sais pas si cela se produira dans l’immédiat. Mais la Jordanie est certainement plus vulnérable à une telle évolution. L’Égypte, en revanche, présente une dynamique intéressante. En effet, les Frères musulmans ont gagné sur le plan social et sociétal en Égypte. Mais même si leur mentalité a gagné, ils ont perdu en tant que marque. Je pense que l’Égyptien moyen réagit ‘hui avec dégoût si l’on parle des Frères musulmans.
Mais si l’on parle de loi islamique ou de tradition islamique en matière de droit, ils seront peut-être plus enclins à l’accepter. Et je pense qu’al-Sisi joue un jeu intéressant pour équilibrer tout cela. Il est lui-même un homme très religieux. Nous savons qu’il prie fréquemment. Mais il est également à la tête d’un État policier beaucoup plus cohérent et d’un appareil de sécurité plus puissant qu’en Jordanie.
En Jordanie, la légitimité du roi dépend de certains éléments qui peuvent être facilement ébranlés, et les forces islamistes du pays sont déjà puissantes. Je pense que le Front d’action islamique est aujourd’hui le plus grand parti au Parlement. Le dégoût qu’inspire à la société égyptienne la marque des Frères musulmans n’est donc pas le même en Jordanie.
La Jordanie est également une société beaucoup plus traditionnelle. Il suffit de regarder les crimes d’honneur. Il ne s’agit pas d’un phénomène arabe ou musulman, mais d’un phénomène jordano-palestinien. C’est également le cas dans la société israélo-arabe. C’est donc très spécifique à cette société, à ses traditions et à sa culture.
La société jordanienne est donc très traditionaliste. Et c’est un peu trompeur, presque, parce que la monarchie est si modérée. La monarchie n’a pas non plus une emprise aussi forte sur la société jordanienne que l’armée, al-Sisi et l’appareil d’État en Égypte. Je ne pense pas qu’il soit possible de créer un tel État policier en Jordanie.
La situation est trop compliquée pour que le roi puisse sévir et tenter de transformer la Jordanie en un État policier à part entière, plutôt qu’en un État policier souple. Je pense qu’il pourrait perdre sa légitimité. Il pourrait finir par se fracturer. Il y a donc des éléments en Jordanie qui, à mon avis, la rendent plus vulnérable aux forces politiques islamistes, même si elle est proche de la Syrie.
La société jordienne dispose donc d’un terrain potentiellement plus fertile pour la propagation éventuelle d’une révolution islamiste. La monarchie ne peut pas réprimer ou fermer la société aussi bien que l’État égyptien. Il y a aussi la proximité de la Syrie. Avec le temps, cela pourrait être un problème, mais je ne pense pas que cela devienne un problème dans l’immédiat.
Je pense que Jolani a d’autres chats à fouetter en ce moment. Et s’il commence à bricoler avec la Jordanie, sa capacité à convaincre l’Occident qu’il s’est modéré et qu’il devrait lever les sanctions sera compromise. En outre, les États-Unis et la Grande-Bretagne considèrent actuellement la Jordanie comme un « pilier de stabilité » dans la région. Par conséquent, s’il commence à s’en prendre à la Jordanie, ils ne lèveront pas les sanctions, ils les renforceront.
Tout dépend donc de l’intelligence avec laquelle Jolani veut jouer le jeu. Mais cela ne signifie pas qu’il ne poursuivra pas cet objectif à terme. Il n’y a rien que ces groupes islamistes détestent plus que les monarchies arabes traditionnelles. Au Levant, les Hachémites jordaniens sont le dernier vestige de ce type de monarchie arabe traditionnelle détestée. Alors oui, idéologiquement, c’est ce qu’il viserait. Idéologiquement, il voudrait voir cette règle tomber.
Il s’agit simplement, encore une fois, de poursuivre cet objectif de manière pragmatique ou d’agir de manière irrationnelle. Oubliez même les États-Unis et le Royaume-Uni – les Israéliens ont intérêt à maintenir la monarchie hachémite. Et ce ne serait pas la première fois qu’une menace de la Syrie à l’encontre de la monarchie jordanienne donnerait lieu à des représailles potentielles de la part d’Israël. C’est ce qui s’est passé en septembre 1970, lorsque la Syrie a envoyé des forces de l’autre côté de la frontière pour soutenir la guérilla palestinienne contre la monarchie hachémite, et que les Israéliens étaient prêts à déployer leur armée de l’air pour protéger le roi Hussein.
Nous avons donc déjà constaté que les Israéliens ne prennent aucun risque en ce qui concerne al-Jolani – ils ont détruit ce qui restait de l’armée syrienne en l’espace d’une semaine, afin d’éviter que ces armes ne tombent entre les mains d’al-Jolani. La zone tampon qu’ils ont occupée et le plateau du Golan sont des mesures préventives, car les Israéliens n’ont pas confiance en ce type. S’il s’en prend à la monarchie, la monarchie hachémite, je pense que les Israéliens interviendront tout autant pour s’assurer que la monarchie ne tombe pas.
Encore une fois, s’il n’est pas stupide, il le sait. Et quelque chose me dit qu’il n’est pas stupide. Mais encore une fois, cela ne signifie pas qu’il est modéré. Cela signifie qu’il sait comment poursuivre ses objectifs de manière plus intelligente.
Beaucoup de gens disent qu’il faut du temps pour découvrir les véritables intentions de Jolani. Combien de temps pensez-vous qu’il faille pour voir qui il est et quelles sont ses véritables intentions ?
Je pense que nous devons d’abord poser quelques jalons. Commençons par la transition de mars. Voyons comment ils la gèrent. Autoriseront-ils un discours politique libre et la dissidence dans le pays ? Commenceront-ils réellement à préparer les élections – et autoriseront-ils des élections libres et équitables ? Tout d’abord, voyons comment se déroule la période précédant les élections. Permettront-ils à la société syrienne de s’exprimer librement ? Autoriseront-ils les différents courants politiques ? Cela semble prendre des années, mais nous devons être patients et ne pas sauter sur la moindre miette de modération.
Dans ce contexte, nous parlons d’une société qui n’a pratiquement aucune expérience en matière d’organisation politique. Toute forme d’activisme politique a été brutalement écrasée, non seulement sous Bachar al-Assad, mais aussi depuis son père Hafez al-Assad. Il y a eu une petite ouverture au début des années 2000, puis dès que Bachar a vu que les gens le critiquaient trop, il a refermé la porte
Il s’agit donc d’une société qui a très peu d’expérience en matière d’organisation politique. Par conséquent, si M. Jolani se soucie réellement du peuple syrien, comme il l’a indiqué, le laissera-t-il compenser cette situation ? Permettra-t-il à ses opposants politiques de se développer de manière qu’ils puissent réellement rivaliser ?
En ce qui le concerne, il a au moins 10 ans d’expérience dans l’organisation politique et il est très populaire. Il a donc déjà beaucoup d’atouts en main, et il a indiqué qu’il essayait d’être juste. Voyons donc : procède-t-il de manière équitable d’ici au mois de mars et, après la transition, en s’occupant de la rédaction de la constitution ou des élections ?
En outre, le jour des élections, il est important de voir comment elles se déroulent. Sont-elles libres et équitables et dépourvues de fraude électorale ? Et s’il perd, ce qui est possible, sera-t-il prêt à se retirer ? Sera-t-il prêt à accepter sa perte de pouvoir s’il n’obtient pas le nombre de voix nécessaire ? Il s’agit donc d’un critère important pour disséquer ses véritables intentions, mais ce n’est pas le seul.
Car s’il remporte une victoire équitable, ce qui est possible, et devient président ou tout autre poste pour lequel il sera élu, nous verrons comment il gouverne. Continuons à observer son règne et la manière dont il traitera l’opposition politique au cours des années à venir. Dans ce scénario, il pourrait être judicieux de maintenir les sanctions à l’encontre de HTS.
Notre expérience de cet homme, après au moins dix ans d’expérience, est qu’il est un djihadiste, qui a commencé dans ISIS, puis est passé à Al-Qaïda, avant de se dissocier tactiquement d’Al-Qaïda. Ainsi, tout ce que nous savons de cet homme, c’est qu’il a ses racines dans des groupes terroristes. Alors, ayons au moins la moitié de ce temps – la moitié du temps qu’il a passé à être un terroriste – maintenant qu’il est au pouvoir, maintenant qu’il gouverne.
Je pense que nous avons besoin d’au moins autant de temps pour voir un modèle de comportement cohérent qui lui permette d’agir de manière modérée. Voyons au moins comment il gouverne pendant un mandat avant de nous faire une opinion. Des rumeurs circulent également sur le fait qu’il ne se présentera pas à l’élection présidentielle. Je ne sais pas, mais attendons de voir.
À lire aussi :



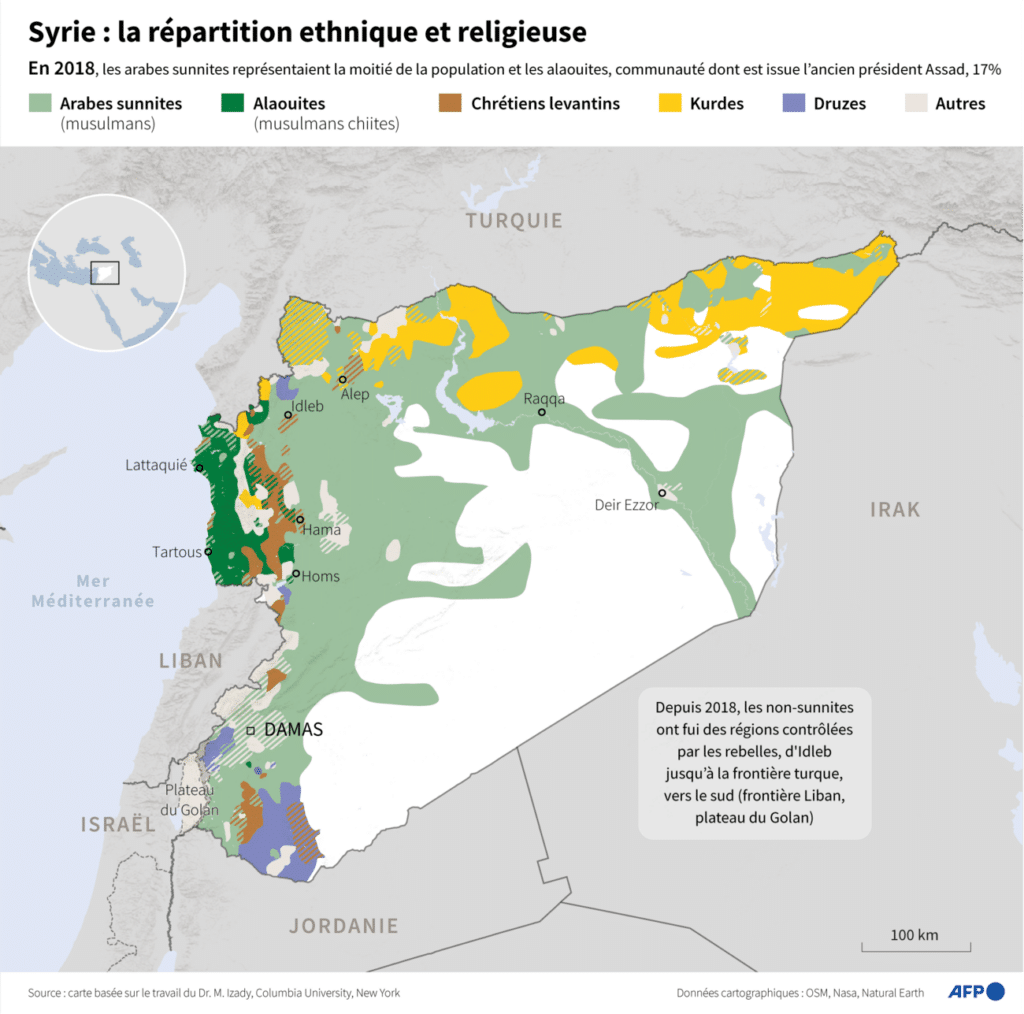


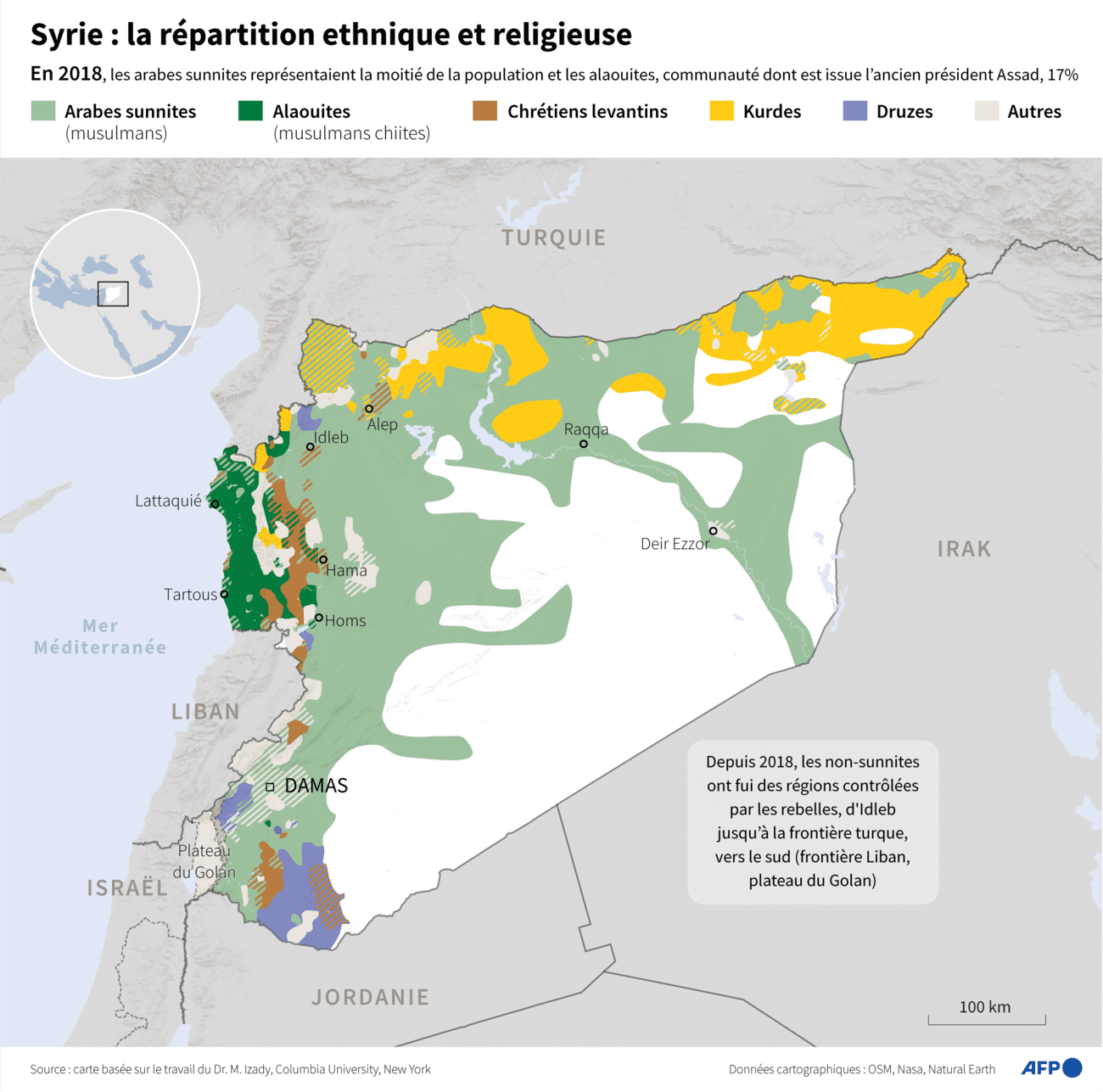


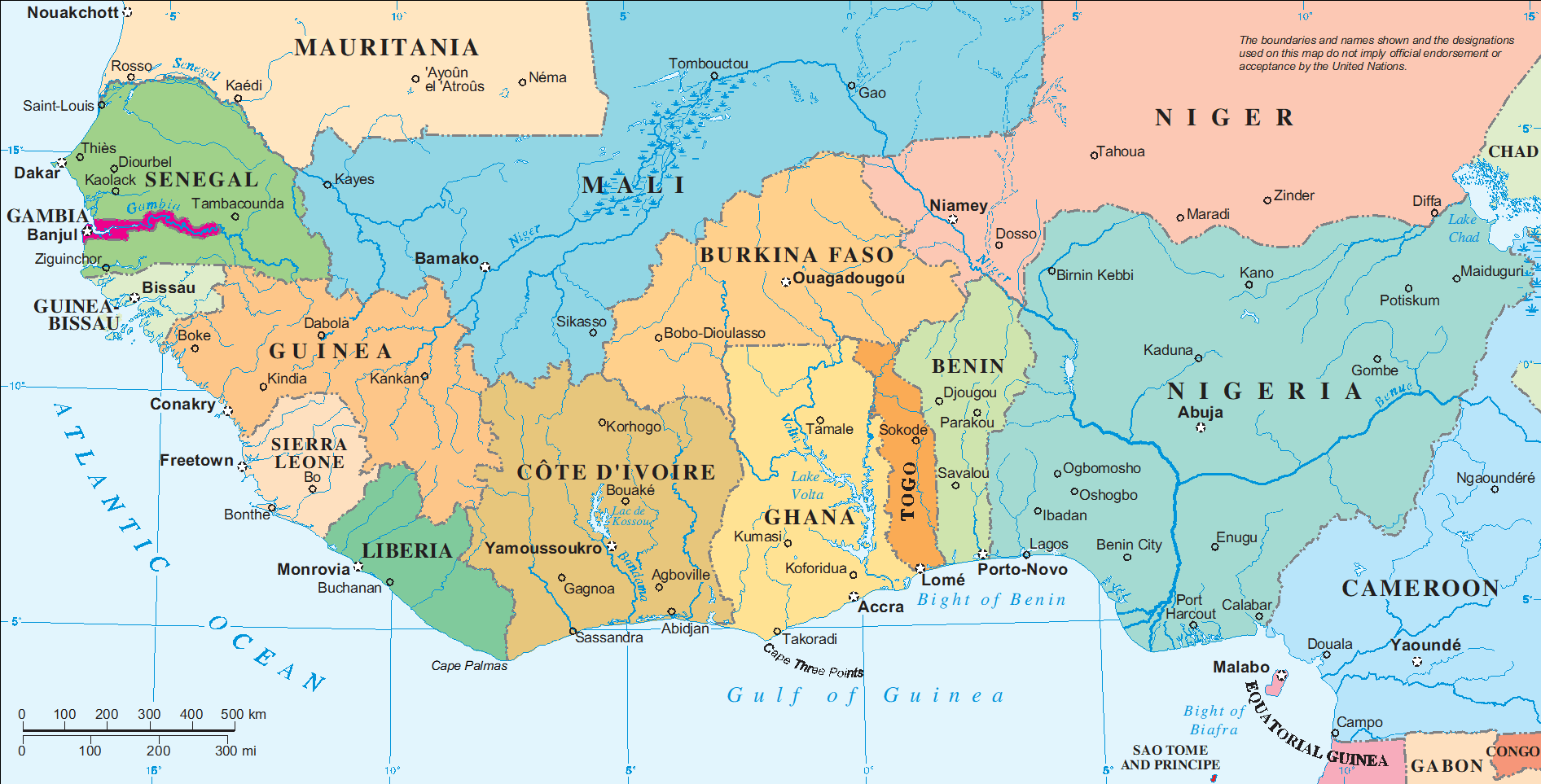




AASSDN – Mis en ligne le 20/02/2025
https://aassdn.org/amicale/breve-histoire-des-renseignements-generaux-rg/
Les Renseignements généraux (RG) ont joué un rôle clé dans la collecte et l’analyse d’informations sur la vie institutionnelle, économique et sociale en France. Depuis leur origine sous Napoléon Ier jusqu’à leur intégration dans le renseignement territorial moderne, leur mission a évolué au gré des menaces et des enjeux de sécurité nationale. Retour sur l’histoire d’un service central à la fois discret et stratégique.
Avec pour lignes directrices la recherche de renseignement sur la vie institutionnelle, économique et sociale et les phénomènes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public et à la sûreté générale, les Renseignements généraux ont vu leur périmètre d’action et leur organisation fluctuer au fil des temps.
La chute de la monarchie française en 1792 ouvre une période agitée, durant laquelle l’activité de police fait l’objet de nombreuses réorganisations. En février 1800, Bonaparte créé la Préfecture de police de Paris et sa division « Sûreté générale et police secrète », prémices du premier service organisé pour prendre en compte les activités de renseignement en France.
En 1811, des « commissaires spéciaux [1] » sont attachés à la surveillance de l’opinion, des opérations de commerce, des mouvements des ports, des communications avec l’étranger, des associations politiques et religieuses.
Sous le Second Empire, Napoléon III édicte un décret qui place 30 commissaires spéciaux de police [2] sous la tutelle des préfets et du ministère de l’Intérieur. Outre la répression des infractions de droit commun, ils sont chargés du suivi de l’état de l’opinion publique. En 1861, de nouvelles directives viennent élargir leurs prérogatives, notamment en ce qui concerne la police des ressortissants étrangers et celle des ports et des frontières. Ces commissaires spéciaux constituent la première implantation territoriale durable de l’activité de renseignement.
La structuration progressive des RG
Confrontée aux mouvements anarchistes et aux attentats qu’elle ne parvient pas à endiguer seule, la police française commence à s’engager pleinement dans la coopération internationale, après l’assassinat de l’impératrice d’Autriche en 1898.
En 1907, une vaste réforme de l’organisation policière est engagée par Georges Clémenceau, alors Président du conseil et ministre de l’Intérieur. Ce dernier instaure des brigades régionales mobiles, plus connues sous le nom de « Brigades du Tigre », qui sont principalement chargées de lutter contre le crime organisé.
En parallèle, il crée une autre brigade en charge de la police judiciaire et des renseignements généraux, placée au sein de la Sûreté générale. Le dispositif est complété, en 1911, par le nouveau service des renseignements généraux de police administrative qui a pour mission de prévenir les troubles à l’ordre public.
Par ailleurs, le gouvernement encourage le développement à Paris d’un service de renseignement possédant des attributions similaires. Les Renseignements généraux de la préfecture de police (RGPP), ainsi que le service des renseignements généraux et des jeux, sont ainsi créés en 1913.
En avril 1937 sous le Front Populaire, le président du Conseil Léon Blum et le ministre de l’Intérieur Max Dormoy expérimentent une nouvelle Commission interministérielle du renseignement, réunie chaque semaine autour du président du Conseil, pour faciliter l’échange d’informations au plus haut niveau.
L’après-guerre impose de nouvelles missions
Dès novembre 1944, le Général de Gaulle restructure les services de renseignement et de contre-espionnage. Il crée la direction de la surveillance du territoire (DST) et confirme dans leurs missions les Renseignements généraux, placés au sein de la sûreté nationale. Le suivi de la vie politique, économique et sociale, ainsi que la surveillance des hippodromes et des établissements de jeux, leur sont confiés.
L’appellation historique de « direction centrale des renseignements généraux » (DCRG) apparait en octobre 1968. Peu après, la DCRG intègre la nouvelle direction générale de la police nationale (DGPN) qui succède à la Sûreté nationale.
Au cours des années 70, les RG sont chargés de missions de recherche de renseignement concernant les phénomènes terroristes. Ils contribuent à l’identification des réseaux terroristes et notamment islamistes, en lien étroit avec la direction de la surveillance du territoire (DST) et les renseignements généraux de la préfecture de police (RGPP) à Paris.
Dans les années 90, les RG doivent également faire face aux phénomènes de violence urbaine, aux dérives sectaires ou au hooliganisme, qui ont une incidence sur la sécurité et l’ordre public. Ils s’intéressent aussi aux nouvelles formes de contestation sociale. Ils surveillent les groupements à risque ou les individus susceptibles de se livrer à des actions violentes, prônant des idéologies extrémistes, séparatistes (basques, corses), ou portant atteinte aux principes démocratiques.
Le suivi de l’activité et du fonctionnement interne des partis politiques lui est retiré.
En dépit des activités et des cultures complémentaires des RG et de la DST, le contexte sécuritaire du début des années 2000 fait apparaître un besoin d’intensification de la coopération entre les services de renseignement du ministère de l’Intérieur. Une refonte des services de renseignement policier est décidée au plus haut niveau en 2007. La DCRG est alors supprimée par le décret n°2008-609 du 27 juin 2008.
Ses attributions sont en partie transférées à la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), qui deviendra l’actuelle DGSI en 2014. À l’inverse, ses missions relatives à la vie institutionnelle, économique et sociale, et aux phénomènes de violence urbaine susceptibles d’intéresser l’ordre public sont confiées à la sous-direction de l’information générale (SDIG) de la DGPN. Ce service forme l’ossature de l’actuel service central du renseignement territorial (SCRT), créé en 2014. Simultanément, l’activité de contrôle des établissements de jeux et de courses est définitivement transférée à la police judiciaire (DCPJ).
[1] Créés par décret impérial du 25 mars 1811
[2] Créés par décret du 22 février 1855
Source : DGSI