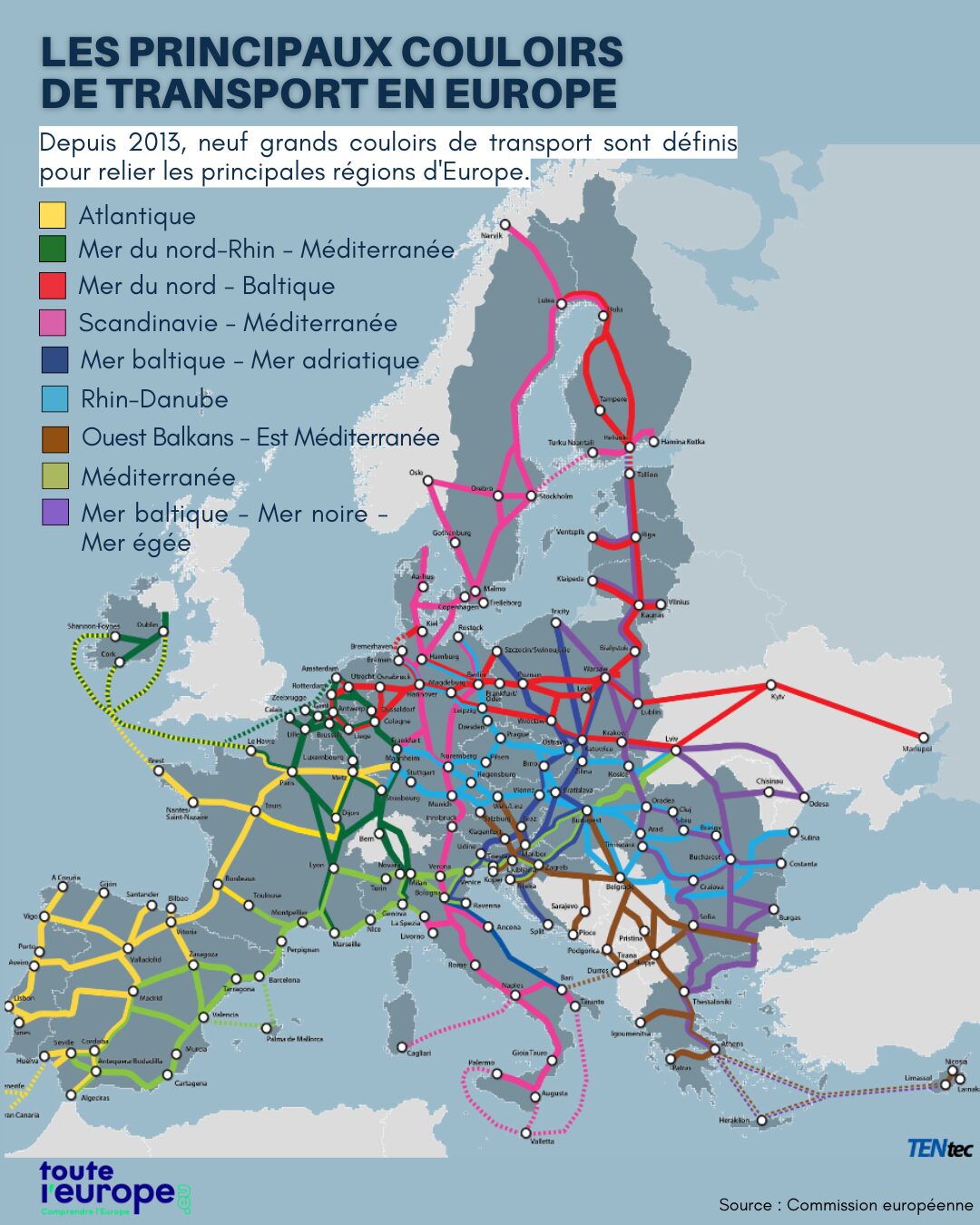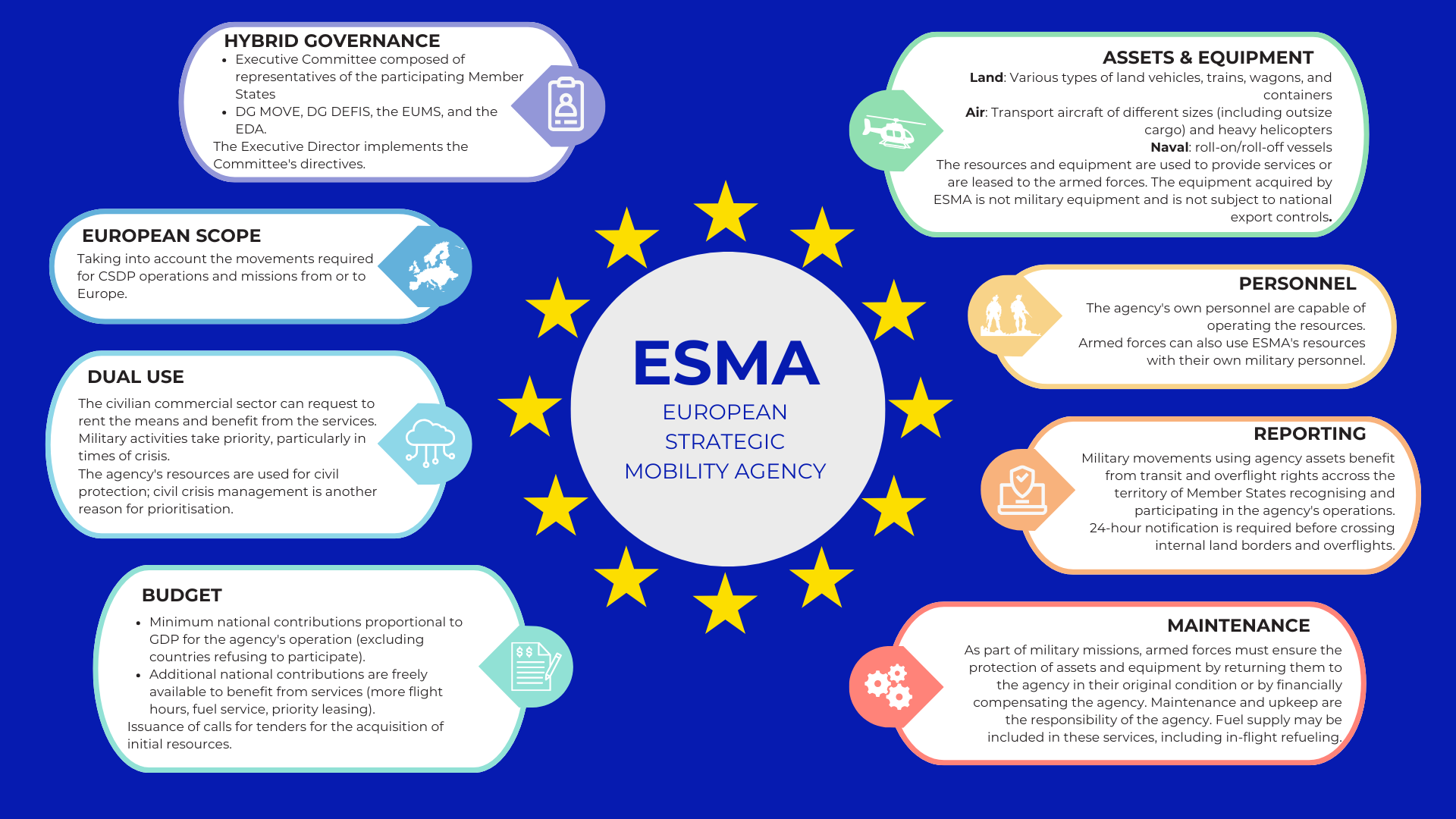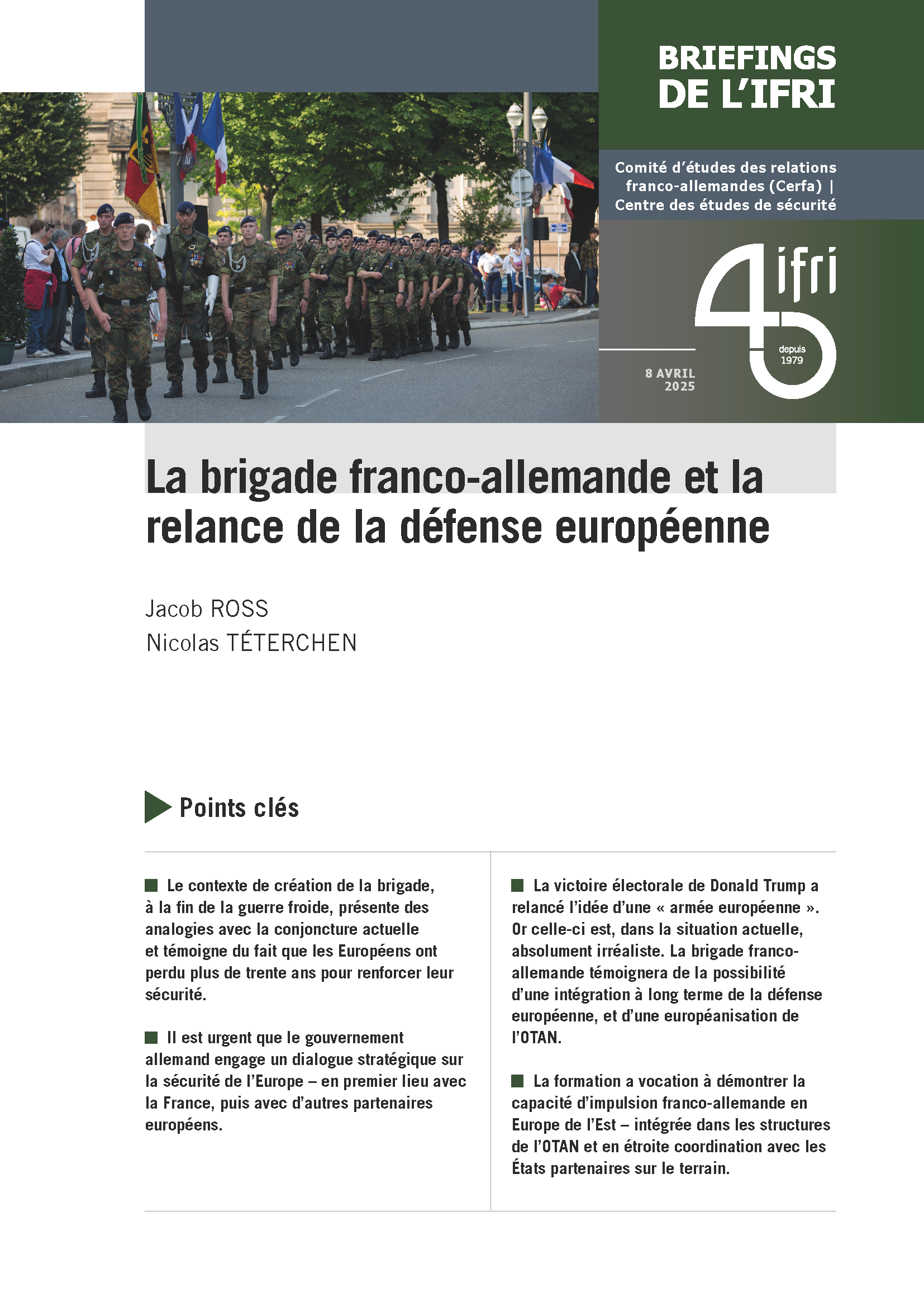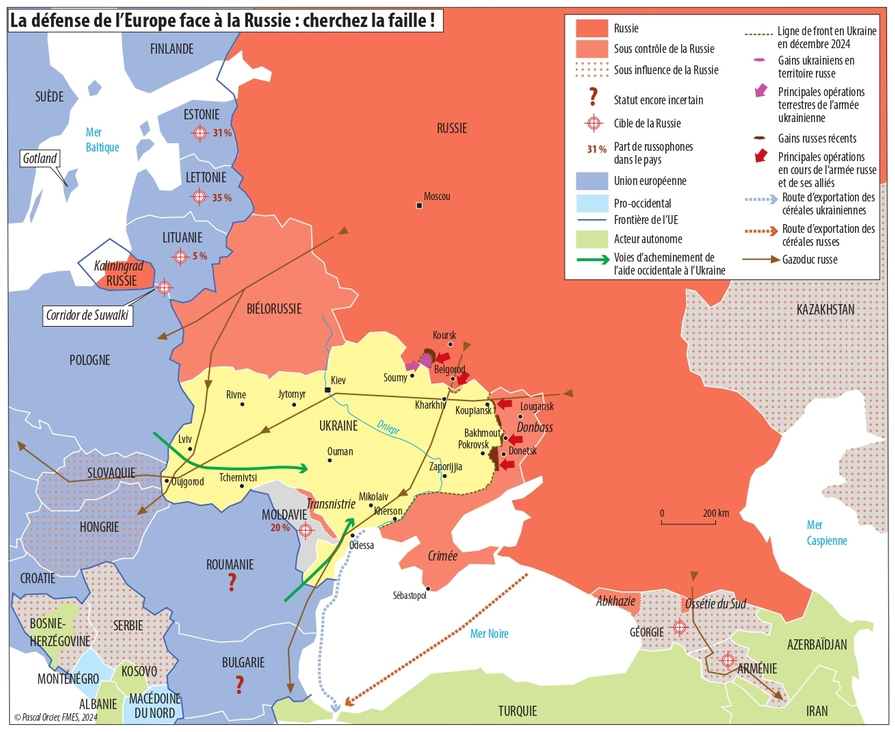Le programme de réarmement SAFE de l’UE et ses conséquences potentielles

par Federico Santopinto* – IRIS – publié le 28 mai 2025
https://www.iris-france.org/le-programme-de-rearmement-safe-de-lue-et-ses-consequences-potentielles/
*Federico Santopinto est directeur de recherche à l’IRIS, en charge du Programme Europe, stratégie et sécurité, spécialisé dans l’intégration européenne en matière de défense et de politique étrangère, ainsi que dans la coopération militaire et sécuritaire entre l’Union européenne (UE) et l’Afrique. À ce titre, il suit également les politiques de coopération au développement de l’UE utilisées comme outil de prévention et de gestion des conflits.
Diplômé de l’Université de Florence en Sciences politiques (option internationale), Federico Santopinto a également obtenu un master en Politique internationale à l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Il a ensuite exercé, pendant plus de dix ans, l’activité d’observateur électoral de long terme pour l’UE, principalement dans des pays post-conflit en Afrique. Il a parallèlement intégré le GRIP (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité), un institut de recherche spécialisé dans la maîtrise des armements, où il a longtemps travaillé tant sur l’Europe que sur le maintien de la paix onusien. Il a notamment assuré dans ce cadre la gestion de l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix (OBG). Federico Santopinto travaille également occasionnellement pour l’ULB en qualité d’expert associé.
Depuis que l’Union européenne (UE) a étendu ses compétences au secteur de l’armement, elle s’est trouvée confrontée à un dilemme : comment associer (ou pas) les entreprises des pays tiers aux programmes qu’elle a mis en place pour financer les coopérations entre ses membres ? Comment inclure en particulier les entreprises des alliés de l’OTAN qui ne sont pas membres de l’UE ? À chaque nouvelle initiative lancée dans ce domaine, cette question revient systématiquement sur la table des négociateurs européens, en provoquant des tourments.
En adoptant le programme dénommé SAFE (Security Action for Europe), son dernier né en matière de réarmement, l’UE semble avoir trouvé la quadrature du cercle de cette épineuse équation. SAFE, en effet, introduit des nouveautés particulièrement originales en matière d’éligibilité, sorties tout droit du chapeau du Secrétariat de la Commission européenne. À premières vues, ces nouveautés facilitent l’association des pays tiers aux achats conjoints que les États membres pourront réaliser grâce aux prêts élargis par l’UE. Et leurs entreprises pourraient en conséquence être plus facilement éligibles, ce qui a fait crier victoire aux partisans de l’ouverture. Mais à terme, les conséquences de cette ouverture pourraient surprendre les alliés de l’Union, tout comme ses États membres d’ailleurs. Ces derniers ont-ils pleinement saisi les implications que SAFE pourrait avoir au fil du temps ?
| Le programme SAFE en quelques mots
Le programme SAFE se distingue des autres instruments d’aide à l’industrie de défense de l’UE par le fait qu’il n’offre pas des subsides, mais des prêts pour des acquisitions conjointes, que les États membres devront rembourser à des conditions avantageuses. SAFE bénéficiera d’une enveloppe de 150 milliards d’euros qui sera elle-même empruntée par la Commission européenne sur les marchés. |
Les règles d’éligibilité de SAFE
Dans un premier temps, SAFE semble recalquer à quelques nuances près les règles d’éligibilité attribuées à d’autres programmes qui l’ont précédé pour soutenir l’industrie militaire, comme EDIRPA et ASAP[1]. En règle générale, les bénéficiaires des prêts élargis via SAFE doivent être établis dans l’UE, en Norvège ou en Ukraine, et ils ne doivent pas être soumis à un contrôle étranger. Les filiales ou les co-entreprises des pays tiers présentes sur le sol de l’UE, néanmoins, peuvent également être éligibles si elles ont fait l’objet d’un filtrage au sens du règlement (UE) 2019/452 sur les investissements directs étrangers (FDI) ou si elles fournissent toute une série de garanties à l’UE[2]. Comme dans le cas de l’EDIRPA, SAFE rajoute un autre critère : les produits achetés grâce aux prêts de l’UE doivent également disposer d’un minimum de 65% de composantes européennes. Certains équipements de défense plus complexes devront en outre être produits par une autorité de conception européenne (contrôle de la propriété intellectuelle et du savoir-faire technique), alors que d’autres catégories d’armes moins complexes ne sont pas automatiquement soumises à cette contrainte[3].
Par rapport aux programmes précédents, la Commission européenne toutefois propose quelque chose de plus en termes d’éligibilité. Elle suggère en effet d’élargir à certaines conditions le rayon d’action de SAFE aux pays « like-minded »[4], à savoir :
- Ceux en voie d’adhésion ou les candidats potentiels à l’adhésion.
- Ceux ayant conclu un partenariat de sécurité et de défense avec l’UE, au titre de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC)[5].
Ces deux catégories de partenaires potentiels ne peuvent pas pour autant bénéficier des prêts de l’UE. Ils pourront par contre être associés aux achats conjoints lancés via SAFE, en y contribuant financièrement bien entendu. Pour cela, ils devront néanmoins signer préalablement des accords bilatéraux avec l’UE pour établir en quels termes leurs entités et entreprises pourront être éligibles aux acquisitions communes cofinancées par les prêts de la Commission. Ces accords, de plus, devront définir toute une série d’autres mesures en matière de normalisation et d’interopérabilité. Il est prévu également qu’ils définissent les dispositions à mettre en œuvre afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement des composantes du produit acquis.
Comment seront dès lors redéfinis les critères d’éligibilité de SAFE dans le cadre de ces accords bilatéraux ? Le règlement du programme demeure ambigu sur ce point. Il se limite à dire que les accords bilatéraux devront fixer « the rules related to restrictions imposed by third countries or by third country entities, on the definition, adaptation and evolution of the design of the defence product procured with the support of the SAFE instrument »[6]. En d’autres termes, l’UE renvoie toute décision en la matière aux futures négociations qu’elle devra entamer avec ses alliés.
L’UE au cœur d’un nouveau pôle normatif en matière d’armement ?
Au regard de ces règles, SAFE pourrait apparaître à première vue comme le programme de l’UE le plus ouvert de tous aux pays tiers. Derrière cette ouverture, toutefois, il est possible de percevoir en filigrane une stratégie visant à placer l’Union au centre d’un pôle réglementaire nouveau en matière d’industrie de défense. Face à l’incertitude stratégique alimentée par la posture ambiguë de Donald Trump, l’idée de pousser les pays tiers, qu’ils soient européens ou non, à signer des accords bilatéraux avec l’UE tombe à point nommé. Elle pourrait représenter un atout stratégique majeur pour les Européens. Ces accords, en effet, ne seront pas négociés uniquement avec les pays qui partagent les mêmes valeurs de l’Union. Ils seront vraisemblablement négociés également et surtout avec ceux qui feront preuve de proximité stratégique avec elle, ce qui inclut potentiellement de nombreuses démocraties dans le monde, mais semble exclure à priori les États-Unis de Donald Trump.
Une telle disposition vise en premier lieu le Royaume-Uni, avec lequel l’UE vient de signer un partenariat de sécurité et de défense qui ouvre la voie à un accord bilatéral sur SAFE. Mais elle pourrait intéresser également d’autres alliés non européens, comme le Canada, qui négocie actuellement lui aussi ce type de partenariat. À l’instar des pays de l’Union, Ottawa et Londres ont été fortement perturbés par l’attitude de Donald Trump vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine. Et ils pourraient l’être encore plus si les États-Unis devaient annexer le Groenland sans le consentement du Danemark. Aussi, l’ouverture de l’UE aux pays tiers est intéressante notamment au regard de son timing. L’Union est-elle en train de proposer à ses partenaires, tout aussi dépités qu’elle, de constituer à long terme un embryon d’alternative, ou du moins une échappatoire partielle à l’hégémonie industrielle des États-Unis dans le secteur de l’armement ? A-t-elle l’intention d’étendre sa traditionnelle puissance normative à ce domaine, d’où elle était exclue jusqu’il y a encore quelques années ?
Pour répondre à cette question, encore faudrait-il comprendre si les États membres sont réellement prêts à jouer la carte normative de l’UE dans un domaine aussi délicat que celui de l’industrie de défense. En considérant l’attachement des uns à l’illusion de leur souveraineté nationale et la persistance des autres à considérer Washington, contre vents et marées, comme l’ultime garantie de leur propre sécurité, le doute est permis. Pourtant, à l’heure où les démocraties d’Europe, d’Asie et d’Océanie sont confrontées au désarroi face à la tournure stratégique que prennent les États-Unis, l’idée de conditionner l’association des entités des pays tiers à une convergence stratégique et normative de leurs pays avec l’Union est loin d’être dénouée de sens. Elle pourrait porter les germes d’une ambition nouvelle pour l’UE. Les États membres auront-ils le courage de l’assumer ?
[1] EDIRPA (European defence industry through common procurement) et ASAP (Act in Support of Ammunition Production) sont des programmes transitoires lancés par l’UE en 2023 dans le cadre de la guerre en Ukraine pour soutenir les achats conjoints et la production industrielles d’armement.
[2] Le Règlement (UE) 2019/452 établit un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers (IDE) au sein de l’UE, dans le but de protéger les actifs stratégiques européens. Il met en place un mécanisme de coopération entre les États membres et la Commission européenne en trois étapes :
- Les États membres notifient aux autres membres et à la Commission les IDE faisant l’objet d’un filtrage,
- Les autres États membres peuvent adresser des commentaires et la Commission un avis,
- Les États membres restent libres de prendre la décision finale de filtrage.
[3] Article 16 de la proposition de Règlement COM(2025) 122 final du 19 mars 2025 établissant l’instrument SAFE, tel qu’amendée par le COREPER.
[4] Ibid, art. 17.1.
[5] L’UE a signé ce genre de partenariats avec sept pays : Norvège, Moldavie, Macédoine du Nord, Albanie, Corée du Sud, Japon et tout récemment le Royaume-Uni. Des négociations sont en cours avec le Canada. L’UE envisage également de signer également un accord avec l’Inde.
[6] Art. 17.2(d) du Règlement COM(2025) 122 final du 19 mars 2025 établissant le programme SAFE, tel qu’amendé par le COREPER.