LETTRE DU CEMAT – JUILLET 2024
Préparer les combats futurs

Lire et télécharger : Lettre-CEMAT- 20240717_NP_PRAT
Préparer les combats futurs

Lire et télécharger : Lettre-CEMAT- 20240717_NP_PRAT

Alors que le conflit en Ukraine s’enlise dans sa troisième année, les tensions entre l’Occident et la Russie ne cessent de s’intensifier. Le président français Emmanuel Macron a récemment évoqué la possibilité d’envoyer des troupes en Ukraine, une déclaration qui a suscité de vives réactions sur la scène internationale. Cependant, ces propos belliqueux semblent en décalage avec la réalité de l’armée française, si l’on en croit les révélations d’un ancien officier supérieur.
Guillaume Ancel, ancien lieutenant-colonel formé à la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, a accordé une interview explosive au journal lunion.fr. Ses déclarations jettent une lumière crue sur l’état actuel des forces armées françaises et leur capacité à faire face à un conflit de haute intensité comme celui qui se déroule en Ukraine.
« Nous n’avons pas aujourd’hui une armée capable de se battre dans les conditions de l’Ukraine« , affirme sans détour Ancel. Cette assertion choc repose sur plusieurs facteurs qu’il détaille au fil de l’entretien. Selon lui, l’armée française s’est progressivement transformée en un « super corps expéditionnaire léger », adapté à des interventions ponctuelles sur des théâtres d’opérations lointains, mais mal équipé pour un conflit prolongé et intense aux portes de l’Europe.
L’ancien officier pointe du doigt le manque criant de matériel lourd et de munitions. Il rapporte les propos alarmants du chef d’état-major des armées, Thierry Burkhard, qui aurait déclaré devant des parlementaires : « Si on voulait s’impliquer dans une guerre comme celle de l’Ukraine, nous aurions 15 jours de munitions« . Cette pénurie s’explique, selon Ancel, par des choix stratégiques erronés faits après la fin de la Guerre froide.
La professionnalisation de l’armée, avec la fin du service militaire en 1997, a certes permis de constituer une force d’élite, mais au prix d’une réduction drastique des effectifs et d’une spécialisation excessive. « On a formé une armée d’élite, en passant de 600 000 hommes à 200 000 militaires« , explique Ancel. Ce choix a conduit à la fermeture de nombreuses bases et à l’abandon de certaines capacités, notamment dans le domaine du combat blindé mécanisé.
L’ancien lieutenant-colonel critique également le manque de débat public sur ces questions cruciales. Il déplore une tradition de silence imposée aux militaires, remontant selon lui à Napoléon Bonaparte. Cette « grande muette« , comme on surnomme l’armée française, peine à communiquer avec la société civile et à faire entendre ses besoins.
Face à la résurgence de la menace russe, Ancel plaide pour un changement radical de paradigme. Il préconise notamment l’acquisition de chars de combat modernes, comme le Léopard II, utilisé par plusieurs pays européens. Pour lui, une défense européenne coordonnée et bien équipée est nécessaire pour faire face aux défis géopolitiques actuels, bien que le leader russe ait nié toute envie de s’étendre vers l’Europe.
Ces révélations soulèvent de nombreuses questions sur la pertinence de la politique de défense française et sur sa capacité à répondre aux défis géopolitiques actuels. Alors que le président Macron a annoncé une augmentation significative du budget de la Défense, Ancel estime que ces investissements ne suffiront pas s’ils ne s’accompagnent pas d’une refonte en profondeur du modèle d’armée.
L’interview d’Ancel à lunion.fr agit comme un signal d’alarme. Elle met en lumière le décalage entre les ambitions affichées par le pouvoir politique et les réalités du terrain. À l’heure où les tensions internationales s’exacerbent, la France se trouve face à un défi de taille : moderniser rapidement ses forces armées pour les adapter à un monde où la guerre conventionnelle, loin d’avoir disparu, semble malheureusement redevenir une option.
Plus de 1 000 afghans ont été embauchés par l’armée française lors de son intervention en Afghanistan. Mais malgré les promesses de l’État, plusieurs d’entre eux n’ont pas été évacués en France, et regrettent leur engagement aux côtés de l’OTAN.
Par Benjamin Laurent – Géo – Publié le 16/07/2024
“Si je retourne maintenant dans mon village, les talibans vont se saisir de moi et me kidnapper ou me tuer”. C’est ainsi que Sayed* nous raconte son quotidien, constitué de changements fréquents de cachette pour échapper aux combattants islamistes qui contrôlent l’Afghanistan.
Son crime ? Avoir travaillé comme auxiliaire de l’armée française, déployée pendant plus d’une décennie dans le pays d’Asie centrale aux côtés de ses alliés. Les forces de Paris ont employé des centaines d’afghans comme lui, luttant pour débarrasser leur pays des talibans ou simplement obtenir de quoi nourrir leur famille. Mais trois ans après la chute de Kaboul et le retour au pouvoir du régime islamiste, plusieurs d’entre eux attendent encore une évacuation qui n’est jamais venue.

En 2001, la France envoie ses troupes en Afghanistan après le renversement éclair des talibans par les États-Unis, dans le sillage des attentats du 11 septembre. Paris recrute alors au fil des années 1 067 « personnels civils de recrutement local », ou PCRL ; autrement dit des interprètes, chauffeurs, cuisiniers, ou encore des gardes, qui vont épauler les forces françaises sur le terrain.
Mais le retrait français survenu en 2012 place ces auxiliaires dans une situation délicate, alors que leur statut de collaborateur avec les pays de l’OTAN pousse les talibans à les menacer de représailles. S’engage alors un long bras de fer entre les autorités françaises et des associations, collectifs d’avocats, journalistes ou encore personnalités politiques qui tentent d’obtenir leur rapatriement en France. Une décision du Conseil d’État ouvre en 2019 la possibilité d’accorder un visa pour les PCRL dans le cadre de la protection fonctionnelle, autrement dit la protection due à une personne en danger des suites de son emploi par une administration française.
Car la menace est bien avérée. Le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid résumait en 2014 auprès de Vice News en des termes très clairs ce qui arriverait aux interprètes des armées occidentales : ils doivent être « ciblés et exécutés comme les soldats étrangers et les occupants étrangers. Ils seront mis à mort ».
Qader Daoudzai, interprète des forces françaises entre 2010 et 2012, a ainsi été tué lors d’un attentat au sein d’un bureau de vote en 2018, alors qu’il allait demander un visa déjà refusé en 2015. Abdul Basir, cuisinier pour l’armée française entre 2008 et 2013, est assassiné en juin 2021 après trois refus de visa, laissant derrière lui 5 enfants.
Quelques jours plus tôt, les talibans expliquaient que les afghans qui ont travaillé avec l’étranger « ne cour[ai]ent aucun danger de notre part […] dès lors qu’ils abandonneront les rangs de l’ennemi, ils redeviendront des Afghans ordinaires dans leur patrie et ne devraient pas avoir peur ».
L’assassinat d’Abdul Basir a lieu en parallèle de la reconquête éclair du pouvoir par les talibans durant le printemps et l’été 2021, suite aux accords de Doha prévoyant un retrait des forces de l’OTAN après deux décennies. Cette offensive pousse les pays occidentaux à organiser une évacuation précipitée de leurs troupes et de dizaines de milliers d’afghans avant le mois de septembre. On trouve parmi eux des personnels d’ambassade, journalistes, diplomates, membres du gouvernement, ainsi que de nombreux auxiliaires qui ont soutenu l’effort de guerre.
Mais l’évacuation est loin d’emmener tous les alliés occidentaux en sûreté. Le 16 août 2021, Emmanuel Macron souligne pourtant le rôle crucial qu’ont eu ces auxiliaires sur le terrain. « C’est notre devoir et notre dignité de protéger ceux qui nous aident : interprètes, chauffeurs, cuisiniers et tant d’autres », revendique-t-il, affirmant en parallèle que « plusieurs dizaines de personnes sont encore sur place qui ont aidé l’armée française et pour lesquelles nous restons pleinement mobilisées ».
Malgré cette annonce forte, tous et toutes ne seront pas évacués – loin de là. Selon le ministère des Affaires Étrangères en décembre 2022, si 228 PCRL ont été rapatriés entre 2013 et 2018, l’opération Apagan, durant laquelle la France organise l’évacuation de « près de 3 000 personnes dont une centaine de civils français » au cours de l’été 2021, n’emporte en tout et pour tout que 31 PCRL avec leurs familles. Ce même ministère note que 126 autres anciens PCRL ont depuis été exfiltrés entre septembre 2021 et décembre 2022.
Des centaines de PCRL ne sont donc pas inclus dans ces chiffres, pour de multiples raisons qui contribuent à brouiller un peu plus le dossier : « Des PCRL qui ont servi différentes armées ont pu être relocalisés par un autre pays, par exemple les États-Unis ou l’armée britannique », souligne Maître Magali Guadalupe Miranda, avocate membre du Collectif de défense des personnels civils de recrutement local fondé en 2015.
« Il est aussi possible que des personnes qui ont dû fuir ont finalement été pris en compte dans les chiffres de l’asile et qui de ce fait n’ont pas formulé de demande de visa », souligne l’avocate. D’autres ont tout simplement disparu lors de leur fuite vers l’étranger, sans qu’on sache ce qu’il a pu advenir d’eux.
Mais pour ceux qui ont dû rester sur place, la situation sécuritaire sans cesse dégradée les pousse à fuir le pays, une tâche très complexe depuis la chute de Kaboul. Le premier obstacle des auxiliaires consiste à sortir du pays en direction du Pakistan ou de l’Iran, États dans lesquels les ambassades françaises peuvent les convoquer pour étudier leur demande de visa.
« Il est très difficile pour un afghan d’obtenir un visa » pour quitter l’Afghanistan dans un délai satisfaisant, souligne cependant Quentin Müller, journaliste qui, dans son livre Tarjuman. Enquête sur une trahison française, écrit avec Brice Andlauer et publié en 2019, dénonçait déjà la politique française envers les PCRL. D’autant que posséder un passeport en règle est également de plus en plus compliqué pour des personnes traquées par le gouvernement.
Or, les délais imposés par les ambassades en cas de convocation doivent être respectés à tout prix, pointe le journaliste : « C’est écrit noir sur blanc que si vous n’êtes pas au rendez-vous, on conclut que vous n’êtes pas intéressé de venir et qu’il n’y aura pas de chance ».
Il faut donc débourser de fortes sommes pour faciliter l’obtention de son visa vers Islamabad ou Téhéran auprès des autorités corrompues avant de fuir dans ces pays, où il s’agit ensuite de subsister en attendant pendant des mois que la France étudie le dossier. L’Iran et le Pakistan, qui abritent à eux deux des millions d’afghans, ont cependant durci leur position sur le sort des réfugiés sur leurs terres, avec l’expulsion par Islamabad de centaines de milliers d’afghans demandant l’asile en 2023.
Zahir* fait partie de ceux qui ont pu, malgré tous ces obstacles, obtenir un visa et s’installer en France, après qu’il ait assuré entre 2006 et 2007 la sécurité des forces armées françaises. « Je suis reconnaissant de l’attention exceptionnelle du gouvernement pour finaliser mon dossier et faciliter mon intégration dans la société française », nous précise-t-il : arrivé en Iran en juillet 2022, il est convoqué à l’ambassade le 16 novembre de la même année et a pu s’installer en France en août 2023.
Mais sa famille est toujours bloquée en Afghanistan, attendant que Zahir parvienne à la rapatrier. « Elle se trouve dans une situation précaire qui menace sa vie », alerte ce dernier. « Elle ne peut pas rester au même endroit en Afghanistan, elle doit constamment changer d’adresse à cause des problèmes de sécurité ».
Mais les coûts engendrés par l’exil empêchent pour le moment tout rapatriement de ses proches : « j’ai payé très cher pour que toute ma famille puisse avoir des passeports, j’ai contracté des dettes pour cela, et, maintenant, je n’ai plus d’argent pour la faire venir », regrette Zahir.
Tous n’ont pas été aussi chanceux que Zahir, comme le constate amèrement Hossain*. Ce dernier est réfugié en Iran dans l’attente d’un visa qui ne vient pas, alors que sa famille est encore en Afghanistan. « De 2011 à 2013, j’ai été employé par la société de logistique Agility France en tant que chef d’équipe du service de sécurité de la gendarmerie française« dans une province afghane, nous raconte-t-il.
Arrivé en Iran, il obtient un rendez-vous à l’ambassade à Téhéran en juin 2023, sans obtenir de réponse de celle-ci par la suite. Sa demande de visa via un recours en urgence a été rejetée, tandis que la procédure suit encore son cours au tribunal.
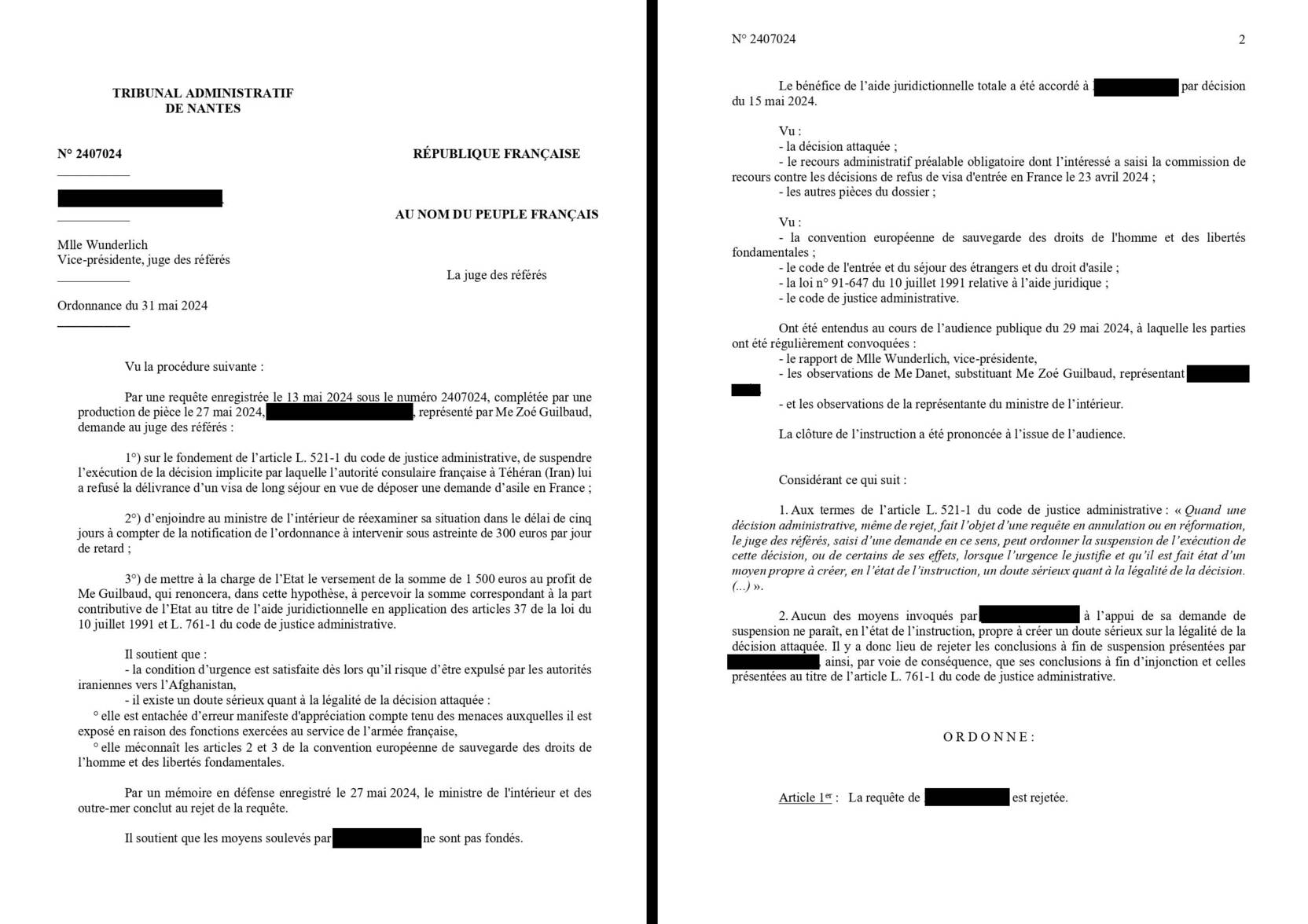
Le risque d’expulsion d’Hossain vers un pays où les autorités cherchent à le tuer n’est pas une menace suffisante, comme le juge le ministère de l’Intérieur. GEO
« Je suis très triste, très inquiet, et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement français n’a pas tenu les promesses qu’il avait faites à ses employés et pourquoi il nous a laissés au bord du chemin », regrette ce dernier.
Contactés avant et après les élections législatives au sujet d’Hossain, l’ambassade de France à Téhéran et le ministère de l’Intérieur n’ont pas répondu à GEO, tandis que le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu’il ne donnerait pas suite à notre sollicitation. Le ministère des Armées, contacté après les élections, n’a pas encore apporté de réponse au sujet d’Hossain.
« Ce qui est fou, c’est le manque de cohérence entre les annonces lors de la prise de pouvoir des talibans et la prise en charge des auxiliaires », souligne maître Zoé Guilbaud, qui a traité de plusieurs dossiers d’auxiliaires, comme celui d’Hossain.
La faute à une « volonté de ne pas accueillir d’avantages de PCRL », dénonce Nicolas Delhopital, directeur de l’association Famille France-Humanité, mobilisée depuis des années pour défendre les auxiliaires. « La situation est très proche des Harkis qu’on a laissés en rase campagne », souligne pour sa part Nathalie Goulet, sénatrice de l’Orne, impliquée sur le dossier depuis des années.
Mais le système qui permet d’accorder, ou non, un visa à ces auxiliaires est opaque et atténue les efforts des acteurs engagés pour tenter de les rapatrier. « Les ambassades ne prennent pas toutes seules les décisions en matière de visa asile, c’est la direction de l’Asile rattachée au ministère de l’intérieur qui va examiner les demandes et donner un avis favorable ou non », pointe ainsi Zoé Guilbaud.
Le ministère des Armées, en tant qu’ancien employeur de ces auxiliaires, joue également un rôle, comme dans les demandes de protection fonctionnelle. L’imbrication de plusieurs administrations, l’existence de plusieurs procédures pour obtenir un visa et le mutisme des différents ministères impliqués complexifie d’autant plus chaque dossier. On peut cependant distinguer une tendance générale selon maître Zoé Guilbaud : « On amène de plus en plus de preuves, de plus en plus d’éléments, mais plus ça va, moins ça suffit ».
Ces procédures de plus en plus complexes ne concernent pas qu’Hossain : « une vingtaine de personnes attend un visa dans les pays limitrophes », estime Abdul Razeq Adeel, interprète entre 2001 et 2014 et fondateur de l’Association des Anciens Interprètes Afghans de l’Armée Française, qui a aidé à mettre la lumière sur cette affaire depuis son arrivée en France en 2016.
Hossain et d’autres pourraient malheureusement connaître le même sort que celui de Sayed. Ce dernier a travaillé comme garde dans une base aérienne de l’OTAN entre 2006 et 2007, un emploi qui lui vaut une médaille de la défense nationale. « Après que les talibans ont pris le contrôle de l’État afghan, j’ai fui en Iran en juillet 2022 », résume-t-il à GEO.

Les états de service de Sayed lui ont valu une récompense attribuée au nom du ministère de la Défense. GEO
Il tente là-bas de faire valoir ses droits pour obtenir un visa qui lui permettrait d’accéder à la France. « En octobre 2022, mon avocate a reçu un mail de l’ambassade [de France à Téhéran] informant que j’avais un rendez-vous le 16 novembre 2022 pour un entretien. À la fin de l’entretien, l’ambassade m’a dit d’attendre deux ou trois mois leur décision », explique Sayed.
Sans réponse de l’ambassade à Téhéran au sujet du visa, Sayed lance une procédure via le tribunal administratif de Nantes, qui fait la jurisprudence en matière de visa. S’ensuit un refus en août 2023, validé par une décision de ce même tribunal en avril 2024 après contestation par Sayed, puis une procédure d’appel encore en cours.
Une autre demande auprès du ministère des Armées dans le cadre de la protection fonctionnelle en mars 2022 est restée lettre morte. La saisie du tribunal administratif de Paris en urgence et au fond n’aboutit pas non plus : la procédure en urgence a été refusée au motif que Sayed a également demandé un visa auprès des autorités iraniennes, tandis qu’une date d’audience pour la procédure au fond n’a toujours pas été fixée.
La décision du tribunal administratif de Nantes justifie son refus en arguant qu' »il n’est ni établi ni même allégué qu’il [Sayed] ferait l’objet de menaces directes en Iran où il réside depuis 2022″. Son retour dans un pays contrôlé par les talibans n’est pas non plus une justification suffisante : « Si le requérant soutient qu’il est retourné en Afghanistan, et fait part de menaces qu’il aurait subies et d’attaques à l’encontre de ses biens personnels, il n’apporte pas d’éléments suffisamment circonstanciés de nature à établir qu’il serait exposé dans son pays de résidence à des risques sérieux de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants », mentionne ainsi le compte rendu.
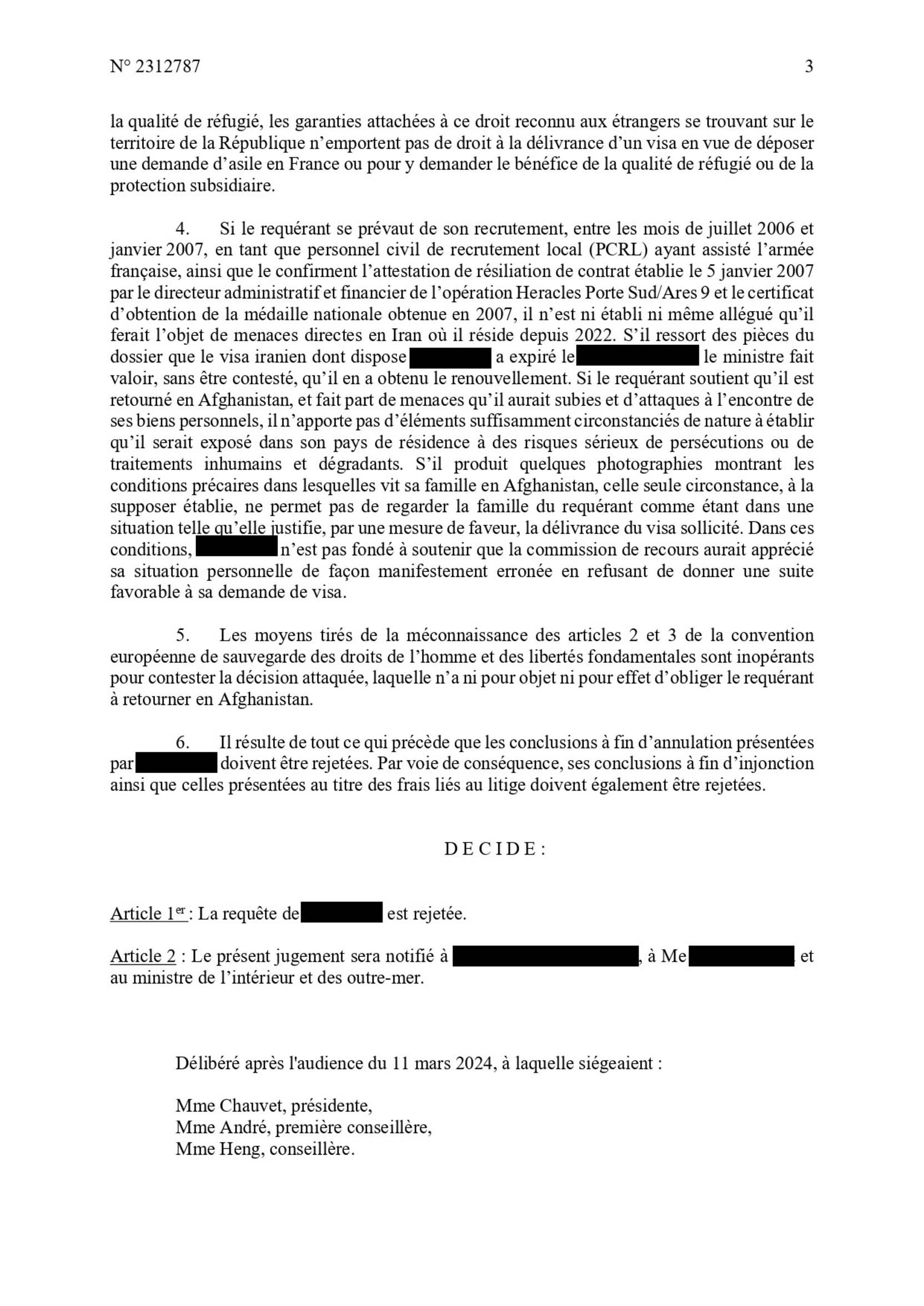
Comme pour Hossain, la qualité de PCRL de Sayed n’entraîne pas de menace suffisamment avérée, malgré les déclarations des talibans comme leurs actions. GEO
Abdul Basir n’était pas non plus en danger, selon la justice française. « Le juge a considéré qu’il n’y avait pas de menaces, que les preuves apportées à l’appui étaient fausses. Et aujourd’hui, voilà où l’on en est », dénonçait son avocat William O’Rorke auprès du Figaro en 2021.
Malgré le danger, Sayed a finalement dû quitter l’Iran en désespoir de cause : « Mon visa iranien était expiré et je devais emprunter de l’argent pour continuer à rester en Iran. Et comme j’ai deux enfants handicapés qui sont dans un état très grave et qu’ils avaient besoin de leur père, je suis retourné en Afghanistan », regrette-t-il.

La fille de Sayed, pour laquelle il a dû retourner en Afghanistan. GEO
« Je dois régulièrement changer de cachette, je vais d’une ville à l’autre, mais je reste en contact avec ma famille. Elle se sent très mal, elle a peur », alerte Sayed.
C’est un grand déshonneur pour la France de livrer ses amis à ses ennemis qui veulent les tuer […] Il suffirait que ceux qui refusent nos visas viennent un jour, ne serait-ce qu’un jour en Afghanistan, et ils comprendraient que nous vivons dans la peur pour nos vies et celles de nos familles. Ils comprendraient à quel point tout est difficile pour nous.
GEO a de nouveau contacté l’ambassade ainsi que les ministères de l’Intérieur et des Affaires Étrangères pour évoquer le cas de Sayed, sans réponse.
La différence de traitement entre ces trois dossiers de PCRL est stupéfiante. Contacté en octobre 2022 au sujet des cas d’Hossain, Sayed et Zahir, un employé de l’ambassade de Téhéran indiquait alors : « après vérification, ces personnes n’apparaissent pas sur les listes des personnes à évacuer ». Pourquoi seul Zahir a-t-il finalement pu bénéficier d’un visa, alors que Sayed, arrivé en même temps en Iran et convoqué le même jour à l’ambassade, a dû retourner en Afghanistan, et qu’Hossain attend toujours le sésame vers la France ?
Sayed n’est par ailleurs pas le seul à avoir été trahi par les autorités. Yusefi, un autre PCRL réfugié en Iran, a été reconduit à la frontière avec l’Afghanistan en décembre 2023, malgré les révélations de Quentin Müller et Marianne, après avoir vendu tous ses biens pour se rendre au rendez-vous fixé par l’ambassade à Téhéran pour étudier son cas.
Et les auxiliaires français ne sont qu’une catégorie parmi tous ceux qui ont servi aux côtés des troupes occidentales. Ghulam*, un membre de la police nationale afghane d’ordre public, a suivi une formation militaire de six mois à Saint-Astier. Après la chute de Kaboul, il a tenté de quitter l’Afghanistan, sans succès, et reste coincé sous le joug des talibans.
Ma vie n’est pas en sécurité ici, il n’y a ni science ni culture. Les filles ne sont pas autorisées à étudier. J’espère trouver un endroit sûr où mes enfants pourront profiter de la vie que Dieu leur a donnée.
Si tous ces cas pointent bien vers une responsabilité de l’État dans l’abandon de ses alliés sur le terrain, l’affaire n’a pas eu la moindre conséquence politique. La sénatrice Nathalie Goulet, impliquée sur le dossier depuis des années, a demandé en 2021 la création d’une commission d’enquête afin, entre autres, « d’éclairer le Sénat sur les critères qui ont permis l’octroi des visas et les motifs des refus ». Sa demande n’a pas abouti, et le changement de gouvernement suite aux élections législatives de 2024 risque de faire disparaître certains des acteurs qui ont contribué à ces décisions.

Ghulam a été formé aux côtés d’autres policiers afghans en Dordogne en 2014. GEO
Mais malgré les décisions françaises impactant durement leurs conditions de vie, pour beaucoup d’anciens auxiliaires, la rupture avec leur pays de naissance est définitive. « Si je réussis à repartir, je ne pourrai jamais revenir », affirme Sayed. « Mes enfants sont dans une situation terrible, il faut que je les aide à avoir un avenir. Et j’ai beaucoup trop souffert en Afghanistan« .
Hossain, lui, serait prêt à rentrer rendre visite à sa famille, s’il est pour lui possible de revenir un jour dans un Afghanistan au système politique changé. En attendant, il ne peut que contempler ce qu’infligent les maîtres du pays à leur propre population, et regretter : « L’exemple que donnent les talibans en Afghanistan, c’est celui d’une marche vers l’obscurité ».
*Les prénoms ont été modifiés.

– 11 juillet 2024
https://blablachars.blogspot.com/2024/07/un-choix-pas-tout-fait-neutre.html
On a appris cette semaine quelques détails intéressants sur le choix norvégien en faveur du Leopard 2A8, annoncé en février 2023. Alors que les militaires norvégiens avaient choisi le K2 sud-coréen après plusieurs mois d’évaluation, les militaires norvégiens avaient choisi le K2 sud-coréen, c’est finalement son concurrent allemand qui a été sélectionné par les responsables politiques du pays. Derrière cette distorsion, se cacherait un certain nombre d’arguments allemands visant à favoriser le blindé allemand.
On ne connait pas les détails exacts de ces tractations au cours desquels plusieurs sujets sensibles auraient été abordés comme le pétrole et le gaz ou le coût des programmes associés et la présence de la marine allemande au large des côtes norvégiennes.
Le résultat de ce qui ressemble à une vaste tambouille dans laquelle l’avis des militaires n’a pas été pris en compte, a débouché sur la sélection du Leopard 2, qui serait trop lourd pour être déployé dans les zones les plus septentrionales du pays, où se trouvent les frontières finlandaises et russes, objets des mesures de surveillance des états de la région et de l’OTAN. En dépit de leur caractère très surprenant, ces informations si elles étaient confirmées, démontrent que le choix d’un char de combat est un acte éminemment politique, caractéristique qui peut paraître choquante pour les utilisateurs. Cet aspect politique demeure néanmoins essentiel pour une opération liant deux pays pour plusieurs décennies comme on a pu déjà avec la décision allemande du 24 janvier 2023.

Des avions F-16, des batteries de défense antiaérienne, une « trajectoire irréversible » vers l’adhésion: les pays de l’Otan ont multiplié mercredi les gages d’un soutien renforcé à l’Ukraine, lors d’un 75e sommet historique marqué par les incertitudes politiques, notamment aux Etats-Unis.
Pour voir l’intégralité de la Déclaration du Sommet de Washington publiée par les chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’OTAN à l’issue de la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord qui s’est tenue tenue à Washington le 10 juillet 2024, cliquer ici.
On notera l’établissement du « programme OTAN de formation et d’assistance à la sécurité en faveur de l’Ukraine (NSATU) afin de coordonner les livraisons d’équipements militaires ainsi que les activités de formation militaire organisées par les Alliés et leurs partenaires. Ce programme vise à inscrire dans la durée l’assistance à la sécurité fournie à l’Ukraine, garantissant ainsi un soutien renforcé, prévisible et cohérent. Le NSATU, qui opérera dans les pays de l’Alliance, aidera l’Ukraine à assurer sa défense dans le respect de la Charte des Nations Unies. Le NSATU ne fera pas de l’OTAN une partie au conflit au sens du droit international. Il soutiendra la transformation des forces de défense et de sécurité ukrainiennes, facilitant la poursuite de l’intégration du pays dans l’OTAN ». On notera que mercredi soir, le DoD a annoncé la nomination du général (deux étoiles) Steven G. Behmer au poste d’adjoint au commandant du Security Assistance Group – Ukraine, installé à Wiesbaden, en Allemagne.
On notera aussi:
– « la création du Centre OTAN-Ukraine d’analyse, d’entraînement et de formation (JATEC), qui servira à déterminer et à exploiter les enseignements à tirer de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et permettra à l’Ukraine de gagner en interopérabilité avec l’OTAN »,
– et la décision du secrétaire général de nommer un(e) haut(e) représentant(e) de l’OTAN en Ukraine.
Les points 25, 26 et 27 de la Déclaration porte sur le rôle de la Chine. La Chine « joue désormais un rôle déterminant dans la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine », précise le texte otanien qui appelle Pékin, « en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU (..) à cesser de soutenir matériellement et politiquement l’effort de guerre russe ».
« La RPC continue de faire peser des défis systémiques sur la sécurité euro-atlantique. Nous constatons que la RPC est à l’origine d’incessantes activités cyber et hybrides malveillantes, y compris d’activités de désinformation », poursuit la Déclaration.
La Chine a exprimé dès ce jeudi son « vif mécontentement » et dénoncé un communiqué de l’Otan « empreint d’une mentalité digne de la Guerre froide et d’une rhétorique belliqueuse », selon un communiqué du porte-parole de la mission chinoise auprès de l’Union européenne (UE). « L’Otan devrait cesser de faire du tapage sur une soi-disant menace chinoise, cesser d’inciter à la confrontation et à la rivalité, et contribuer davantage à la paix et à la stabilité dans le monde », a-t-il souligné, dénonçant des propos « remplis » de « calomnies ».
L’Otan a par ailleurs annoncé une réunion « avec les dirigeants de l’Australie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la République de Corée et ceux de l’Union européenne pour parler des défis de sécurité communs et des domaines de coopération ». Au travers de ces partenariats, l’Otan entend « favoriser la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique, et contribuer ainsi à la paix et à la prospérité ».
Cette Déclaration comporte aussi un « Engagement à aider durablement l’Ukraine à assurer sa sécurité » dont voici le texte intégral (c’est moi qui souligne):
« Aujourd’hui, nous affirmons notre indéfectible attachement à l’Ukraine, qui, pour rester un État souverain, démocratique et indépendant, a besoin de notre aide sur le long terme. Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, les Alliés apportent à cette dernière un soutien politique et une aide économique, militaire, financière et humanitaire d’une ampleur inédite, l’assistance militaire se chiffrant à quelque 40 milliards d’euros par an. Les Alliés mettent en outre à disposition leur capacité industrielle de défense pour répondre aux besoins de l’Ukraine. Tous ces efforts portent leurs fruits en permettant aux Ukrainiens de se défendre efficacement et de faire payer chèrement à la Russie ses agissements.
Nous sommes déterminés à aider l’Ukraine à mettre en place des forces capables de vaincre l’agresseur russe aujourd’hui et de le dissuader de commettre une nouvelle agression demain. À cet effet, nous comptons dégager une enveloppe de base d’au moins 40 milliards d’euros pour l’année à venir, et maintenir ensuite l’assistance à la sécurité à un niveau soutenable, pour que l’Ukraine l’emporte ; il sera tenu compte de ses besoins, de nos procédures budgétaires respectives et des accords de sécurité bilatéraux que des Alliés ont conclus avec le pays. Les chefs d’État et de gouvernement réexamineront les contributions des Alliés lors des prochains sommets de l’OTAN, à commencer par celui qui se tiendra en 2025 à La Haye.
Notre engagement porte sur la fourniture d’une assistance et d’équipements militaires à l’Ukraine et sur la formation des militaires ukrainiens, et couvre donc notamment :
– l’achat d’équipements militaires pour l’Ukraine ;
– les dons en nature au profit du pays ;
– le coût du transport des équipements militaires destinés à l’Ukraine, de leur maintenance et de la logistique ;
– le coût de la formation des militaires ukrainiens ;
– les coûts opérationnels relatifs à la fourniture d’une assistance militaire à l’Ukraine ;
– les investissements dans les infrastructures de défense et l’industrie de défense du pays ainsi que le soutien dont elles ont besoin ;
– toutes les contributions aux fonds d’affectation spéciale OTAN pour l’Ukraine, notamment sous la forme de moyens non létaux.
Toutes les aides apportées par les Alliés à l’Ukraine relevant des catégories précitées seront comptabilisées, qu’elles soient fournies par l’intermédiaire de l’OTAN, à titre bilatéral, à titre multilatéral ou de toute autre manière. Soucieux d’assurer un partage équitable des charges, les Alliés s’attacheront à contribuer chacun de manière proportionnelle à la concrétisation du présent engagement, en tenant compte notamment de leur part dans le PIB global de l’Alliance.
Deux fois par an, les Alliés informeront l’OTAN de l’assistance qu’ils auront fournie à l’Ukraine en vertu du présent engagement. Leur premier compte rendu inclura les contributions mises à disposition à compter du 1er janvier 2024. Le secrétaire général se fondera sur ces informations pour établir un récapitulatif de toutes les contributions déclarées par les Alliés.
En plus de fournir l’assistance militaire couverte par le présent engagement, les Alliés entendent continuer d’apporter à l’Ukraine un soutien politique et une aide économique, financière et humanitaire. »

Par le 10 juillet 2024
Marie Durrieu est doctorante contractuelle associée à l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM) et rattachée au Centre Michel de l’Hospital (CMH). Elle est enseignante en Relations Internationales et Science politique à Sciences Po Paris. Ses recherches portent sur le rôle et l’usage de l’humiliation en relations internationales. Elle est spécialiste du conflit israélo-palestinien et s’est rendue plusieurs fois sur le terrain. Elle est l’auteur du livre : « Du conflit israélo-palestinien au nucléaire iranien : l’humiliation, la variable oubliée des négociations » aux éditions l’Harmattan.
Le conflit israélo-palestinien est souvent mal compris et mal interprété. Alors que la guerre fait rage à Gaza, il est indispensable d’analyser la situation en prenant en compte la réalité historique et celle du terrain.
Cet article présente les fondements de ce conflit, de ses origines à la tragédie du 7 octobre 2023. Quelles sont les dates et les chiffres clés de ce conflit ? Quelle est l’essence du conflit ? Pourquoi le 7 octobre 2023 nous a-t-il surpris ? En réalité, le conflit israélo-palestinien est avant tout un conflit territorial entre deux peuples.
Avec un texte très maitrisé, cinq photos, deux cartes et un lexique, Marie Durrieu fait ici oeuvre de pédagogie géopolitique.
DEPUIS le 7 octobre 2023, les discours politiques et médiatiques parlent de « guerre Israël-Hamas ». Or, c’est avant tout, une phase du « conflit israélo-palestinien ». Nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe à Gaza sans l’inscrire dans le temps long du conflit qui oppose les Israéliens et les Palestiniens depuis 1948… Comment en sommes-nous arrivés là ? Quelle est l’essence de ce conflit ? Pourquoi le 7 octobre 2023 nous a-t-il surpris ? Cet article a l’ambition de contextualiser la tragédie actuelle.
25 dates clés
1917 : Arthur Balfour, secrétaire d’État britannique aux Affaires Étrangères, adresse une lettre ouverte au Lord Lionel Walter Rothschild, figure du mouvement sioniste, et déclare être en faveur de l’établissement d’un « foyer national pour le peuple juif » en Palestine qui jusqu’ici faisait partie de l’Empire Ottoman.
1920 : Lors la chute de l’Empire Ottoman, la Société Des Nations (SDN) attribue au Royaume-Uni un mandat sur la Palestine. Les Britanniques administrent le territoire.
1917-1948 : À la suite de la déclaration de Balfour, de nombreux juifs font leur « alya » (acte d’immigration en « terre promise »). Ils passent d’environ 70 000 personnes en 1917 à environ 650 000 début 1948. Le mouvement est accéléré par le génocide contre la population juive en Europe (5 à 6 millions de victimes, représentant 50 % de la population juive d’Europe).
1946 : Le Royaume-Uni est dépassé par les tensions qui surgissent entre les Arabes et les Juifs en Palestine mandataire. Ils abandonnent le dossier qu’ils transmettent à l’ONU.
29 novembre 1947 : Le plan de partage de la Palestine est adopté (résolution 181), malgré l’opposition de tous les États arabes. Ce plan prévoit la division de la Palestine en trois secteurs : le secteur arabe (45%), le secteur juif (55%) et Jérusalem sous tutelle de l’ONU.
14 mai 1948 : David Ben Gourion proclame l’indépendance de l’État d’Israël.
1948-1949 : La première guerre israélo-arabe oppose Israël au Liban, la Syrie, l’Égypte, la Jordanie et les Palestiniens. Envers et contre tous, l’État juif récupère 78% du territoire. Les 22% restant sont annexés par la Jordanie (la Cisjordanie) et l’Égypte (bande de Gaza). Pour les Palestiniens, c’est la « Nakba » – la catastrophe – plus de 800 000 personnes fuient la Palestine.
28 mai 1964 : L’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) est créée afin de représenter le peuple palestinien et organiser la résistance contre Israël et la récupération de leur terre. Yasser Arafat prend la tête de l’organisation.
5 juin 1967 : Israël lance une offensive contre l’Égypte. La guerre dure six jours. Israël, qui s’oppose à l’Égypte, la Syrie, la Jordanie, l’Irak et le Liban, remporte une victoire écrasante. Les Israéliens ont tout conquis : la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Golan, la péninsule du Sinaï et Jérusalem-Est. Les voisins arabes finissent par récupérer leurs territoires, mais les Palestiniens, n’ont plus jamais repris le contrôle de leurs terres. Le Conseil de Sécurité de l’ONU adopte la résolution 242 qui condamne l’acquisition des territoires par la guerre.
6 octobre 1973 : L’Égypte et la Syrie lancent une attaque surprise et inédite contre Israël, au moment de Yom Kippour, fête juive. Israël parvient finalement à repousser l’offensive. À la suite de cette guerre du Kippour, l’Égypte et Israël signent un accord de normalisation des relations à camp David, et Israël se retire du Sinaï (1978). L’Égypte est suspendue de la Ligue arabe. Le Conseil de Sécurité de l’ONU adopte la résolution 338 qui demande l’application de la résolution 242 et décide qu’un processus de négociation doit commencer.
1987 : Début de la première intifada – « la guerre des pierres ». Le peuple palestinien se soulève contre l’occupation israélienne. Les violentes émeutes, brutalement réprimées par l’armée israélienne, durent jusqu’en 1993. C’est au début de la première intifada que naît le Hamas ; à l’origine, un mouvement de jeunes inspirés par les Frères musulmans et qui estimaient que l’OLP ne combattait pas suffisamment Israël et qu’il fallait organiser la résistance armée.
15 novembre 1988 : Yasser Arafat, qui jusqu’ici refusait le plan de partage de l’ONU et prônait la résistance armée, annonce la création d’un État palestinien sur le principe des résolutions 181, 242 et 338 ; et de ce fait, reconnait implicitement Israël.
1991 : Première tentative de négociation à Madrid entre Israël et les pays arabes sous l’égide des États-Unis et de l’URSS. Les Palestiniens sont intégrés dans une délégation jordano-palestinienne.
13 septembre 1993 : Les accords d’Oslo sont scellés par une poignée de main historique entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Le processus d’Oslo s’est déroulé dans le secret, en parallèle des négociations à Madrid qui n’aboutissaient pas. L’accord est une déclaration de principes qui donne naissance à l’Autorité Palestinienne et qui prévoit une période de transition de 5 ans afin d’aboutir à la création d’un État palestinien. Cette période de transition n’a jamais été dépassée et les accords n’ont finalement jamais été appliqués.
4 novembre 1995 : Pendant son discours sur la paix, Yitzhak Rabin, Premier Ministre israélien, est assassiné par un juif extrémiste opposé aux accords d’Oslo.
Juillet 2000 : Des négociations reprennent à Camp David, sous l’égide des États-Unis. Les questions territoriales, le statut de Jérusalem et la question des réfugiés palestiniens paralysent le processus qui finit par échouer. Yasser Arafat est accusé d’avoir fait échouer les pourparlers.
28 septembre 2000 : Après l’échec de Camp David, Ariel Sharon, chef de l’opposition nationaliste de droite en Israël, fait une visite controversée sur l’esplanade des Mosquées/Mont du temple à Jérusalem (Voir Lexique en pied de page). La deuxième intifada, encore plus meurtrière que la première, éclate.
2002 : Ariel Sharon, qui a été élu Premier Ministre d’Israël, prend la décision de construire « un mur de sécurité » (Voir Lexique en pied de page) entre Israël et les Territoires palestiniens.
2003 : L’initiative de Genève, qui prévoit un plan de paix très détaillé, est signé par Yossi Beilin, Ministre israélien et Yasser Abd Rabbo, Ministre palestinien. L’accord est reconnu par l’Autorité Palestinienne mais rejeté par Ariel Sharon et le Hamas. Le plan de paix n’a jamais été appliqué.
2005 : Mahmoud Abbas succède à Yasser Arafat, mort en 2004, à la tête de l’OLP. Israël se retire de la bande de Gaza après 38 ans d’occupation, conformément au plan de désengagement unilatéral d’Ariel Sharon.
2006 : Des élections législatives sont organisées en Palestine et remportées par le Hamas. Les élections ont été surveillées par des observateurs internationaux qui en ont validé le bon déroulement démocratique. Pourtant, lorsque le Hamas a remporté ces élections, la communauté internationale a choisi de ne pas reconnaître le résultat et de faire pression sur l’Autorité Palestinienne pour qu’ils ne donnent pas le pouvoir au Hamas, vainqueur des urnes.
2007 : Le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza, tandis que l’Autorité Palestinienne garde le contrôle sur la Cisjordanie. Depuis, la Palestine est divisée politiquement et plus aucune élection n’a pu être organisée.
2009 : Benyamin Netanyahu est élu Premier Ministre d’Israël, il encourage nettement la colonisation en Cisjordanie et durcit la politique sécuritaire.
2020 : Donald Trump, en présence de Netanyahu, présente « le plan de paix américain pour le conflit israélo-palestinien » qui a été négocié sans les Palestiniens. Ces derniers refusent ce plan favorable à Israël. Les accords d’Abraham sont pourtant signés et normalisent les relations d’Israël avec les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn, puis, avec le Soudan et le Maroc.
7 octobre 2023 : Depuis la bande de Gaza, le Hamas conduit une série d’attaques et d’atrocités contre des militaires et civils israéliens. 1 200 Israéliens sont tués et 240 otages sont amenés dans la bande de Gaza. En représailles, une opération militaire israélienne, visant à éliminer le Hamas, est lancée contre Gaza. Début février 2024, le ministère de la Santé de Gaza compte plus de 27 000 morts Palestiniens.
(Source : https://www.un.org/unispal/fr/faits-et-chiffres/)
5,6 millions de réfugiés palestiniens ont été contraints de quitter le territoire sur lequel ils habitaient.
61% de la superficie de la Cisjordanie est interdite aux Palestiniens.
3 572 Palestiniens, 198 Israéliens tués entre 2011-2021.
593 checkpoints israéliens en Cisjordanie visant à contrôler la circulation des Palestiniens.
Plus de 630 000 colons (Voir Lexique en pied de page) installés en Cisjordanie dans 150 colonies établies officiellement et 128 colonies érigées sans l’autorisation d’Israël.
85% des ressources palestiniennes d’eau sont contrôlées par Israël.
2 millions de Palestiniens sont en situation d’insécurité alimentaire.
Un conflit territorial entre deux peuples
Le rappel des faits historiques et des chiffres est essentiel. Cependant, il faut aussi comprendre l’essence du conflit. Il y a beaucoup de confusions sur la nature de la confrontation israélo-palestinienne. Est-ce une guerre de religion entre juifs et musulmans ? Une guerre entre des groupes terroristes et un État ? En réalité, le conflit israélo-palestinien est avant tout un conflit territorial entre deux peuples.
Les enjeux principaux sont le contrôle du territoire et la souveraineté. Un peuple, les Palestiniens, vivait sur cette terre, administrée par les Ottomans puis par les Anglais. Un autre peuple, les Juifs, persécutés ailleurs, a commencé à émigrer sur cette même terre avec laquelle ils ont un lien religieux et historique. Depuis, l’équation est claire : deux peuples veulent habiter sur la même terre et en revendiquent le contrôle.
Toutes les grandes étapes du conflit sont profondément liées à des enjeux territoriaux. 1948 a marqué le début du conflit : Ben Gourion a proclamé l’État d’Israël et c’était le début de la « Nakba », l’expulsion de 800 000 Palestiniens. Le conflit israélo-palestinien est donc né de la création d’un nouvel État revendiquant sa souveraineté sur une terre et de l’expulsion du peuple qui habitait cette terre. La guerre de 1967, qui a été un moment charnière, n’était autre qu’une affaire de conquête de territoires. Israël a, par la force, pris le contrôle de tout le territoire et a même occupé une partie de l’Égypte, de la Syrie et du Liban. À l’inverse, en 2005, le retrait des Israéliens de la bande de Gaza a également été un grand tournant.
De la même manière, toutes les négociations portent avant tout sur des considérations territoriales. En 1978, lors des accords de camp David, l’Égypte a accepté de reconnaître l’existence de l’État d’Israël, en échange de pouvoir récupérer le contrôle de la péninsule du Sinaï. En 1995, à la suite des accords d’Oslo, un découpage territorial de la Cisjordanie a été négocié : les zones A sont placées sous contrôle palestinien, les zones B sous contrôle civil palestinien mais contrôle militaire israélien et les zones C sous contrôle israélien. En 2000, l’attribution du contrôle de Jérusalem est un des sujets qui a paralysé les négociations à Camp David.
Un combat mètre carré par mètre carré
Dans cette guerre pour le territoire, le combat se mène mètre carré par mètre carré. En ce sens, Israël utilise de nombreux outils. La colonisation est une des armes principales. Des terres qui ont été attribuées par l’ONU aux Palestiniens sont réquisitionnées, parfois des habitations palestiniennes sont démolies, pour construire des colonies (Voir Lexique en pied de page) où des colons Israéliens viennent s’installer et occuper le territoire.


La construction du « mûr de sécurité » (Voir Lexique en pied de page) est aussi un outil territorial. Officiellement, le mur devait être construit sur la « ligne verte » (frontière établie par le plan de partage de l’ONU de 1947) et devait avoir pour fonction de faire un barrage sécuritaire. Cependant, le mur est ostensiblement construit plus à l’Est que la frontière prévue par l’ONU, ce qui permet aux Israéliens de gagner, de facto, du terrain. De plus, alors que la ligne verte ne mesure que 315 km, le mur fait plus de 700 km parce qu’il fait des tours et des contours qui permettent de grignoter des bouts de territoires palestiniens.

À ceci s’ajoute la construction de routes interdites aux Palestiniens, la démolition d’habitations et l’interdiction de construire pour les Palestiniens, l’isolation de certains commerces palestiniens pour les contraindre à partir, l’omniprésence des militaires israéliens et les checkpoints partout en Cisjordanie… En somme, les Israéliens remportent le combat territorial.
Les territoires palestiniens rétrécissent à vue d’œil pendant que les colonies israéliennes se multiplient…
De l’autre côté, les Palestiniens ne se déclarent pas vaincus et essayent désespérément de garder des bouts de terre. Certains Palestiniens expulsés choisissent de rejoindre des camps de réfugiés en Cisjordanie (858 000 réfugiés) ou à Gaza (1,4 millions de réfugiés) plutôt que de partir dans les pays voisins ; parce qu’ils estiment que rester est une manière de résister. Lors d’un échange avec une jeune fille dans un camp de réfugiés en Cisjordanie, elle m’a confié : « ils [les israéliens] nous rendent la vie impossible, parce qu’ils veulent que nous partions, mais en restant ici je résiste ! Je résisterai jusqu’à ma mort… ». Reste que les territoires palestiniens rétrécissent à vue d’œil pendant que les colonies israéliennes se multiplient…


Amalgames sur l’essence du conflit
Ainsi, le conflit israélo-palestinien est avant tout un conflit territorial. Il ne faut pas se tromper sur la nature du conflit, sinon les analyses que nous en feront sont vouées à être erronées.
Le conflit israélo-palestinien n’est pas un conflit de religions. Certes la religion est en toile de fond puisque la terre disputée est la « terre sainte », berceau des trois religions monothéistes. L’attachement à cette terre est renforcé par la présence des lieux saints. Par exemple, la Mosquée Al-Aqsa (troisième lieu Saint de l’Islam) et le mur des lamentations (endroit le plus saint pour les juifs) au cœur de la vielle ville de Jérusalem, expliquent en partie le refus catégorique des Israéliens et des Palestiniens de céder sur le statut de Jérusalem. Cependant, ce n’est pas un conflit qui oppose la religion juive à la religion musulmane. C’est un conflit entre deux peuples, les juifs et les arabes palestiniens (dont une partie sont chrétiens) pour obtenir le contrôle d’une terre.


Ceci-dit, comme l’a écrit Alain Dieckhoff [1], le facteur religieux est parfois instrumentalisé de part et d’autre. Par exemple, le Hamas s’est appuyé sur l’islam pour se légitimer en opposition à l’Autorité Palestinienne laïque. À l’inverse, dans le nouveau gouvernement Netanyahu certains ministres sont issus de partis juifs ultraorthodoxes comme le Foyer juifs ou le Judaïsme unifié de la Torah. Le facteur religieux est aussi souvent utilisé par l’État hébreu pour justifier la colonisation. Néanmoins, si certains acteurs choisissent de « jouer la carte de la religion » (Alain Dieckhoff), cela ne veut dire pour autant que nous sommes face à un conflit de religions.
Par ailleurs, dépeindre le conflit comme une guerre asymétrique entre des groupes terroristes et un État, est une grille de lecture extrêmement limitée. C’est incontestablement un conflit asymétrique puisque les forces en présence sont complétement déséquilibrées en faveur d’Israël. Cependant, parler de conflit entre des groupes terroristes et un État est en réalité une manière de délégitimer l’une des parties, les Palestiniens, tout en légitimant la partie adverse, Israël. Certains acteurs, de part et d’autre, dont le Hamas, doivent être qualifiés de terroristes. Cependant, pour saisir le fond du conflit, il faut comprendre que c’est avant tout deux peuples qui luttent pour une même terre par différents moyens.
L’aspect territorial : obstacle principal à la résolution de conflit
Par ailleurs, c’est précisément l’aspect territorial du conflit qui rend sa résolution complexe. Comment deux ennemis peuvent-ils être chez eux au même endroit ? C’est un jeu à somme nulle : les gains de l’un, égaleront les pertes de l’autre. Les générations se multiplient mais personne, ni d’un côté ni de l’autre, ne renonce à ce qu’ils estiment être leur terre. Une jeune fille palestinienne née dans un camp de réfugiés, me parle d’Hébron, ville de laquelle sa famille a été délogée par une colonie israélienne il y a pourtant deux générations, comme « chez elle ».
À ce conflit territorial, la seule solution véritablement envisagée et envisageable reste la « solution à deux États ». Autrement dit, il faut diviser la terre de manière équitable entre un État Palestinien et un État Israélien qui seront souverains sur leur portion et pourront vivre en sécurité, et en tout liberté.
Néanmoins, les colonies sont incontestablement une difficulté pour la mise en place d’une solution à deux États. L’extension des colonies en Cisjordanie a démembré le territoire palestinien qui ressemble à archipel (voir cartes ci-dessus). Afin d’obtenir une continuité territoriale nécessaire à un État palestinien viable, il faudrait vider les colonies israéliennes. Une solution que les plus de 600 000 colons et le gouvernement Netanyahu, qui au contraire encourage la colonisation, ne sont pas prêt à accepter…
Les Israéliens et les Palestiniens sont irrémédiablement voisins
Enfin, un des aspects qui caractérise et qui complexifie la résolution de ce conflit est l’imbrication sur le terrain. La surface est extrêmement limitée et tout est imbriqué. Les Israéliens et les Palestiniens sont irrémédiablement voisins. Malgré la haine, les murs, les barrières culturelles et linguistiques – ils vivent côte à côte et les séparations sont artificielles. La vieille ville de Jérusalem incarne cette imbrication qui complexifie la situation : d’une rue à l’autre on passe du souk arabe au quartier juif. Il est possible d’entrer sur l’esplanade des Mosquées par le mur des lamentations juif.

Hébron incarne aussi cette imbrication. Là les colonies se sont carrément implantées dans certaines rues de la ville. Il faut passer des tourniquets et des contrôles d’une rue à l’autre. Tandis que le tombeau des patriarches a été divisé en deux, d’un côté une mosquée et de l’autre une synagogue. Or, cette imbrication ne peut pas être négligée. Nous ne pouvons pas traiter ce conflit comme un conflit où une fois réglé chacun repartira chez soi : en Israël et en Palestine les deux peuples devront vivre ensemble.
Stratégie d’invisibilisation du problème palestinien
Le 7 octobre 2023 a surpris le monde entier. Nous avons été choqués, à juste titre, par la cruauté et la barbarie des attaques perpétrées sur des civils. Mais l’opinion publique mondiale a aussi été surprise de la violente réactivation d’un conflit qui était majoritairement oublié…
En réalité, c’est en grande partie le résultat d’une stratégie politique d’invisibilisation finement orchestrée par Netanyahu. En effet, le Premier Ministre israélien a, depuis des années, mis en place une stratégie politique qui consiste à minimiser et à faire oublier le problème palestinien. Auprès de la population israélienne et aux yeux de la communauté internationale, le gouvernement israélien entretenait l’idée qu’il n’y avait plus vraiment de conflit israélo-palestinien, ou qu’il était au point mort, et que la question palestinienne était sous contrôle ou sommeillait.
Pour nourrir ce discours, Netanyahu a mobilisé plusieurs outils. Par exemple, afin que personne n’envisage de nouvelles négociations, Netanyahu a nourri l’idée que du côté palestinien il n’y avait pas d’interlocuteur politique légitime. Depuis 2006, il n’y a pas eu d’élections et la Palestine est divisée politiquement entre l’Autorité Palestinienne et le Hamas, reconnu comme terroriste par un certain nombre d’États alliés d’Israël. Une situation dont Netanyahu s’est servi, et a entretenu, pour progressivement faire oublier le besoin de négocier… Par ailleurs, la menace iranienne a aussi été un outil instrumentalisé par le Premier Ministre israélien. Ces dernières années, il a largement agité la menace iranienne pour démontrer que le problème qui mérite attention est l’Iran et non pas les Palestiniens. Une stratégie qui s’est avérée très efficace à la fois vis-à-vis de la population israélienne et vis-à-vis de la communauté internationale.
L’organisation d’une rave-party à 6 km de Gaza témoigne de la profondeur du déni dans lequel une partie de la population israélienne était plongée…
Une stratégie efficace
La population israélienne ne se préoccupait plus du problème palestinien. Sur le terrain, l’évolution était notable. Avant le 7 octobre 2023, les Israéliens avaient deux préoccupations majeures : l’Iran et la réforme de la justice de Netanyahu. Les faire parler des Palestiniens était devenu difficile. Ils n’avaient rien à dire à ce propos, comme si le problème était réglé, voire n’existait pas… La population, et notamment les jeunes cosmopolites dans les grandes villes, était dans une sorte de déni très étonnant lorsqu’on connait ce qui se passe de l’autre côté du mur. Un déni symbolisé par la rave-party qui s’est tenue proche de Gaza et qui a été épouvantablement attaquée par le Hamas. L’organisation d’une rave-party à 6 km de Gaza, que l’ancien Premier Ministre Dominique de Villepin [2] a décrit comme « l’enfer sur terre », démontre la profondeur du déni dans lequel la population israélienne était plongée…
Par ailleurs, la stratégie d’invisibilisation était également très efficace vis-à-vis de la communauté internationale. Alors que résoudre le conflit israélo-palestinien a été le rêve de plusieurs grands présidents, depuis les années 2000 plus personne n’avait l’ambition d’organiser des négociations. La cause palestinienne n’était plus à l’agenda diplomatique. Les dirigeants et les organisations internationales avaient d’autres priorités : le terrorismedjihadiste, le climat, la covid-19, la guerre russe en Ukraine, les migrations, la cybersécurité… Il en allait de même pour l’opinion publique mondiale ; le problème du Proche-Orient ne préoccupait plus vraiment.
Les accords d’Abraham, conclus en 2020, ont cristallisé cette invisibilisation du problème palestinien. Alors qu’historiquement, la cause palestinienne unissait le monde arabe et que les pays arabes soutenaient inconditionnellement le peuple palestinien, en 2020, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc ont choisi de normaliser leur relation avec l’État d’Israël sans exiger aucune concession pour les Palestiniens en retour.
Le monde avait les yeux fermés sur une réalité qui n’a pourtant jamais cessé d’exister. Ce déni était une souffrance supplémentaire pour le peuple palestinien qui vivait le désespoir au quotidien. En 2020, Sahar Qawasmi, député d’Hébron, m’avait demandé : « Pourquoi sommes-nous l’exception des droits humains ? ». Pour le peuple palestinien, taire leur souffrance et oublier leur situation était une injustice incompréhensible qui permettait, en parallèle, à Israël de poursuivre sa politique de colonisation en toute impunité. En ce sens, les accords d’Abraham, ont été accueillis par l’Autorité Palestinienne comme une trahison terrible.
Le 7 octobre 2023 a brisé violement l’invisibilisation dans laquelle le problème palestinien était plongé
7 octobre 2023 : une rupture
Dans ce contexte d’invisibilisation, les attaques du Hamas sont arrivées comme une surprise et ont stupéfait le monde entier. Pourtant, sur le terrain, l’escalade était prévisible. Plus personne ne parlait de « paix » ou de « solution à deux États ». La jeunesse palestinienne n’avait plus aucun espoir ni politique, ni de négociations, ni de perspectives meilleures. Les jeunes parlaient de plus en plus de « résistance par tous les moyens ». Les dirigeants de l’Autorité Palestinienne qui continuaient de défendre la voix pacifique avertissaient qu’ils craignaient ne plus pouvoir contenir la colère de leur population. Plusieurs d’entre eux m’ont confié que si la situation ne changeait pas et que la communauté internationale n’arrêtait pas l’occupation d’Israël, l’escalade de violence serait inévitable. Paradoxalement, mis à part les Palestiniens, personne, ni les Israéliens, ni la communauté internationale, ne semblait craindre un tel soulèvement et une telle violence.
En réalité, la tragédie du 7 octobre 2023 a brisé violement l’invisibilisation dans laquelle le problème palestinien était plongé. Le sujet n’est pas nouveau, nous en avons simplement repris conscience.
Le conflit israélo-palestinien est redevenu une préoccupation pour l’opinion publique mondiale. Les évènements à Gaza font la Une des médias depuis l’attaque du Hamas ; en relayant presque la guerre en Ukraine au deuxième plan. Les réseaux sociaux sont inondés de publications, favorables aux uns ou aux autres, sur la situation au Proche-Orient. C’est un sujet qui revient au cœur des débats avec beaucoup d’émotions : ce sont des questions qui fracturent fortement nos opinions publiques.
La cause palestinienne est redevenue un sujet de mobilisation. À travers le monde, de nombreuses manifestations propalestiniennes ont été organisées. Plusieurs personnalités médiatiques ont exprimé leur soutien aux Palestiniens ; certaines comme l’actrice Susan Sarandon – qui a été limogée par son agence artistique (UTA) – en ont payé le prix fort… Les réseaux sociaux sont activement utilisés comme plateforme pour le soutien de la cause palestinienne. Au sein du monde arabe la cause palestinienne est redevenue un sujet de préoccupation et d’identification. Même dans les États du golfe où les gouvernements se rapprochaient de plus en plus de l’État hébreu, les populations expriment maintenant clairement leur soutien aux Palestiniens.
Par ailleurs, la situation au Proche-Orient est redevenue un sujet de préoccupation pour les organisations et les acteurs politiques. Le conflit israélo-palestinien est à nouveau à l’agenda diplomatique. En témoigne les déplacements des dirigeants sur le terrain ; comme la visite d’Emmanuel Macron en Israël et en Cisjordanie. L’ONU s’est ressaisi du problème. Plusieurs sessions du Conseil de Sécurité ont été dédiées à la situation à Gaza, même si l’adoption de résolutions est complexifiée par l’usage du véto, notamment américain. Antonio Guterres, Secrétaire Général de l’ONU, a formulé à plusieurs reprises son soutien à la solution à deux États et le besoin d’un cessez le feu.
En somme, que nous le voulions ou non, le conflit israélo-palestinien reste central et l’écarter n’est pas une option viable à long terme. La situation humanitaire catastrophique ne peut pas être ignorée. De plus c’est un conflit qui divise à plusieurs niveaux.
C’est un conflit qui divise nos sociétés. Depuis le 7 octobre 2023, il y a une fracture notable dans nos sociétés européennes entre ceux qui défendent le droit d’Israël à se défendre et ceux qui soutiennent les droits du peuple palestinien. Il y a eu une résurgence des actes antisémites et racistes. Les partis politiques se sont positionnés et se sont servis des évènements selon leurs intérêts. Par exemple, en France, le caractère islamique du Hamas a servi les discours anti-immigration portés par l’extrême droite ; tandis que la cause palestinienne est portée par des partis de gauche.
C’est aussi un sujet qui divise le monde entre les pays du sud qui soutiennent majoritairement la Palestine, et les pays du nord qui soutiennent majoritairement Israël. Alors que la fracture entre d’un côté les démocraties occidentales, et de l’autre côté, les États du sud, les émergents et les régimes autoritaires se creusait déjà, le conflit israélo-palestinien vient l’accentuer. Le soutien inconditionnel des États-Unis et l’appui des Européens à Israël participent à nourrir l’idée que « l’Occident oppresse les peuples du sud et qu’il ne respecte le droit international que selon ses intérêts ». Un discours qui sert des États comme la Russie, l’Iran ou la Chine qui veulent justement faire tomber l’ordre mondial établi et cherchent des soutiens auprès des États qui se sentent oppressés par l’Occident.
Ainsi, le conflit israélo-palestinien et ses conséquences ne peuvent pas être ignorés. L’asymétrie entre les parties au conflit est telle que la solution ne pourra venir que de l’extérieur. La communauté internationale doit s’engager pour trouver une solution qui permettra de garantir les droits des uns et des autres. La solution à deux États reste la seule solution acceptable. Pour la mettre en œuvre et qu’elle fonctionne, il faudra prendre en compte la réalité du terrain.
Copyright Février 2024-Durrieu/Diploweb.com
Mise en ligne initiale sur le Diploweb.com le 18 février 2024.
Bonus. Vidéo et synthèse rédigée. Proche-Orient : la paix a-t-elle encore un avenir ? Ambassadeur E. Danon
Cette vidéo peut être diffusée en amphi pour nourrir un cours et un débat. Voir sur youtube/Diploweb
Voir la synthèse rédigée de la conférence, par M-C Reynier, validée par E. Danon.
https://www.revueconflits.com/guerre-au-nord-kivu-lonu-eclaire-un-conflit-tres-meurtrier/
Le rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo révèle une aggravation continue de la situation sécuritaire et humanitaire dans l’est du pays. Ce document des Nations unies met en lumière l’intensification des violences et équilibre les responsabilités des différents acteurs.
Guerre oubliée alors qu’elle engendre des millions de déplacements et des milliers de morts, la guerre qui sévit au Nord Kivu est de nouveau sous les feux des projecteurs avec un rapport de l’ONU publié le 8 juillet. Entretien avec Fleury Venance Agou sur les enseignements de ce rapport.
Fleury Venance Agou est doctorant en intelligence économique (Université de Bangui, Centrafrique). Propos recueillis par la rédaction
La situation au Nord-Kivu est chaotique. Le rapport souligne que les Forces démocratiques alliées (ADF), groupe armé opérant à la fois en RDC et en Ouganda, ont intensifié leurs attaques, dont les civils constituent les principales victimes.
Les affrontements entre le Mouvement du 23 mars (M23) et les Forces de défense rwandaises (RDF) contre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et leurs alliés locaux, se sont également aggravés, entraînant la conquête de nouvelles zones stratégiques par le M23. Selon le rapport, cette situation a provoqué le déplacement de près de 1,7 million de personnes au Nord-Kivu et environ 500 000 personnes supplémentaires vers le Sud-Kivu. Ces millions de personnes vivent dans le dénuement le plus total.
En 2023, les ADF ont été responsables de “plus de 1 000 décès, principalement des civils”. Les ADF est “le groupe armé commettant le plus grand nombre de meurtres en RDC” cette année-là. Leur stratégie consiste à éviter les forces de sécurité et à cibler les civils, en représailles aux opérations militaires menées contre eux. Ils ont également établi des réseaux de collaborateurs, en utilisant des détenus pour recruter et organiser des soutiens.
Le Rwanda est lui directement impliqué par le soutien qu’il apporte au M23. Les Forces de défense rwandaises (RDF) ont non seulement appuyé le M23 dans ses opérations militaires, mais ont aussi été accusées de participer directement aux combats et de contribuer à l’instabilité régionale. Selon le rapport, “le M23 et le RDF ont continué de punir les civils perçus comme ayant collaboré avec des groupes armés ennemis, en particulier parmi la population hutu perçue comme associée aux FDLR ou Nyatura, sous forme d’exécutions, de tortures, de destructions de villages, de pillages ou de détentions arbitraires”.
En République démocratique du Congo, les Forces armées de la RDC (FARDC) sont impliquées dans des affrontements violents avec le M23 et les RDF. Malgré leur rôle dans la défense du territoire, les FARDC ont été critiquées pour leurs abus et erreurs, notamment dans l’utilisation excessive de l’artillerie lourde, qui a causé des victimes civiles. Les FARDC ont aussi souvent utilisé des groupes armés locaux sous la bannière “Wazalendo” comme proxies, compliquant davantage la situation sécuritaire. Ces groupes ont mené des opérations conjointes, mais les Wazalendo, souvent hors de contrôle, se sont livrés à des pillages en toute impunité dans des villes comme Goma. Constitués de milices locales, ces derniers se sont multipliés en réponse à l’insécurité. Ils commettent de graves violations des droits de l’homme, y compris des enlèvements, des “extorsions, des pillages, des détentions illégales, des tortures, des viols et des meurtres”. Les Wazalendo ont prospéré dans une économie de guerre violente, imposant des taxes illégales pour financer leurs activités.
Enfin, divers groupes armés locaux, prétendant protéger la population, ont commis des abus tels que des meurtres, des enlèvements et des taxations illégales. Ces groupes manipulent les dynamiques locales pour légitimer leurs actions, galvanisant ainsi les tensions et violences régionales.
Le rapport souligne en effet les responsabilités de plusieurs acteurs dans l’utilisation d’enfants soldats, y compris la position litigieuse du Président Félix Tshisekedi.
Il a été rapporté que Tshisekedi a justifié l’utilisation d’enfants soldats en utilisant des arguments de “force majeure”, bien que cela contrevienne aux engagements légaux de la RDC de libérer tous les enfants de moins de 18 ans des groupes armés.
Le recrutement d’enfants soldats est un phénomène courant dans de nombreux pays africains, motivé par l’insécurité chronique et le manque de ressources. Les enfants sont souvent enrôlés en raison de la vulnérabilité de leurs familles face à l’insécurité et à la rareté des ressources. En RDC, l’intensification du conflit a vu une augmentation significative du recrutement d’enfants par des groupes armés comme le M23 et les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR).
Pour le gouvernement de la RDC, il est recommandé d’enquêter sur l’utilisation d’armes explosives, y compris les explosifs transportés par drones, et de s’abstenir de les utiliser dans les zones peuplées. Il est également conseillé de cesser toute collaboration avec les groupes armés, en particulier les Forces démocratiques de libération du Rwanda-Forces combattantes abacunguzi (FDLR-FOCA), et de démanteler les réseaux des ADF dans les prisons.
Concernant l’utilisation d’enfants soldats, le rapport recommande au gouvernement de la RDC de mettre en œuvre la législation nationale de 2009 (Loi n° 09/001) en enquêtant et en poursuivant tous les individus responsables du recrutement, de la formation et de l’utilisation d’enfants soldats, et de prendre des mesures immédiates pour assurer leur libération.
Le gouvernement rwandais se voit recommander de retirer ses forces armées et son armement de la RDC, et de veiller à ce que la Raffinerie d’Or de Gasabo (GGR) se conforme aux directives de diligence raisonnable, notamment en vérifiant l’origine de l’or.
Enfin, le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda doivent cesser toute collaboration avec les groupes armés actifs en RDC et enquêter et poursuivre les individus et les réseaux impliqués dans la contrebande d’or.
Reste à voir comment la communauté internationale réagira. Jusque-là, la responsabilité du Rwanda était surtout médiatisée – responsabilité qui n’est pas niée par ce rapport au demeurant. Désormais, chaque acteur fait l’objet de recommandations claires et précises. Cependant, la situation est très incertaine, dans un contexte où les prises de parole des autorités nationales sont de plus en plus virulentes. En définitive, il n’est pas certain que les grands acteurs internationaux, dont les regards sont braqués sur l’Ukraine et le Moyen Orient, n’aient ni les moyens ni la volonté de s’immiscer dans ce bourbier.
par Eduard Abrahamyan* – CF2R – publié en juillet 2024
L’alliance civilisationnelle et géopolitique entre les régimes autocratiques de Russie et d’Azerbaïdjan est de plus en plus évidente, en particulier dans la promotion conjointe par ce duo d’un ordre régional non occidental dans le Caucase du Sud. Cette alliance se traduit par la normalisation de l’usage de la force, du nettoyage ethnique et d’un comportement antagoniste aux intérêts, aux valeurs et aux normes de l’Occident, comme en témoignent les actions analogues de la Russie contre l’Ukraine et de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie et contre les Arméniens du Haut-Karabakh. L’alliance Poutine-Aliev s’est progressivement dotée d’un cadre formel, portant le partenariat stratégique établi en 2008 au niveau d’une « interaction alliée » dans un contexte d’aggravation de la multipolarité concurrentielle entre l’Occident et le non-Occident. Cette relation spéciale a été soulignée par l’importante déclaration bilatérale signée par les deux dirigeants à Moscou le 22 février 2022, deux jours avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie[1]. Comme l’a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, « l’Azerbaïdjan est un partenaire stratégique important, un bon voisin et un allié fiable de la Russie »[2]. Le dirigeant azerbaïdjanais Ilham Aliev, a répondu à cette appréciation matérialisée par le retrait des « soldats de la paix » russes du Nagorno-Karabakh – la région où il a perpétré le nettoyage ethnique des Arméniens – en soulignant que « la Russie est un pays fondamental en termes de sécurité régionale dans le Caucase et dans une géographie plus large »[3] et que « la Russie ne quittera jamais cette région », suggérant que « d’autres pays devraient être intéressés par le maintien de bonnes relations avec elle »[4].
Toutefois, l’engagement pris par Poutine et Aliev de renforcer « l’interaction entre les alliés » ne se limite pas au Caucase du Sud, mais s’étend à la coopération stratégique mondiale. Cette coopération est motivée en partie par une vision commune visant à consolider la lutte géopolitique contre le soi-disant « néocolonialisme occidental », comme l’ont unanimement exprimé les régimes d’Aliev et de Poutine, aux dépens des valeurs et des intérêts occidentaux dans leur ensemble[5]. Dans ce contexte, la présente analyse évoque les activités récentes de l’Azerbaïdjan afin de saper l’effort de guerre ukrainien, au profit de Moscou.
Il y a tout d’abord la réorientation vers l’Azerbaïdjan de munitions d’artillerie fabriquées en Bulgarie et initialement destinées à l’Ukraine. Sofia est le partenaire stratégique de Bakou depuis 2015, l’Azerbaïdjan jouant un rôle croissant sur le marché bulgare de l’énergie (fourniture de gaz naturel et exploitation d’infrastructures de transit)[6].
On sait moins que l’Azerbaïdjan a manifesté son intérêt pour le secteur bulgare de la défense vers 2016-2017. Selon un journaliste d’investigation bulgare, qui a requis l’anonymat en raison de la sensibilité de la question, l’Azerbaïdjan a cherché à investir dans DUNARIT Corporation, Arcus Co. et Armaco JSC, d’importantes sociétés de production de matériel militaire bulgares. L’Azerbaïdjan était particulièrement intéressé par la production et l’importation de munitions de mortier et d’artillerie de l’ère soviétique, y compris les obus à chargement séparé de 122 mm.
Compte tenu de la disponibilité limitée des munitions standards soviétiques/russes sur le marché mondial et du déficit de l’Ukraine en matière d’artillerie, les fabricants bulgares de matériel de défense semblent avoir réorienté leurs approvisionnements vers l’Azerbaïdjan. Les données de Flightradar24 indiquent que la flotte des avions cargos lourd Iliouchine Il-76MD des forces armées azerbaïdjanaises a effectué des vols de fret réguliers entre la mi-février et la mi-mars (six vols aller-retour confirmés) entre Burgas et Bakou. Cela suggère l’importation par l’Azerbaïdjan de production militaire bulgare et l’interruption partielle des livraisons à l’Ukraine. Une source du ministère ukrainien de la Défense a laissé entendre que la priorité accordée aux livraisons d’armes azerbaïdjanaises avait quelque peu affecté la quantité et le calendrier des livraisons bulgares à l’Ukraine. Cela fait écho à la plainte du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la suite des négociations avec le Premier ministre bulgare Nikolay Denkov à Kiev. M. Zelensky s’est inquiété du fait que seuls 30% des obus d’artillerie promis par la Bulgarie avaient atteint l’Ukraine dans les délais impartis[7].
Bien que ces interruptions des livraisons militaires à l’Ukraine soient relativement mineures, le rôle de l’Azerbaïdjan a une importance géopolitique. Ces perturbations ciblées permettent à Bakou d’accroître sa valeur stratégique vis-à-vis de Moscou.
Deuxièmement, il existe des preuves que l’Azerbaïdjan a joué un rôle dans le retardement des livraisons d’armes tchèques et slovaques à l’Ukraine. Les relations entre la Slovaquie et l’Azerbaïdjan se sont développées sous le gouvernement de Robert Fico, qui a entamé son troisième mandat de Premier ministre en octobre 2023. Fico, qui s’est prononcé contre le soutien militaire à l’Ukraine pendant les élections législatives, a réduit l’aide militaire à Kiev à partir de mars-avril 2024[8]. Ce changement de politique a affecté la production et l’acquisition de plateformes d’artillerie communes et d’autres équipements militaires létaux importants avec la République tchèque, qui sont essentiels pour l’Ukraine.
Dans le contexte de la dérive autoritaire de Fico – caractérisée par la consolidation du pouvoir intérieur et de ses politiques pro-russes – l’Azerbaïdjan a réussi à influencer les processus de production d’exportations militaires slovaques et tchèques, en réorientant certains équipements précédemment destinés à l’Ukraine.
Lors de leur visite à Bakou le 7 mai, Fico et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev ont signé la Déclaration conjointe de partenariat stratégique, ainsi que des documents relatifs à la coopération industrielle en matière de défense (les deux parties souhaitent mettre en place une production militaire commune)[9]. Il est intéressant de noter que la visite de Fico à Bakou a coïncidé avec les révélations selon lesquelles la société tchéco-slovaque Excalibur Army prévoit de livrer plus de 70 obusiers automoteurs DITA de 155 mm/L45 à l’Azerbaïdjan, ce qui représente la plus importante commande de systèmes d’artillerie tchéco-slovaque depuis 1989[10]. Dans ce contexte, la déclaration commune de Fico et Aliyev est remarquable : « lorsque j’ai entendu la position [d’Aliyev] sur l’Ukraine, j’ai pensé qu’il s’agissait de la position du gouvernement slovaque. En d’autres termes, nous avons une position très similaire »[11].
À la suite à la visite de Fico, le gouvernement slovaque a été accusé de donner la priorité aux accords militaires avec l’Azerbaïdjan plutôt qu’aux engagements envers l’Ukraine (la Slovaquie avait précédemment affecté 16 obusiers Zuzana 2 à l’Ukraine). En particulier, le député slovaque Juraj Krupa a noté que le ministre slovaque de la Défense avait donné la priorité aux commandes de l’Azerbaïdjan – et du fabricant tchèque – par rapport à un contrat existant avec l’Ukraine[12]. Les interventions de l’Azerbaïdjan en Slovaquie ainsi qu’en Bulgarie, sont sur le point d’accroître les lacunes de l’Ukraine en matière d’artillerie au profit des récentes avancées de la Russie.
Le troisième événement susceptible d’influencer la dynamique de la guerre en Ukraine semble être une opération conjointe des services de renseignement azerbaïdjanais et russes contre la France sur son territoire d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, dans l’océan Pacifique. Le 16 mai, des manifestations de la population autochtone se sont transformées en émeutes violentes contre les autorités françaises. Selon le gouvernement français, l’aggravation de la violence a été attisée par les services de renseignement azerbaïdjanais, éventuellement en coordination avec la Russie.
L’Azerbaïdjan mène une campagne subversive contre la France depuis la fin de l’année 2020. Lors de la défaite militaire d’Erevan en 2020, le président français Emmanuel Macron, soutenu par le Sénat français, a apporté son soutien à l’Arménie et à la population arménienne du Haut-Karabagh. Le gouvernement français a également condamné l’usage inconsidéré de la force par l’Azerbaïdjan, qui a culminé avec le violent nettoyage ethnique du Haut-Karabakh en septembre 2023[13]. Au cours de cette période, l’Azerbaïdjan a adopté une approche conflictuelle pour faire pression sur la France afin qu’elle abandonne sa politique de soutien au Haut-Karabakh et en faveur du renforcement militaire de l’Arménie. Dans le cadre de cet effort, Bakou a habilement encouragé et instrumentalisé les griefs des minorités ethno-politiques de l’outre-mer français contre Paris.
L’approche de Bakou reflète le défi lancé par Moscou à l’agenda unipolaire de l’après-Guerre froide mené par les États-Unis. Poutine et Aliyev plaident tous deux pour un ordre mondial non démocratique et non libéral sous couvert de s’opposer au soi-disant néocolonialisme occidental[14]. Ces dernières années, Bakou a cultivé des liens avec les mouvements d’indépendance de Corse, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, entre autres, par le biais de la création d’un « Groupe d’initiative de Bakou » (BIG). L’objectif global de ce groupe est exprimé dans son slogan politique, « vers la liquidation complète du colonialisme »[15]. La plateforme du BIG – qui promeut des récits ouvertement anti-français et eurosceptiques – comprend environ quatorze mouvements ethno-politiques de France et de ses territoires d’outre-mer[16]. La campagne de l’Azerbaïdjan contre les intérêts français a également été promue par d’autres canaux, y compris le Mouvement des non-alignés, le Conseil de coopération islamique et des engagements bilatéraux avec des alliés autoritaires tels que la Russie et la Chine.
Le ministre français de l’intérieur, Gérald Darmanin, a ouvertement révélé l’implication directe de l’Azerbaïdjan dans l’insurrection anti-française en Nouvelle-Calédonie. Le ministre a déclaré : « Ce n’est pas un fantasme. Je regrette que certains des séparatistes [de Nouvelle-Calédonie] aient passé un accord avec l’Azerbaïdjan »[17]. Politico, par l’intermédiaire de sources au sein des services de renseignement français, a également révélé que des activités hybrides azerbaïdjanaises et russes en Nouvelle-Calédonie ont été détectées pendant des semaines, voire des mois, « poussant le récit de la France comme un État colonialiste »[18]. Se vantant de l’implication de l’Azerbaïdjan dans l’éveil de sentiments anti-Paris dans les territoires français d’outre-mer, l’influenceur politique Farhad Mammadov, un protégé du conseiller présidentiel en politique étrangère Hikmat Hajiyev, a maintenu que les « efforts systématiques pour affaiblir la France doivent se poursuivre sans relâche ». Mammadov a également averti que « même si la partie française entame une normalisation, Bakou ne doit pas céder. Il ne s’agit pas seulement d’une réaction de l’Azerbaïdjan à […] la politique agressive de la France dans notre région, mais aussi d’un mécanisme permettant à l’Azerbaïdjan de se positionner dans les discussions futures sur l’ordre mondial »[19].
Il est également important de noter que les réactions de Bakou et de Moscou aux troubles en Nouvelle-Calédonie ont été étonnamment similaires, animées par une rhétorique teintée d’idéologie. Par exemple, en réponse à l’invitation faite par la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili à Emmanuel Macron de se rendre en Géorgie le jour de l’indépendance pour « libérer enfin le Caucase de l’influence russe », le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a fait remarquer avec sarcasme que « les seules personnes que Paris peut libérer sont les habitants autochtones de la Nouvelle-Calédonie du joug français »[20].
Dans le cadre du partenariat stratégique croissant entre le Kremlin et Bakou, Gregory Karasin, président de la commission des Affaires internationales du Conseil de la Fédération de Russie, a récemment annoncé que Moscou envisageait d’ouvrir une mission diplomatique dans la région du Nagorno-Karabakh, qui fait l’objet d’une épuration ethnique. Cette décision notable est probablement attribuable à l’opération azerbaïdjanaise en Nouvelle-Calédonie[21]. Une source anonyme au sein du ministère russe des affaires étrangères a interprété le geste de Moscou comme un « signe d’appréciation » pour la collaboration efficace des deux pays sur la scène internationale au cours des derniers mois.
L’opération de déstabilisation azerbaïdjano-russe en Nouvelle-Calédonie pourrait contraindre Paris à reconsidérer ses projets d’envoi de troupes en Ukraine, une possibilité que le président Macron n’a pas exclue en avril (la France réfléchit à surveiller les zones frontalières avec la Biélorussie). Les efforts déployés par Paris pour apporter un soutien militaire direct à l’Ukraine se sont heurtés à l’opposition farouche du Kremlin, l’administration de Poutine ayant promis de riposter en prenant pour cible le personnel français[22]. Un ancien diplomate de l’ambassade de France en Ukraine a suggéré, lors d’une conversation privée avec l’ISA, qu’une implication accrue des moyens policiers et militaires français en Nouvelle-Calédonie entraverait probablement les préparatifs du président Macron et ses projets d’envoi de troupes en Ukraine.
L’affaiblissement par l’Azerbaïdjan des chaînes d’approvisionnement ukrainiennes – et de ses capacités de défense – constitue un défi relativement nouveau pour Kiev et donne à Moscou un moyen de pression supplémentaire vis-à-vis de l’Occident. La campagne de subversion azerbaïdjanaise et russe contre la France pourrait contrarier les projets naissants de Macron d’intervenir sur le théâtre ukrainien, réduisant ainsi la marge de manœuvre de Kiev pour repousser les avancées russes. D’où l’intérêt pour Moscou de réduire la détermination française. Dans l’ensemble, les activités malveillantes de l’Azerbaïdjan et son partenariat croissant avec la Russie mettent en évidence l’efficacité croissante de la coordination autoritaire et la menace grandissante qu’elle fait peser sur les intérêts occidentaux.
[1] Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. 22 fév. 2022. http://kremlin.ru/supplement/5777
[2] Ambassade de la Fédération de Russie en République d’Azerbaïdjan. Об установлении дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. https://azerbaijan.mid.ru/ru/news/
[3] Ilham Aliyev s’est entretenu en tête-à-tête avec le président Vladimir Poutine. https://president.az/en/articles/view/65564
[4] Ilham Aliyev a participé au Forum international « COP29 et vision verte pour l’Azerbaïdjan ». https://president.az/en/articles/view/65580
[5] Ministère des affaires étrangères de Russie 2024. Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе Форума стороников борьбы с современыми практиками неколониализма – « За свободу наций ! ». https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1932745/
[6] Ilham Aliyev et le Président Rumen Radev ont fait des déclarations à la presse. https://president.az/az/articles/view/65772
[7] Brzozowski A., « L’Ukraine déclare n’avoir reçu que 30 % des obus d’artillerie promis par l’UE ». https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/ukraine-says-only-30-of-promised-eu-artillery-shells-received/
[8] « After their PM halts Ukraine aid, Slovaks dig deep to help », BBC News. 19 avril 2024. https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-68843542
[9] Présidence de la République d’Azerbaïdjan, 2024, « Des documents Azerbaïdjan-Slovaquie ont été signés », https://president.az/az/articles/view/65747
[10] Defence Turk: Azerbaijan to buy DITA wheeled self-propelled howitzers », Caliber.Az, 6 May 2024. https://caliber.az/fr/post/238301/
[11] « Ilham Aliyev et le Premier ministre Robert Fico ont fait des déclarations à la presse », https://president.az/az/articles/view/65748
[12] “Slovakian Government Accused of Sending Barrels Intended for Ukraine’s Zuzana 2 to Azerbaijan for DITA Instead”, Defense Express, 8 mai 2024. https://en.defence-ua.com/industries slovakian_government_accused_of_sending_barrels_intended_for_ukraines_zuzana_2_to_azerbaijan_for_dita_instead-10419.html
[13] « Le Sénat français adopte une résolution appelant à la reconnaissance de l’Artsakh ». ArmRadio, 25 novembre 2020, https://en.armradio.am/2020/11/25/french-senate-adopts-resolution-on-the-need-to-recognize-artsakh/
[14] « Алиевпризвалпокончитьсполитикойнеоколониализма,проводимойевропейскимидержавами », TASS Agency,1 mai 2024, https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20689957
[15] « FransamüstəmləkəçiliyinəqarşıBakıTəşəbbüsQruparadılıb-BƏYANAT », ReportAzerbaijan, 6 Juillet,2023, https://report.az/xarici-siyaset/fransa-mustemlekeciliyine-qarsi-baki-tesebbus-qrupu-yaradilacaq-beyanat/.
[16] « Bakı Təşəbbüs Qrupu və Fransanın son koloniyalarında müstəqillik mübarizəsi aparan 14 hərəkat Yeni Kaledoniyaya dəstək Bəyanatı yayıb », APA, 16 mai 2024, https://apa.az/xarici-siyaset/baki-tesebbus-qrupu-ve-fransanin-son-koloniyalarinda-musteqillik-mubarizesi-aparan-14-herekat-yeni-kaledoniyaya-destek-beyanati-yayib-842462
[17] Tweet vidéo de Telematin (télévision française) sur l’interview du ministre français de l’Intérieur. https://twitter.com/telematin/status/1790993081564881274
[18] « France accuses Azerbaijan of fomenting deadly riots in overseas territory NewCaledonia », Politico, 16 May 2024, https://www.politico.eu/article/france-accuse-azerbaijan-fomenting-deadly-riot-overseas-territory-new-caledonia/
[19] Telegram Channel of Farhad Mammadov, MneniyeFM, 29 mai 2024, https://t.me/mneniyefm.
[20] « ЗахаровапрокомментировалаприглашениеМакронавГрузию », RIA Novosti, 19 mai 2024. https://ria.ru/20240519/zakharova-1947020000.html.
[21] « СкороначнетсяподготовкакоткрытиюгенконсульстваРоссиивХанкенди-ГригорийКарасин », TrendAz, 27 May 2024, https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3904848.html
[22] Ministère russe des Affaires étrangères, 2024, https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1952348/
par Franck Alexandre – RFI – Publié le
Il y a un an le groupe de mercenaires russes Wagner entrait en rébellion contre le Kremlin. Une aventure militaire menée par Evgueni Prigojine après des mois de tensions entre son groupe et les autorités militaires russes sur la conduite des opérations en Ukraine. Le coup de force avait pris fin au bout de quelques jours et deux mois plus tard, Evgueni Prigojine disparaissait dans le crash de son avion. Mais que reste-t-il aujourd’hui du groupe Wagner qui avait incarné les ambitions russes notamment en Afrique ?

Le 23 août 2023, le groupe Wagner est décapité. Dans les débris de l’appareil d’affaire qui s’est écrasé peu après son décollage dans la région de Moscou, outre la dépouille d’Evgueni Prigojine, sont retrouvés les corps de Dimitri Outkine, son bras droit et de Valeri Chekakov chef de la logistique du groupe. L’empire Prigojine, qui disposait d’environ 50 000 mercenaires en Ukraine n’est plus.
Sur le front ukrainien les mercenaires passent sous la coupe de la RosGardia, la garde prétorienne de Vladimir Poutine. En Afrique les mercenaires intègrent une nouvelle firme : Africa corps, chapeautée par la GRU, le renseignement militaire russe, mais sur le continent, les ex-Wagner historiques sont encore bien présents dit Lou Osborn, analyste d’All Eyes on Wagner groupe de recherche en sources ouvertes: « Oui, il en reste plein. En fait, c’est ça qui est très intéressant. Le seul endroit où il y a une espèce de concentration de Wagners historiques, c’est plutôt en Centrafrique. Aujourd’hui, on a quelqu’un comme Dmitri Sytyi qui est encore en charge des activités du Wagner historique en Centrafrique. Et puis après on voit les anciens commandants qui réapparaissent alors soit dans Afrikakorps, soit dans d’autres organisations paramilitaires comme Redut par exemple ».
Le renseignement militaire russe, la GRU a la main sur les opérations en Afrique, mais contrairement à Wagner, organisation verticale, la GRU privilégie cette fois, les intermédiaires. « Au Burkina Faso, on a été capable d’identifier une unité qui s’appelle l’unité des Ours », Lou Osborne, « À la base c’est un groupe de combattants volontaires qui s’est créé en Crimée et qui, dans le cadre de la réorganisation qui avait lieu au moment de la mutinerie de Prigojine, a signé un contrat avec le ministère de la Défense. Et ce contrat est en réalité signé avec la GRU. Les services de renseignements russes semblent passer par des organisations qui ont une existence intermédiaire, de manière à organiser l’ensemble de ces unités et à les dispatcher à droite à gauche. »
Wagner était également très présent dans les médias et l’influence numérique. En Afrique, les opérations d’influences étaient organisées par les Bureaux d’information et de communication de Wagner, les bureaux BIC et là encore, depuis un an, il y a eu du mouvement pointe Lou Osborne « Au moment de la mutinerie, toute la partie plutôt médias traditionnelle, puisque Prigogine, était à la tête d’un espèce de consortium de médias, le plus connu était Ria Fan, tout cela a a été fermé. Sur la partie plutôt ferme à Trolls, opérations d’influence, elles ont continué après une petite pause. Et puis, ça a repris et on a vu, à partir d’octobre 2023, la création d’une nouvelle structure qui s’appelle African Initiative, et qui aujourd’hui est vraiment le moteur de l’influence en Afrique. Donc ces bureaux, ils existent encore. Maintenant, qui est en charge de ces bureaux ? Ça, c’est la grosse question. »
Reste que la marque Wagner n’a pas totalement disparu. En Russie elle sert même encore de produit d’appel, pour enrôler des mercenaires qui servent ensuite exclusivement le pouvoir russe, le Kremlin ne veut surtout plus voir émerger des aventuriers à l’instar d’Evgueni Prigojine.

Initiée en février par la Lettonie, la coalition des drones s’est agrandie avec l’arrivée de la France et de l’Italie, tous deux signataires d’une lettre d’intention au cours d’une réunion bruxelloise de l’Ukrainian Defense Contact Group. D’autres devraient suivre le mouvement, pointait alors le ministère de la Défense letton.
« Nous apprécions grandement la décision de l’Italie et de la France de rejoindre officiellement la coalition ukrainienne des drones. C’est une nouvelle confirmation de la détermination des membres de l’OTAN à soutenir l’Ukraine jusqu’à sa victoire », se félicitait le ministre de la Défense letton Andris Sprūds.
L’enjeu partagé par les 14 pays aujourd’hui signataires ? Livrer au plus vite un million de drones aux forces armées ukrainiennes via des cessions et achats conjoints. Plus de 500 M€ ont jusqu’à présent été rassemblés par les membres de la coalition afin de financer l’initiative.
Ces fonds viennent notamment soutenir l’appel d’offres émis par la Lettonie et le Royaume-Uni pour l’acquisition de plusieurs milliers de drones « First Person View » (FPV), des systèmes qui « se sont révélés très efficaces sur le champ de bataille » selon le ministère de la Défense britannique. Clôturé le 28 juin, il n’est que le premier d’une série de projets axés sur ces drones FPV.
Hier, la Défense lettonne a annoncé l’envoi d’un nouveau lot dans le courant du mois. Plus de 2500 drones de différents types et capacités seront fournis à l’Ukraine pour une valeur de 4 M€. Les 300 premiers exemplaires rejoindront le territoire ukrainien dans les prochains jours.
Au 1er mai 2024, la France avait livré 220 drones de reconnaissance à l’Ukraine depuis le début du conflit. D’autres efforts ont été annoncés, dont l’envoi d’une centaine de munitions téléopérées courte portée Oskar développées par Delair et KNDS France dans le cadre de l’appel à projets Colibri initié par l’Agence de l’innovation de défense.
Crédits image : ministère de la Défense ukrainien