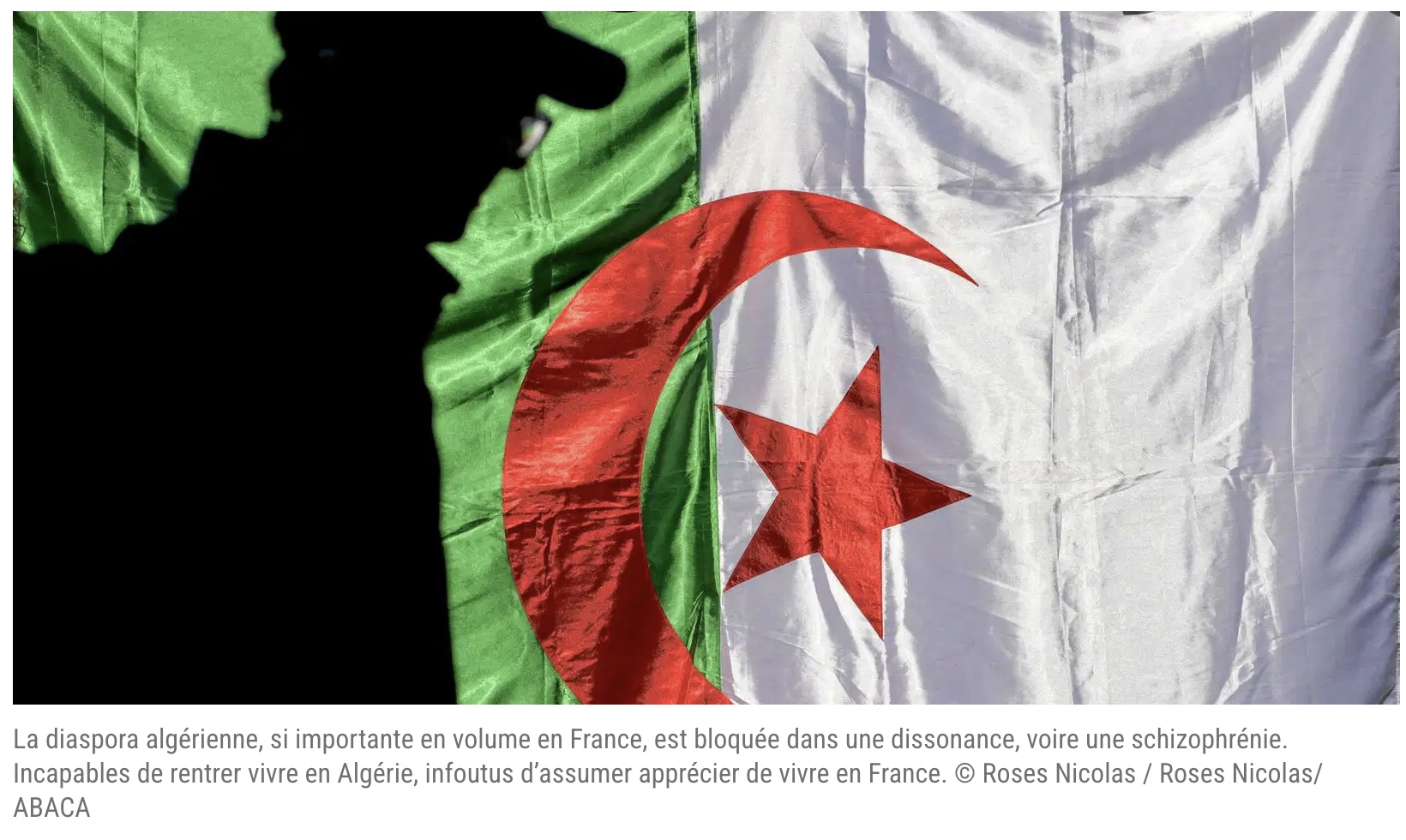« L’expérience prouve qu’il est beaucoup plus facile de prendre des otages que de les relâcher » (André Frossard). C’est ce que doivent penser les preneurs d’otages et ceux qui en sont victimes. La prise d’otages est aussi vieille que le monde. Depuis la plus haute Antiquité, les otages sont consubstantiels aux relations entre puissants qui entendent disposer de garanties de la parole donnée. Jusqu’au XVIIIe siècle, les otages sont associés aux alliances et aux traités. Si l’avènement du droit international met entre parenthèses cette pratique, elle renaît de ses cendres à la faveur des guerres et, plus près de nous, avec l’irruption du terrorisme. Considérée comme un crime de guerre dès 1945, la prise d’otages – si elle persiste dans les relations entre États – est désormais le fait du terrorisme, qui y voit une sorte de duel[1]. Et, c’est bien de ce terrorisme qu’il soit l’apanage d’États ou de groupes dont il s’agit. L’actualité la plus récente fournit de multiples exemples d’une pratique pérenne et déroutante. Manifestement, les États semblent désemparés dans le traitement global et efficace du phénomène[2]. Existe-t-il des réponses envisageables ? Et si oui, lesquelles ?
LA PRISE D’OTAGES : UNE PRATIQUE PÉRENNE ET DÉROUTANTE
Confrontés à une pratique incontournable dans les relations internationales de ce siècle, les États semblent déconcertés dans la manière de la traiter.
Un élément incontournable du monde du XXIe siècle : la diplomatie des otages
Même s’ils n’épuisent pas le sujet, plusieurs exemples concrets actuels méritent d’être mentionnés pour prendre l’exacte mesure du phénomène de la prise d’otages au XXIe siècle.
L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, n’est-il pas pris en otage par les autorités algériennes en raison des positions adoptées par le président de la République, Emmanuel Macron sur la marocanité du Sahara occidental (déclaration du 30 juillet 2024 suivie d’une visite officielle au Maroc) ? Alger entend utiliser, celui qu’elle considère comme Algérien en moyen de pression (otage) pour amener Paris a quia. Une sorte de repentance de ses propos inadmissibles sur des sujets sensibles de l’autre côté de la Méditerranée. Ne soyons pas naïfs ! Ce ne sont pas les échanges de noms d’oiseaux qui mettront un terme à cette situation inadmissible. Situation qui laisse de marbre les droits de l’hommistes des dîners en ville et autres défenseurs des droits humains de salon. La question générale des réponses aux prises d’otages par des États clairement identifiés est posée dans toute son acuité. N’est-elle pas notre talon d’Achille ? Conduit-elle à une réflexion d’ensemble sur la problématique ? Gouverner, n’est-ce pas prévoir pour mieux anticiper et mieux se préparer au pire ? Nous n’en sommes pas encore là. Malheureusement pour les personnes prises en otage hier, aujourd’hui et, vraisemblablement, encore demain.
Les otages français en Iran ne constituent-ils pas une « monnaie d’échange » pour le régime des mollahs aux abois ?[3] Un odieux marchandage dont l’objectif principal est clair : faire vibrer la corde sensible humanitaire de l’opinion publique française et culpabiliser Paris pour son manque d’humanité dans la protection de ses ressortissants embastillés dans des conditions précaires[4]. Rappelons que, dans le passé, l’Iran n’hésite pas à faire prendre en otages des Français au Liban en faisant intervenir des groupes terroristes qui lui sont liés, comme le Hezbollah ! La liste est longue des méfaits imputables aux mollahs au pays du Cèdre. N’oublions pas la détention des membres de l’ambassade des États-Unis à Téhéran à partir du 4 novembre 1979 qui durera 444 jours ! Seule une réponse ferme et coordonnée de tous les États victimes de cet acte de piraterie des temps modernes permettrait de trancher le nœud gordien persan. Ne rêvons pas !
La guerre à Gaza, et ses ramifications au Liban, a pour point de départ chronologique la prise d’otages israéliens dont des franco-israéliens – principalement des civils innocents, y compris des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards – par le Hamas, qualifié d’organisation terroriste, le 7 octobre 2023. Ces innocents sont soumis à des traitements dégradants et inhumains, au sens juridique du terme. Leur libération fait l’objet d’odieux marchandages qui, de facto si ce n’est de jure, conduisent à légitimer ex post cette pratique[5]. Elle aboutit, en contrepartie, à la libération de centaines de prisonniers palestiniens accusés, à tort ou à raison, de terrorisme. Ces derniers ne rêvent que d’en découdre avec Israël dès qu’ils seront libres et que l’occasion se présentera. La libération du soldat Gilat Shalit (citoyen franco-israélien capturé en 2006 et liberé en 2013) n’a été possible qu’au prix de la liberté accordée à un millier de Palestiniens. Parmi eux figurent certains des organisateurs du massacre du 7 octobre 2023. Ce point mérite d’être médité par Israël. Mais aussi par la France menacée par des terroristes ayant une idéologie proche de celle du Hamas, sans parler de ceux que l’on qualifie improprement « d’influenceurs » dans le cas de l’Algérie mais qui sont avant tout des propagateurs de haine. Méfions-nous du fameux « ça n’arrive qu’aux autres ! ». Ce vaste marchandage ne devrait-il pas constituer l’occasion d’une réflexion holistique sur le sujet entreprise dans la discrétion, seul gage de son efficacité à moyen et à long terme ? Seule une telle démarche permettrait de redonner cohérence à un tableau chaotique. Comme le souligne Edgar Morin : « La première et fondamentale résistance est celle de l’esprit. Elle nécessite de résister à tout mensonge asséné comme vérité (…). Elle exige de résister à la haine et au mépris. Elle prescrit le souci de comprendre la complexité des problèmes et des phénomènes plutôt que des visions partielles ou unilatérales. Elle requiert la recherche, la vérification des informations et l’acceptation des incertitudes »[6]. Le sociologue français ne fournit-il pas certaines pistes de réflexion et d’action à nos décideurs pris dans les urgences du temps médiatique ?
N’oublions pas les prises d’otages effectuées dans notre pays à l’occasion d’attentats terroristes sur notre sol depuis plusieurs décennies ![7] Le plus souvent, leurs auteurs se réclament également de l’idéologie frériste, phénomène bien documenté qui vaut à l’auteur d’un ouvrage scientifique sur le sujet de vivre sous la protection permanente de forces de sécurité[8]. Est-ce acceptable au pays de la liberté d’expression ? Qu’attendons-nous pour nous livrer à un exercice de retour d’expérience (« Retex ») des décennies passées sans le moindre tabou, comme le font les militaires après chaque opération ? Nous y apprendrions des choses intéressantes sur le passé pouvant orienter notre réflexion présente et notre posture future. Tel n’est-il pas l’objet d’une authentique approche prospective des relations internationales ? N’est-ce pas le contraire que nos dirigeants font, privilégiant en permanence les contraintes du temps court et médiatique aux exigences du temps long et stratégique ?
Face au phénomène d’une rare violence qui caractérise la prise d’otages, les États concernés pratiquent la politique du chien crevé au fil de l’eau ou diplomatie du dos rond.
Une pratique déroutante pour les États victimes : la diplomatie du dos rond
La liste des exemples présentée plus haut est loin d’être exhaustive si l’on souhaite dresser un panorama complet des actions terroristes accompagnées de leurs lots de prise d’otages occidentaux depuis la fin des années 1960. Hormis, certaines réflexions conduites par les services de renseignement, qui demeurent confidentielles par nature, la question n’a jamais fait l’objet – à notre connaissance – de rapports de l’exécutif, voire du Parlement. À titre d’exemple, le Sénat a publié, il y a quelques mois déjà, un rapport complet sur le phénomène du narcotrafic, clairvoyant à maints égards. Ne pourrait-il en être de même sur la question de la prise d’otages ?
Pourquoi ne pas s’atteler à l’étude et au traitement de la problématique du terrorisme et de ses prises d’otages qui intéresse la sécurité de nos concitoyens en France ou à l’étranger ? La France ne manque pas de bons esprits indépendants auxquels elle pourrait faire appel pour s’atteler au travail. Le temps presse. La Maison brûle et nous regardons ailleurs alors que notre pays n’est pas à l’abri de prises d’otages de grande ampleur de certains de ses concitoyens sur notre sol ou à l’étranger. Au pays de l’inflation des comités Théodule, des missions d’information sur tout et sur rien, des groupes spéciaux traitant de questions générales, des barnums à tout-va… il y aurait place pour un organisme en charge de faire la lumière sur les prises d’otages : état des lieux, propositions, y compris les plus iconoclastes.
Dans un monde fracturé, divisé, marqué au sceau de la conflictualité, la pratique des prises d’otages n’est pas en voie d’extinction. Chaque libération d’otages effectuée au prix de concessions importantes de la part des États concernés constitue un sérieux encouragement donné aux apprentis preneurs d’otages de poursuivre sur cette voie mortifère. Qui plus est, la faiblesse de la réaction des gouvernements touchés par ce phénomène ne peut que les conforter dans leur approche contraire à toutes les règles du droit humanitaire. Qu’importe. Ils connaissent nos faiblesses (notre inertie, notre droit, nos pudeurs de gazelle, nos idiots utiles…) et les utilisent à leur avantage. Comment les dissuader de poursuivre sur leur lancée ? En empruntant la voie ambitieuse de la rupture.
Une rupture avec les pratiques anciennes s’impose tant elles montrent leurs limites, leur inefficacité intrinsèque. La diplomatie du dos rond, du pas de vague, pour des raisons tenant à la sécurité bien comprise des otages, démontre sa vacuité. Nous ne pouvons que le déplorer. Dans le même temps, nous pourrions nous souvenir de ce que déclarait F.D. Roosevelt : « En politique, rien n’arrive par accident. Si cela arrive, vous pouvez être certains que cela a été planifié ». On ne saurait mieux dire dans le cas des prises d’otages par des États ou des groupes structurés. Ils apprécient à sa juste valeur le désarroi des familles d’otages et en tirent le meilleur profit[9]. Dans ce combat asymétrique, nous devrions essayer de rétablir un certain équilibre à notre avantage. Nous le pouvons à condition de le vouloir, pas seulement en paroles mais surtout dans nos actes.
La France, patrie des droits de l’homme, estime-t-elle tolérable cette pratique barbare ? Si tel n’est pas le cas, notre pays ne devrait-il pas prendre la tête d’une coalition de volontaires destinée à réfléchir et à tenter de trouver les réponses idoines à apporter à un phénomène récurrent (Algérie, Azerbaïdjan[10], Iran, Russie…). Un phénomène qui met dans l’embarras les familles d’otages qui font pression sur les gouvernements concernés pour obtenir la libération de leurs proches à n’importe quelle condition[11]. Il est grand temps de retrouver nos repères, de réveiller notre esprit critique. Penser, c’est parfois savoir dire non, se confronter à l’invraisemblable vérité ! Tel est le défi à relever à court, moyen et long terme. Le voulons-nous ? Le pouvons-nous ?
Alors qu’aucune inversion de tendance ne se dessine et que la situation tourne souvent au désastre en matière de prises d’otages, nous devons interroger notre cécité et repenser notre logiciel.
LA PRISE D’OTAGES : DES RÉPONSES CLAIRES ET DISSUASIVES
Comme souvent dans la pratique des relations internationales, il importe de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. La définition précise du sujet doit précéder le périmètre de la réponse souhaitée et souhaitable dans une démarche en deux temps.
La définition du périmètre du sujet : la diplomatie du concret
Rien n’est possible sans savoir de quoi on parle. En un mot abandonner la langue de bois épaisse et les formules médiatiques creuses.
Sans se voiler la face sur la difficulté de l’exercice, la diplomatie française ne se grandirait-elle pas en prenant l’initiative sur cette problématique lancinante ? Surtout, alors qu’elle est à la peine dans plusieurs régions du monde où elle se pensait incontournable comme en Afrique[12]. Pareille démarche se situerait dans le droit fil de sa vocation de passeuse d’idées, de lanceuse d’alerte, en sa qualité d’étendard de la défense des droits humains. Mais aussi à son attachement indéfectible à un multilatéralisme efficace. À nos yeux, elle s’imposerait aux yeux du monde libre en prenant à bras le corps le traitement d’une pratique prégnante dans le concert des nations du XXIe siècle. Mais, ceci apparaît plus facile à dire qu’à faire au pays d’un certain conformisme ambiant.
Ignorer l’existence d’un problème ne constitue jamais le meilleur moyen de l’appréhender pour en être en mesure de mieux le traiter. Telle est la parabole attachée à la pratique de la diplomatie : le temps du diagnostic doit précéder celui du remède. Et si le premier est erroné, il y a de fortes chances que le second soit inadapté ou contre-productif. C’est pourquoi, il conviendrait de confier à un groupe de juristes spécialisés en droit international (au Quai d’Orsay et au ministère des Armées) et en matière de terrorisme (ministère de l’Intérieur en y ajoutant les experts, d’hier et d’aujourd’hui, de la DGSE et de la DGSI qui connaissent les arcanes de la problématique de la prise d’otages) le soin de faire le point sur l’approche juridique du concept de prise d’otages (textes déjà existants, déclarations éventuelles de l’ONU, de l’OTAN, de l’UE…) afin d’en dégager une définition acceptable par une majorité d’États. Une substantifique moëlle diplomatico-sécuritaire.
Même si les obstacles paraissent insurmontables, impossible n’est pas français. Apprenons à mettre des mots sur les maux. Juristes et diplomates sont qualifiés et outillés pour le faire. Nos décideurs devraient les réunir pour qu’ils préparent l’ébauche d’un texte de convention internationale définissant le crime de prise d’otages et les sanctions s’y attachant ainsi que les juridictions (existantes ou ad hoc) appelés à connaître de ces actes. En dépit de sa lourdeur, la judiciarisation internationale de la prise d’otages ne serait pas un exercice inutile. A minima, elle constituerait un message clair adressé aux apprentis sorciers et à leurs parrains. Cette phase préalable devrait être lancée à froid en dehors de toute publicité intempestive et de toute pression médiatique. De la discrétion avant toute chose. Telle est l’essence de la diplomatie à l’ancienne et de ses avantages incontestables.
La définition du périmètre de la réponse : la diplomatie de l’efficacité
Cette étape doit être la conséquence de la première. Elle doit être marquée au sceau de la globalité dans le temps et l’espace et éviter de sombrer dans la diplomatie du coup d’éclat.
Cette approche juridique du phénomène doit être replacée dans le contexte d’une démarche de boîte à outils pour le traitement global des prises d’otages. Les autres outils déjà utilisés sont les suivants : assassinats ciblés ou opérations « homo » conduites par les services de renseignement (comme la DGSE) des terroristes et preneurs d’otages ayant commis des crimes contre nos ressortissants ; dénonciation publique des fauteurs de trouble (« Naming and shaming ») : pressions de toute nature exercées sur les auteurs et complices… La première pratique est bien connue des Israéliens qui ne laissent aucun répit aux assassins. N’oublions pas la diplomatie de la carte postale[13]. C’est dans ce contexte que doit s’insérer la diplomatie juridique. La globalité et la cohérence de notre réponse est le gage de son succès.
Ensuite, pareille démarche devrait être précédée par un état des lieux objectif sur le phénomène des prises d’otages dans le monde : nombre, personnes visées, pays ou groupes à l’origine de ce phénomène… afin de ne pas parler dans le vide mais sur la base d’une documentation précise. À cette fin, il importe de disposer du retour d’expérience de la communauté du renseignement (actifs et retraités) qui a souvent été impliquée – discrètement le plus souvent – dans ce genre d’affaires sensibles. Leur contribution nous paraît incontournable pour définir les paramètres d’une approche concrète se situant au plus près de la réalité du phénomène au cours des dernières décennies. Rappelons que diplomatie et renseignement ne sont pas des métiers tout à fait étrangers, souvent complémentaires, parfois antagonistes. Et cela d’autant plus que « ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l’ordre d’une grande bascule et d’un grand bouleversement » (Emmanuel Macron). Tout ceci n’incite-t-il pas à la réflexion et à l’adaptation de notre diplomatie aux contraintes sécuritaires des temps mauvais ? Agir, c’est prendre appui sur le passé (l’Histoire) pour comprendre ce qui change aujourd’hui et demain. C’est aussi être à même de prévoir, d’anticiper, d’agir sur le long terme tout en ne négligeant pas le court terme.
Pour produire le maximum d’effets, l’équipe chargée de la rédaction d’un cadre juridique international devrait travailler sur deux questions clés que sont la vérification et la sanction. Les experts des questions politico-militaires savent d’expérience qu’un traité d’interdiction d’une activité déterminée ne peut produire tous ses effets qu’à deux conditions. Outre l’existence d’une définition précise et incontestable du phénomène, la première condition consiste à mettre en place un organisme indépendant et impartial chargé d’établir la réalité des faits allégués en dehors de toute pression extérieure. L’on connaît la célèbre formule de Ronald Reagan : « Trust but verify » (« faire confiance mais vérifier ») à propos des accords de désarmement nucléaire américano-soviétique durant la Guerre froide. La seconde condition a trait à la palette de sanctions envisagées contre les preneurs d’otages et surtout contre les États qui les encouragent ou/et les financent : traduction devant des juridictions internationales comme la Cour pénale internationale ; limitation des déplacements des plus hauts responsables des États concernés (cf. mesures frappant les dirigeants russes, israéliens et du Hamas au titre des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité) ; mise à l’écart des organisations internationales de la famille des Nations Unies ; gel des avoirs détenus dans les pays ayant adhéré à la convention… Cette liste est purement indicative. Elle pourrait s’enrichir d’autres mesures coercitives pénalisant durement les « États voyous » pour reprendre un langage suranné du temps du 43e président des États-Unis, Georges W. Bush que pourrait aisément reprendre le 47e président dès son investiture le 20 janvier 2025.
Enfin, et seulement après que les étapes précédentes aient été conduites à leur terme, convocation d’une conférence internationale à Paris préparée et non improvisée. On imagine le questionnement, l’inquiétude réelle dans ces États peu scrupuleux. Ainsi la France retrouverait sa vocation décrite par un diplomate-écrivain du nom de Jean Giraudoux à la veille de la Seconde Guerre mondiale dans une comédie aux accents très réalistes :
« Permets-moi de te dire que c’est sur ce point que tu as tort. Laisse-moi rire quand j’entends proclamer que la destinée de la France est d’être ici-bas l’organe de la retenue et de la pondération ! La destinée de la France est d’être l’embêteuse du monde. Elle a été créée, elle s’est créée pour déjouer dans le monde le complot des rôles établis, des systèmes éternels. Elle est la justice, mais dans la mesure où la justice consiste à empêcher d’avoir raison ceux qui ont raison trop longtemps. Elle est le bon sens, mais au jour où le bon sens est le dénonciateur, le redresseur de tort, le vengeur. Tant qu’il y aura une France digne de ce nom, la partie de l’univers ne sera pas jouée, les nations parvenues ne seront pas tranquilles, qu’elles aient conquis leur rang par le travail, la force ou le chantage. Il y a dans l’ordre, dans le calme, dans la richesse, un élément d’insulte à l’humanité et à la liberté que la France est là pour relever et punir. Dans l’application de la justice intégrale, elle vient immédiatement après Dieu, et chronologiquement avant lui. Son rôle n’est pas de choisir prudemment entre le mal et le bien, entre le possible et l’impossible. Alors elle est fichue. Son originalité n’est pas dans la balance, qui est la justice, mais dans les poids dont elle se sert pour arriver à l’équité, et qui peuvent être l’injustice… La mission de la France est remplie, si le soir en se couchant tout bourgeois consolidé, tout pasteur prospère, tout tyran accepté, se dit en ramenant son drap : tout n’irait pas trop mal, mais il y a cette sacrée France, car tu imagines la contrepartie de ce monologue dans le lit de l’exilé, du poète et de l’opprimé »[14].
Tout est dit et bien dit de la prétention à l’universalisme de la France éternelle. Dans le cas d’espèce, à la condition de remplir toutes les conditions énoncées plus haut, la conférence envisagée ne serait pas à ranger dans la catégorie de grand-messe de plus caractérisée par beaucoup d’incantations et peu de résultats tangibles. Elle ne déboucherait pas non plus sur un chef d’œuvre diplomatique, un monument d’hypocrisie. Elle se confronterait au réel dans ce qu’il a de plus trivial et, parfois, de dérangeant.
Cela enverrait un signal clair aux fauteurs de troubles et à leurs complices. On peut imaginer l’édiction de sanctions lourdes et dissuasives contre les preneurs d’otages, leurs donneurs d’ordre, leurs complices directs ou indirects mais aussi et surtout pour les chefs d’État des pays impliqués dans cette forme de guerre asymétrique. On pourrait envisager une mise au ban des Nations par la publication de listes noires des États coupables comme cela déjà est le cas pour le terrorisme. Cela leur donnerait matière à réflexion et aurait un effet dissuasif. L’on pense aussitôt à la duplicité du Qatar, qui abrite sur son sol plusieurs organisations terroristes qu’il finance manu larga, et joue les médiateurs entre le Hamas et Israël pour la libération des otages détenus à Gaza. Ceci ne l’empêche pas d’être courtisé par bon nombre de pays Occidentaux (dont la France) dont il sait corrompre habilement les élites, y compris celles ayant occupées les fonctions les plus prestigieuses dans la hiérarchie des États. Mais, voulons-nous et pouvons-nous utiliser cette carte dans notre jeu ? Qui veut la fin veut les moyens. Mais est-ce imaginable pour un président de la République attaché à la pratique du en même temps diplomatique et de l’indignation à géométrie variable ? Sans oublier l’essentiel, il n’apporte pas, le plus souvent, de solutions crédibles aux problèmes qu’il prétend résoudre. La « twitterisation » de la diplomatie érode la confiance dans notre Douce France.
La poursuite cette approche de la judiciarisation de la pratique de la prise d’otages conduirait à des choix délicats, mais salutaires en termes de sécurité intérieure et internationale. Où mettre le curseur ? Tel est le cas avant le lancement de toute négociation internationale importante. Cet exercice se révèle très salutaire tant il nous renvoie à nos incertitudes et à nos contradictions inhérentes à toute pratique diplomatique qu’elle soit bilatérale ou multilatérale. La problématique est souvent simple à énoncer, mais complexe à résoudre. La diplomatie, faut-il le rappeler, est l’art du possible, à défaut d’être celui du souhaitable. Son objectif affiché n’est-il pas de contribuer au renforcement de la sécurité collective, bien mal en point en ce début d’année 2025 ? Ce qui reste du système de sécurité collective mise en place en 1945 apparaît désormais en lambeau. Comme nous le rappelle Raymond Aron, cette démarche ambitieuse aurait pour principal objectif de « gagner la guerre limitée pour ne pas avoir à mener une guerre totale » dans un temps où nous sommes déjà entrés dans une nouvelle ère stratégique. Un temps nécessitant l’abandon des postures de surplomb, d’une communication faisant office d’action et le passage incontournable de l’ambition à l’action. Le signe du passage à une diplomatie efficace et crédible.
DE L’ESPRIT DE LA DIPLOMATIE À LA DIPLOMATIE DE L’ESPRIT
« Il y a deux classes de qualité qui entrent dans la composition de l’esprit et de l’honneur de la profession de diplomate : les qualités de l’âme et les qualités de l’esprit » (Talleyrand). Face au bouleversement du monde et à la révolution copernicienne qui l’accompagne, il faut chercher quelques clés de compréhension. Dans cette quête, nous avons plus que jamais besoin d’un retour de la diplomatie de l’esprit, loin du brouhaha médiatique et des postures politiciennes. Méfions-nous des bons sentiments qui affaiblissent la France ! On se rassure comme on peut en évitant les remises en cause douloureuses en louvoyant entre ligne claire et clair-obscur. C’est ce qui se passe aujourd’hui dans le domaine spécifique de la lutte contre le terrorisme et contre les prises d’otages alors que la géopolitique des otages rebat les cartes de la géopolitique mondiale. Avoir le courage de dire, la volonté de faire, telle devrait être la boussole stratégique de nos décideurs. Donner un cadre juridique international le plus large possible pour inquiéter parrains et auteurs des privateurs de liberté ! Tel devrait être l’objectif premier de la criminalisation de la prise d’otages.
[1] Gilles Ferragu, Otages, une histoire. De l’Antiquité à nos jours, Folio Histoire, 2020.
[2] Géraldine Woessner (propos recueillis par), Pierre Vermeren : « La France est considérée comme un État faible », Lepoint.fr, 18 janvier 2025.
[3] Jean-Pierre Perrin, « Iran : le régime tremble de toute part », Mediapart, 16 janvier 2025.
[4] Olivier Grondeau, « Si seulement l’innocence rendait immortel », Le Monde, 15 janvier 2025, p. 29.
[5] Samuel Forey/Piotr Smolar, « Israël Hamas : un accord fragile sous pression de Trump et Biden », Le Monde, 15 janvier 2025, pp. 2-3.
[6] Edgar Morin, « Face à la polycrise que traverse l’humanité, la première résistance est celle de l’esprit », Le Monde, 22 janvier 2024, p. 26.
[7] Louis Caprioli/Jean-François Clair/Michel Guérin, La DST sur le front de la guerre contre le terrorisme, Mareuil éditions, 2024.
[8] Florence Bergeaud-Blackler (Préface de Gilles Kepel), Le frérisme et ses réseaux, l’enquête, Odile Jacob, 2023.
[9] Samuel Forey/Raphaëlle Rérolle, « Israël-Gaza : l’attente des familles avant les premières libérations », Le Monde, 19-20 janvier 2025, p. 3.
[10] Faustine Vincent, « Huit anciens hauts dirigeants arméniens du Haut-Karabakh jugés en Azerbaïdjan », Le Monde, 19-20 janvier 2025, p. 6.
[11] Raphaëlle Rérolle, Les proches d’otages : « Nous avons perdu six mois », Le Monde, 17 janvier 2025, p. 3.
[12] Marc-Antoine Pérouse de Monclos, « En Afrique, l’Élysée se fait désormais dicter sa conduite », Le Monde, 17 janvier 2025, p. 27.
[13] Jean Daspry, « De la diplomatie des otages à la diplomatie de la carte postale ! », Tribune libre n°165, CF2R, 30 novembre 2024.
[14] Jean Giraudoux, L’impromptu de Paris, pièce en un acte, Grasset, 1937.