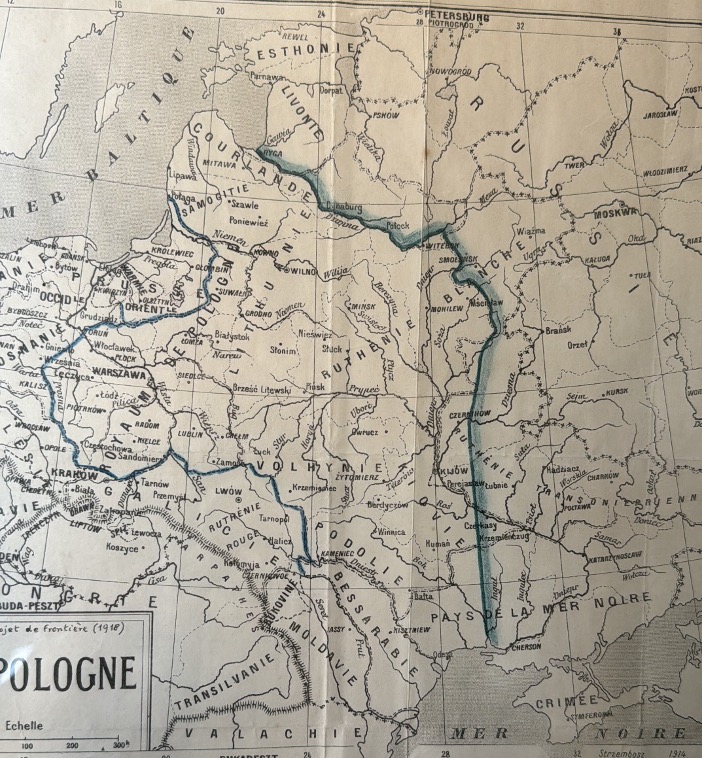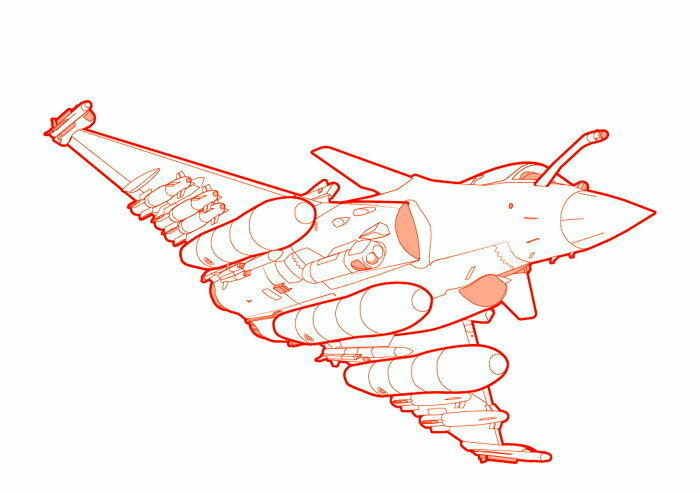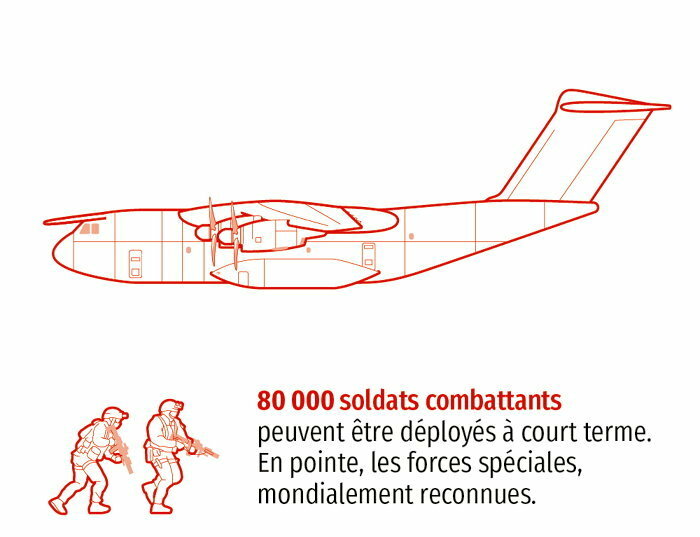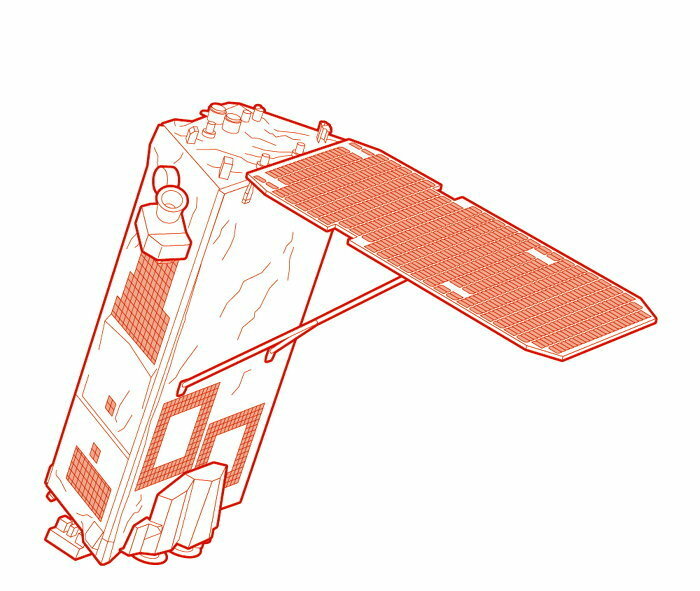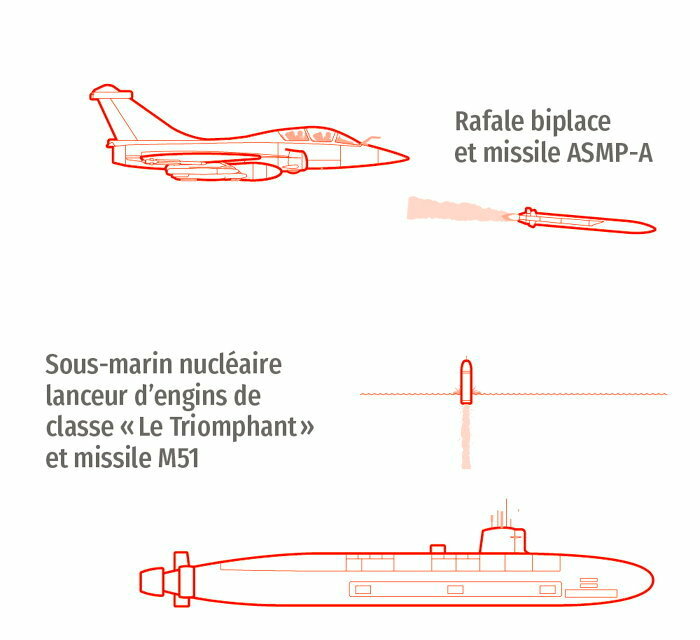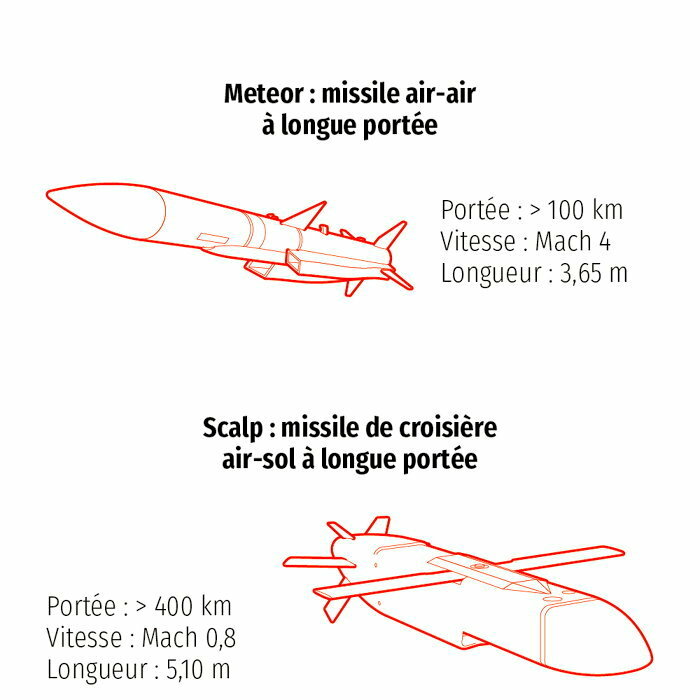Le djihadisme en Ukraine

La notion de jihad associée au conflit ukrainien est, de prime à bord, troublante. Depuis le 11 septembre 2001, pour les Occidentaux ce terme renvoie plutôt à l’idée de guerres asymétriques menées par des terroristes islamistes arabes fanatisés. Alors que dans le cas présent, le conflit oppose deux États européens à majorité chrétienne dans le cadre d’une guerre de haute intensité.
A.L. L’auteur a effectué plusieurs recherches sur le djihadisme en Ukraine. Son travail a été volontairement anonymisé.
Les représentations occidentales sur l’islamisme ont ainsi été façonné par deux décennies d’attentats sur un territoire européen déchristianisé. En vingt ans, une multitude de groupes se sont revendiqués du jihad. De l’Afrique à l’Asie en passant par le Moyen-Orient, ils forment un ensemble hétérogène comportant des sociologies, des objectifs et des modes d’action variés pouvant parfois mener à des conflits internes. Cette arborescence d’acteurs rend leur compréhension difficile du grand public et entretient une vision floue sur ce qu’est le jihad. S’ajoute à cela le temps court de l’information face au temps long de l’histoire. La connaissance de l’islam et ses préceptes s’acquiert au gré des tragiques attentats où sont ensuite abordés brièvement sur des chaines d’information, des supposés conditions sociologiques ou religieuses menant à de tels actes. « L’étranger qui ne fait simplement qu’observer ne peut que partiellement comprendre, toute compréhension véritable requiert une participation imaginative à la vie des autres » écrivait le sociologue Robert Park. Ainsi le jihad est une notion protéiforme qui a évolué au fil du temps et des acteurs qui s’en revendiquent. Il doit être étudié au travers des textes mais aussi et surtout de ceux qui prétendent l’employer. En Occident, cette notion de jihad est avant tout vu comme un appel à une forme de guerre sainte à l’égard de non musulmans. Cette représentation biaisée peut s’expliquer par la confrontation violente que le continent a eu ces dernières décennies avec les groupes terroristes. Elle est cependant réductrice mais dans ce contexte de violences la nuance est plus difficile à apporter. Si les djihadistes se réclament du Coran et de la vie du Prophète Mohammed pour justifier leurs actions, leur interprétation des écritures demeure marginale. Historiquement, l’idée d’un jihad militaire existe mais elle répond à des conditions précises pouvant davantage être associées à de l’auto-défense. Au Xème siècle, les auteurs appartenant au courant soufi ont quant à eux établi une distinction entre le « petit jihad » et le « grand jihad ». Le premier correspond à un jihad militaire mais serait moins important que le second qui serait intérieur contre la tentation du pêché. Au XIIe siècle, le théologien musulman Averroès distingue quant à lui quatre dimensions au jihad : l’effort par le cœur (intérieur), l’effort par l’épée (guerrier), l’effort par la langue (prédication), l’effort par la main (écrire au profit de l’islam et la bienfaisance) En 1928, l’instituteur égyptien Hasan al-Banna fonde l’association des Frères Musulmans. Il défend une vision politique de l’islam qui ne serait pas cantonné à la sphère privée. Il est suivi au milieu du XXe siècle par l’enseignant et intellectuel égyptien Sayyid Qutb. Ce dernier prône un jihad purement guerrier visant à la propagation de l’islam. Son exécution en 1966 a participé à la diffusion de ses écrits et un mouvement de solidarité envers les Frères Musulmans. Les groupes terroristes islamistes actuels tel que l’État Islamique s’inscrivent dans cette continuité que l’on qualifie de djihadiste à savoir « une doctrine de l’action violente au service de l’islam politique, lequel peut faire usage du terrorisme comme de beaucoup d’autres moyens, qu’ils soient coercitifs, persuasifs, voire légaux ». Ils ne doivent cependant pas occulter les autres interprétations, comme celles citées précédemment, qui placent la dimension militaire au second plan. Ainsi, plutôt qu’un concept clairement défini, le jihad apparait davantage comme une notion fluctuante, dépendante des interprétations et parfois, un outil au service d’une vision plus politique de l’islam. Ces questions d’islamisme et de la lutte contre le terrorisme ont occupé une place importante dans les politiques de défense des pays européens et des États-Unis. Le 24 février 2022, lorsque la Russie envahit l’Ukraine, une page semble se tourner. La guerre dite de haute intensité fait son retour sur le sol européen. Pourtant, seulement quelques mois après le début du conflit, le jihad ressurgit sur ce nouveau théâtre d’affrontements. Côté ukrainien, on trouve la présence d’anciens membres de groupes islamistes comme Abdul Hakim al-Chichani, de son vrai nom Rustam Azhiev, qui combattait auparavant en Syrie. Côté russe, différentes autorités musulmanes et le dirigeant de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, ont appelé au jihad contre l’Ukraine et le « satanisme occidental ». On observe que le jihad est présent des deux côtés mais émane d’acteurs différents qui sont non-étatiques, infra-étatiques ou religieux. Ensuite, des éléments mobilisés par ces acteurs comme la justification religieuse, les discours ou encore la communication au travers des réseaux sociaux, n’est pas sans rappeler les modes d’action des groupes terroristes islamistes. Dès lors, le conflit en Ukraine apparait comme une hybridation entre des acteurs et des méthodes issus de guerres non conventionnelles mobilisant un narratif religieux au sein d’une guerre de haute intensité entre deux États laïques à majorité chrétienne. On peut donc se demander si la mobilisation du jihad dans le conflit en Ukraine témoigne-t-elle d’une mutation durable des conflits ? Comme chaque conflit, la guerre en Ukraine se tient dans un contexte historique et politique singulier. Pour comprendre les dynamiques propres à chaque acteur il faut d’abord s’intéresser aux guerres de Tchétchénie (1994-1996 et 1999-2000) qui ont été particulièrement violentes et marquantes pour les belligérants. Elles constituent le point de départ du parcours de certains nationalistes qui par la suite créeront ou rejoindront des groupes islamistes dans le Caucase et au Moyen-Orient. Nous verrons ensuite comment ces combattants ont intégré différents bataillons de la Légion Internationale ukrainienne et leur rôle dans ce conflit. Dans une seconde partie nous étudierons les discours djihadistes côté russe. Il s’agit d’analyser le positionnement des autorités religieuses et politiques ainsi que leur réception par soldats. Enfin, nous verrons le rôle de la communication massive au travers des réseaux sociaux et comment elle sert de caisse de résonnance afin d’unir les troupes et de démoraliser l’adversaire.
1. La déterritorialisation du conflit d’indépendance tchétchène
Bien qu’il soit difficile d’établir une sociologie précise des combattants islamistes présents aux côtés des troupes ukrainiennes, la grande majorité d’entre eux sont issus des républiques musulmanes au sud de la Russie, Tchétchénie en tête. Pour comprendre leur participation à ce conflit, il est avant tout nécessaire de retracer leur parcours en partant des deux guerres de Tchétchénie. Elles ont à la fois formé un vivier de combattants radicaux mais également construit un rapport particulier entre la Russie et ses musulmans.
La genèse de l’islamisme caucasien
La fin de l’URSS en 1991 a conduit à la revendication d’indépendance d’une multitude d’anciennes républiques socialistes. Parmi elles, la République d’Itchkérie, actuelle Tchétchénie, revendique son indépendance cette même année. En conséquence, le 11 décembre 1994 la Russie lance une offensive militaire pour reprendre le territoire. Le chaos créé par ce conflit profite à des prédicateurs islamistes et wahhabites qui vont prospérer dans la région. Traditionnellement, l’islam soufi est majoritaire en Tchétchénie. Il promeut une dimension ésotérique et mystique de la foi et un jihad avant tout intérieur comme mentionné en introduction. Cette incursion du wahhabisme, soutenue par les pays du Golfe, est facilitée par la défiance de la population envers les imams traditionnels qui étaient réputés pour informer le KGB. En 1996, sont signés les accords de paix de Khassaviourt entre les autorités russes et tchétchènes donnant l’indépendance à ces derniers. Des élections présidentielles ont lieu en 1997 et le nationaliste laïque Aslan Maskhadov l’emporte avec 60% des voix. Cependant, la république se fracture entre les nationalistes modérés et les islamistes représentés par Chamil Bassaïev et le saoudien Ibn al-Khattab. L’augmentation de la criminalité et les difficultés économiques profitent à la propagation d’un islam radical. Face à cela, le président proclame l’instauration de la charia dès 1997 afin de satisfaire les revendications islamistes et de permettre des mesures violentes visant à baisser la criminalité. On assiste alors à une propagation et une radicalisation de ces mouvements religieux qui se déportent vers les républiques voisines (Daghestan, Ingouchie, Kabardino-Balkharie). Entre le 31 août 1999 et le 16 septembre 1999, une série de cinq attentats est perpétrée sur le territoire russe dont un à Moscou. Ils causent la mort d’au moins 290 personnes et sont attribués aux indépendantistes tchétchènes bien que cela soit contesté. S’en suit alors la seconde guerre de Tchétchénie (1999-2009). La résistance tchétchène se divise entre les nationalistes et les islamistes qui s’organisent au sein de jamaat. Ces derniers, bien que moins nombreux, sont davantage visibles et ils comptent dans leurs rangs des combattants étrangers venant d’Al-Qaïda. Ce conflit sert de démonstration de puissance au nouveau président russe Vladimir Poutine. Dès le 6 février 2000, la capitale tchétchène Grozny est reprise par Moscou après de violents combats qui ont ravagé la ville. En 2003 les affrontements cessent et la république d’Itchkérie est rattachée à la Fédération de Russie à la suite d’un référendum. La même année, Akhmat Kadyrov devient président de la République de Tchétchénie au terme d’une élection contestée. Ancien vice-mufti de Tchétchénie, il a combattu aux côtés des indépendantistes durant la première guerre avant de se rapprocher de Moscou durant la seconde guerre de Tchétchénie. Il est tué en 2004 dans un attentat à la bombe. En septembre 2004, la prise d’otages dans l’école de Beslan qui fit 344 morts, marque une bascule dans le combat islamo-national tchétchène vers un terrorisme mondialisé. La vallée du Pankissi située au nord-ouest de la Géorgie et frontalière à la Tchétchénie devient un lieu de repli pour ces combattants djihadistes. En 2007 est proclamée la création de l’Émirat du Caucase par Doku Oumarov. L’objectif de l’organisation est de faire du Caucase « une zone purement islamique en y instituant la charia et en chassant les infidèles » puis « de reprendre toutes les terres qui étaient à l’origine musulmanes et qui se trouvent bien au-delà des limites du Caucase ». L’indépendance de la Tchétchénie apparait alors comme une lutte plus secondaire au profit d’une propagation de l’islam par la lutte armée à l’ensemble du Caucase. Le groupe se structure avec un organe consultatif (le Majlis ul-Shura), un bureau de représentation officiel à l’étranger, un organe d’information officiel (Kavkaz Center) publiant en russe, en anglais, en arabe, en turc et en ukrainien. L’Émirat du Caucase continue la lutte à travers le terrorisme. L’organisation a notamment revendiqué le double attentat suicide du 29 mars 2010 dans le métro de Moscou qui a fait 39 morts. En 2013, « l’émir » Doku Oumarov meurt et l’Emirat du Caucase s’essouffle. D’un côté on assiste à un manque de légitimité de son successeur daghestanais Aliskhab Kekebov. D’un autre côté al-Qaïda et l’État Islamique gagnent en influence et font concurrence à l’Émirat du Caucase. C’est le cas notamment au Daghestan où les chefs djihadistes choisissent de se rallier à l’État Islamique. L’Émirat du Caucase, après avoir entretenu une position ambiguë entre les deux groupes, prête allégeance à Al-Qaïda. Ceux qui combattaient naguère dans le Caucase pour l’imposition de la charia dans la région se retrouvent désormais disséminés entre la Turquie, la Syrie et l’Irak. La répression russe a poussé ces musulmans radicaux à quitter le territoire. Ces combattants devenus plus ou moins apatrides ont donc gonflé les rangs de l’État Islamique. Ils voient dans ce choix une opportunité de s’entrainer au combat en attendant la reprise du conflit en Tchétchénie mais également pour des raisons de subsistance économique. Les caucasiens s’organisent en katiba de l’État Islamique notamment Jaich al-Mouhajirine wal Ansar (« l’Armée des émigrants et des défenseurs »), mais aussi dans des groupes autonomes comme Ajnad al Kavkaz (« les soldats du Caucase »). En 2016 est même formée une société militaire privée djihadiste nommée Malhama Tactical (« la tactique de l’Apocalyspe »), dirigée à partir de 2019 par le tchétchène Ali al-Chichani.
Les savoir-faire acquis durant le conflit tchétchène sont maintenant mis au service de la cause islamiste. L’entrée en guerre de la Russie aux côtés de Bachar al-Assad en Syrie en 2015, confère une motivation supplémentaire pour ces djihadistes qui y voient une continuité avec la lutte menée sur leur territoire originel. Ce que l’on peut donc constater c’est que du chaos de la première et la seconde guerre de Tchétchénie, se répand un islam radical venu d’Arabie Saoudite. On assiste alors à une hybridation entre des revendications territoriales et des revendications islamistes. La déterritorialisation progressive de la lutte et la perte de vitesse de l’Émirat du Caucase poussent les combattants à s’insérer au sein de l’État Islamique ou al-Qaïda. Les soldats nationalistes sont devenus des djihadistes confirmés qui luttent désormais au Moyen-Orient. On observe une continuité et une certaine cohérence entre les différentes organisations qui se sont succédées. Le combat a progressivement basculé d’une motivation territoriale vers des revendications religieuses et idéologiques sans la remplacer complètement. Ces djihadistes sont, au fur et à mesure devenus des « exclus » de leurs pays d’origines qui s’insèrent au sein de groupes terroristes pour des raisons économiques et pour poursuivre la lutte contre la Russie À partir de 2014, s’ouvre un nouveau front en Ukraine avec les velléités indépendantistes dans les régions de Louhansk et de Donetsk soutenues par la Russie. Certains combattants actifs au Moyen-Orient y voient l’opportunité de lutter contre l’impérialisme russe et vont rejoindre des bataillons de mercenaires musulmans. En 2022 ce phénomène prend davantage d’ampleur avec l’invasion russe de l’Ukraine.
L’Ukraine : nouveau théâtre de la confrontation anti-russe
La défaite des indépendantistes tchétchènes les a conduits à l’exil. Si certains, notamment islamistes, ont poursuivi la lutte dans le Caucase et au Moyen-Orient, une large partie des indépendantistes ont quant à eux trouvé refuge en Europe et en Turquie. L’Ukraine a également fait figure de terre d’accueil en raison de sa proximité géographique, de l’usage de la langue russe et d’une communauté musulmane Tatar bien implantée. Par la suite, cette destination fut le choix d’anciens djihadistes car il y était simple d’en acheter la citoyenneté, un passeport ou des armes. En 2014, lorsque la Russie annexe la Crimée et que des mouvements indépendantistes apparaissent dans la région du Donbass, la diaspora tchétchène se mobilise derrière les Ukrainiens. En mars de cette même année, l’intelligentsia laïque tchétchène en exil au Danemark notamment Isa Munayev, fonde le bataillon Djokhar Doudaev du nom du président qui a déclaré l’indépendance de l’Itchkérie en 1991. De ce premier bataillon un second va être créé, le bataillon Cheikh Mansour qui est une figure tchétchène du XVIIIème siècle pour s’être battu contre l’impérialisme tsariste en unissant la population autour de l’islam. Les raisons de la scission entre ces deux bataillons est floue. Certains évoquent des divergences au niveau stratégique sur les zones de combat où agir en Ukraine. D’autres mettent en avant une séparation idéologique avec le bataillon Doudaev qui serait nationaliste et laïque tandis que le bataillon Cheikh Mansour serait guidé par des considérations islamistes et dont certains membres auraient combattu dans les rangs de l’État Islamique . Un troisième bataillon, Bechennaya staya (« la meute enragée »), a été créé. Peu d’informations à son sujet sont disponibles mais selon le média pro-russe Donbass Insider, il serait devenu une composante de la 57e brigade motorisée de l’armée ukrainienne. Jusqu’en 2022 les bataillons Djokhar Doudaev et Cheikh Mansour n’étaient pas reconnus par le gouvernement ukrainien. Le bataillon Doudaev comprendrait entre 300 et 500 hommes, principalement des tchétchènes mais également des volontaires issus du reste du Caucase. Les motivations de ces volontaires sont avant tout idéologiques. Ils sont issus de la diaspora tchétchène en Europe et se sont engagés dans l’objectif de contrer l’impérialisme russe qu’ils ont eux même subit. Il s’agit principalement de vétérans des guerres de Tchétchénie qui disposent ainsi de compétences militaires et de connaissances des tactiques de l’armée russe qu’ils mettent désormais à profit sur le théâtre ukrainien. Certains se battent dans l’objectif de déstabiliser la Russie à travers une décrédibilisation du pouvoir de Vladimir Poutine afin de reprendre ensuite le combat indépendantiste en Tchétchénie. L’invasion russe de 2022 constitue un catalyseur qui a mobilisé davantage de tchétchènes en exil. Deux nouveaux bataillons ont ainsi été créé : le Khamzat Gelayev Joint Task Detachment et le Separate Special Purpose Battalion (OBON).
Ce dernier a été fondé par le gouvernement d’Itchkérie en exil et se veut être son bras armé. Ce groupe serait principalement chargé de conduire des opérations commandos de reconnaissance. Peu d’informations sont disponibles au sujet de ces groupes. Seul un article émanant du site internet pro-russe « Donbass Insider » décrit de manière détaillée le bataillon OBON. L’auteur affirme que l’unité ne serait composée que d’environ 200 combattants dont beaucoup seraient des vétérans du djihad en Syrie et leur salaire en Ukraine serait de 400 euros par mois. Selon le site pro-israélien MEMRI c’est au sein de ce bataillon que combattrait Rustam Azhiev. Depuis 2015, il dirigeait le groupe islamiste tchétchène en Syrie Ajnad Al-Kavkaz. Il serait arrivé en Ukraine vers la fin de 2022 après avoir transité par la Turquie accompagné de quelques dizaines de combattants venus avec lui de Syrie. Il fut accueilli par le chef du gouvernement tchétchène en exil Akhmed Zakaïev. Ces différents bataillons ont été intégré au fur et à mesure à la Légion Internationale ukrainienne. Elle regroupe des volontaires internationaux venus combattre aux côtés de Kiev. Ils sont ainsi formés et équipés par les forces ukrainiennes. Bien que parmi les conditions pour la rejoindre il soit fait mention de l’interdiction d’avoir un casier judiciaire, on constate la présence d’anciens combattants djihadistes. Leur organisation est difficile à établir en raison du manque de sources claires et précises sur le sujet. Certains sont présents depuis 2014 tandis que d’autres ne sont arrivés qu’en 2022. Ils semblent s’être fondus dans la masse auprès d’autres combattants tchétchènes dans les différents bataillons. Leur présence est relativement discrète à l’exception de Rustam Azhiev qui a médiatisé sa venue. Du côté ukrainien, la présence de ces éléments djihadistes est difficile à gérer. En 2019 le gouvernement avait dissous et désarmé le bataillon Cheikh Mansour en raison de ses dérives islamistes avant de le réactiver en 2022. Un dilemme s’impose alors entre conserver ces combattants expérimentés ou les retirer pour éviter de décrédibiliser l’armée dans son ensemble. Si le pays a arrêté et extradé certains djihadistes jusqu’en 2021, cela ne semble plus d’actualité en raison du besoin croissant de soldats depuis le déclenchement de l’invasion. Par ailleurs le parlement ukrainien a œuvré à la mobilisation des indépendantistes tchétchènes en reconnaissant le 18 octobre 2022 l’indépendance de la République d’Itchkérie qui serait « temporairement occupée par la Russie ».
Dans un même temps, l’Ukraine compte environ 500 000 musulmans, principalement des tatars issus de Crimée. Pour autant, il n’y a pas la présence de discours promouvant un jihad contre la Russie de la part des autorités religieuses du pays. Selon l’ancien moufti ukrainien, Saïd Ismahilov, la guerre menée est un jihad car « selon la charia nous avons la permission de protéger nos vies, nos familles et nos propriétés », il n’appelle cependant pas au jihad en raison de la laïcité ukrainienne. On constate ainsi que le djihadisme du côté ukrainien relève davantage de la présence de vétérans du djihad que d’une organisation structurée autour d’un islam radical. Ces éléments semblent disséminés au sein des quatre bataillons « tchétchènes » qui appartiennent à la Légion Internationale Ukrainienne avec, semble-t-il, une prédominance dans les bataillons Cheikh Mansour et OBON. Leur présence sur ce théâtre n’est pas commanditée par d’autres organisations islamistes mais découle d’une volonté personnelle. Leur motivation à prendre les armes en Ukraine ne semble finalement pas si différentes que pour les autres volontaires : lutter contre l’impérialisme russe. Il subsiste cependant une dimension indépendantiste ou revancharde à l’égard de la Russie avec, chez certains, une volonté d’ensuite reprendre le combat en Tchétchénie. Leur présence constitue à la fois un atout militaire pour les forces ukrainiennes mais également un fardeau à gérer en raison de l’image qu’ils peuvent renvoyer à l’international. Il réside également un risque à plus long terme de savoir ce que deviendront ces mercenaires une fois la guerre terminée.
Ainsi, on constate une continuité entre le conflit tchétchène et la présence actuelle de djihadistes en Ukraine. Ce premier conflit a mené à la constitution de groupes armés radicalisés sous l’impulsion de prédicateurs venus notamment d’Arabie Saoudite. Devenus persona non grata en Russie après leur défaite, ils ont poursuivi leur lutte au fil des organisations islamistes. Le début du conflit en Ukraine en 2014 a représenté une opportunité pour certains djihadistes de reprendre les armes contre la Russie. Le besoin en soldats de l’Ukraine et leur recours à combattants étrangers a permis à ces vétérans de s’insérer au sein de bataillons musulmans. Leur présence en Ukraine résulte donc d’un contexte particulier qui remonte aux années 1990. Dans le cadre de ce conflit les vétérans du djihad ne semblent pas revendiquer un objectif religieux ou politique mais davantage lutter contre l’impérialisme russe avant d’envisager de reprendre le combat en Tchétchénie. De l’autre côté du front, la République de Tchétchénie fait également parler d’elle dans le conflit en Ukraine. Depuis son accession au pouvoir en 2007, son dirigeant Ramzan Kadyrov tient la république d’une main de fer. L’invasion de 2022 est une nouvelle occasion de démontrer sa loyauté forte envers Vladimir Poutine en mobilisant les kadyrovtsy et un discours imprégné d’islamisme.
2. L’Islam : un outil au service du politique
La Russie est une fédération divisée en vingt-deux républiques qui peuvent être rassemblées en cinq groupes correspondant aux populations qui les composent : les peuples du Caucase, les peuples turcs, les peuples ouraliens, les peuples mongols et les peuples slaves et turcs. Cette diversité constitue un véritable enjeu dans les politiques menées par le gouvernement central. Il s’agit de fédérer des populations fondamentalement différentes et géographiquement éloignées autour d’un projet commun. Pour ce faire, à la sortie de la seconde guerre de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov a été placé à la tête de la république à la suite de son père Akhmad Kadyrov. Homme fort et loyal au Kremlin, il s’illustre dans l’invasion de l’Ukraine par sa mobilisation d’un discours djihadiste justifiant l’envoi de combattants et d’une communication à outrance pour fédérer ses troupes.
2.1 La justification religieuse de la guerre
Depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022, le narratif du Kremlin défend la vision d’une intervention nécessaire afin de « protéger la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale de la Russie ». À cela s’ajouterait une dimension libératrice de l’Ukraine du joug des néo-nazis. Ainsi, la guerre offensive se transforme en invasion préventive face à un Occident menaçant. Ce discours a par la suite été repris par les différentes autorités du pays notamment religieuses et politiques. En effet, bien que la Russie soit un pays laïc, la religion y joue un rôle majeur dans la propagation du discours politique. On retrouve en tête le Patriarche Cyrille qui dirige l’Église orthodoxe russe et qui se positionne notamment comme défenseur des valeurs traditionnelles de la Russie. Concernant la guerre en Ukraine, il proclamait que « Dieu interdit que la situation politique actuelle dans l’Ukraine fraternelle ait pour but de faire prévaloir les forces du mal qui ont toujours combattu l’unité de la Russie et de l’Église russe ». Au niveau musulman on retrouve en Russie un ensemble d’organisations où chacun de leur dirigeant s’est exprimé sur le conflit. Talgat Tadzhudin, chef de la Direction Spirituelle Centrale Musulmane d’Ufa, a déclaré que c’était « une mesure nécessaire ». Le président du Centre de Coordination des musulmans du Caucase, Ismail Berdiev, a quant à lui défendu le fait que « les innocents avaient besoin d’être sauvé des bandits », reprenant ainsi l’idée d’une Russie protectrice des opprimées. Ce franc soutien des organisations musulmanes à « l’opération spéciale » russe n’est pas désintéressé. Dans les coulisses, ces représentants sont en compétition pour démontrer leur loyauté au Kremlin qui leur fournit les financements dont ils ont besoin.
Ce que l’on constate c’est que la religion en Russie est indirectement contrôlée par le politique ce qui ne laisse pas d’autre choix aux autorités religieuses que de se faire le relais de celui-ci. Le soutien des institutions musulmanes répond davantage à des logiques organisationnelles qu’à une réelle conviction de son bien-fondé. Certains représentants musulmans vont cependant plus loin qu’un simple soutien puisqu’ils vont justifier religieusement la guerre. Des appels au jihad ou encore des fatwa sont proclamées à l’encontre de l’Ukraine. Le Cheikh Salah Hadji Mejiyev, principale autorité musulmane tchétchène a notamment déclaré : « dès le début nous avons décidé que l’opération militaire spéciale était un jihad sacré dans la voie d’Allah le tout puissant ». De plus, le Coran est utilisé à travers la mobilisation des batailles de Badr et Uhud où le Prophète se serait battu aux côtés de non musulmans pour aujourd’hui permettre la lutte avec les chrétiens orthodoxes russes. L’objectif de ces déclarations est de justifier, au niveau religieux, l’envoi au front des musulmans qui représentent 6% de la population russe. C’est un enjeu majeur côté russe puisque les républiques musulmanes semblent être les principales concernées par l’envoi de volontaires. Au début du conflit, un tiers des morts côté russe auraient des noms non slaves et majoritairement musulmans. Cette participation active au conflit est également soutenue par le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov. Il se montre comme un fervent défenseur de « l’opération spéciale » et a même appelé à une escalade des tensions. Placé au pouvoir à la suite de son père, il a depuis 2007 promu un islam dit traditionnel en Tchétchénie. En 2008, il a inauguré la grande mosquée de Grozny pouvant accueillir jusqu’à 10 000 fidèles puis en 2009 il a ouvert une université islamique. Kadyrov a également effectué deux pèlerinages à La Mecque et diffuse régulièrement des contenus religieux sur ses réseaux sociaux. La « réislamisation » de la Tchétchénie semble aller de pair avec le retour à la foi chrétienne promue par Vladimir Poutine. Dans ce cadre, Kadyrov agit comme un relais du pouvoir auprès des communautés musulmanes en Russie et dans le monde islamique. Il représente un islam qui se veut traditionnel et incarne en même temps la loyauté auprès du Kremlin. Il jouit au sein de la Fédération de Russie d’une certaine autonomie et de financements importants venant de Moscou menant, selon Anne Le Huérou, à un État dans l’État. Dans le cadre de l’offensive de 2022, Ramzan Kadyrov en appelle jihad contre le « satanisme occidental ». Au travers d’un discours imprégné d’islam, le président tchétchène cherche à mobiliser ses troupes. Il donne ainsi une dimension sacrée au combat mené sur le territoire ukrainien en créant une différence entre le bien que ses soldats représentent et le mal qu’incarne l’adversaire. Ce discours rentre dans un narratif russe plus large où est régulièrement pointée du doigt la « dégénérescence occidentale ». Kadyrov aurait à sa disposition entre 20 000 et 30 000soldats qui sont appelés les kadyrovtsy. Le principal groupe tchétchène s’appelle « Akhmat-Grozny OMON troops ».
Il fait partie de la garde nationale russe et dépendent du Kremlin. En plus des troupes mises à disposition du pouvoir central, la Tchétchénie dispose d’un centre de formation militaire situé à Goudermes. Après une formation de deux semaines, les volontaires issus de différentes régions de Russie, sont envoyés combattre en Ukraine. Ramzan Kadyrov se place ainsi comme un élément majeur du dispositif offensif russe avec l’envoi de troupes, la diffusion d’un discours légitimateur et la formation d’une partie des nouvelles recrues. Si la dimension religieuse est promue de manière exacerbée par Kadyrov, ce sentiment ne semble pas partagé par ses soldats et les volontaires présents. Les motivations principales semblent davantages être financières ou bien l’obligation d’aller au se battre. Pour leur mission en Ukraine, ils seraient payés 600 000 roubles (6200 euros), dont la moitié payée par le ministère de la Défense et l’autre par la République de Tchétchénie. À cela s’ajouterait une pension de 3 millions de roubles (29 000 euros) pour les blessés ainsi que des primes pour chaque soldat ukrainien tué ou blessé. En réalité très peu toucheraient cet argent. Du côté des familles des victimes, on remarque qu’elles ne laissent pas de vœux sur leurs tombes comme le veut la tradition musulmane pour les shahid morts au pendant le jihad. Ainsi, on constate du côté russe une mobilisation d’acteurs religieux et politiques, principalement Ramzan Kadyrov, pour donner une dimension islamique à l’invasion de l’Ukraine. Cette dernière est dépeinte comme un mal qu’il faudrait combattre au nom de l’islam et ce, même aux côtés de chrétiens. Dans les faits, cette justification semble peu convaincante pour les soldats envoyés au front qui ont pour motivation première l’argent qui leur est promis. Ce qui se joue en réalité est une compétition entre les acteurs pour montrer leur loyauté envers le Kremlin. Celle-ci n’est cependant pas sans risque dans la mesure où cela pourrait conduire à une décrédibilisation des autorités musulmanes russes en raison de leur proximité avec le pouvoir politique. Ce phénomène pourrait à terme profiter à des prêcheurs, notamment islamistes, hors du système officiel à l’image de ce qu’il s’est produit en Tchétchénie entre les deux guerres. Au-delà du besoin de justification au combat et de la démonstration de loyauté envers Vladimir Poutine, la mobilisation d’un discours religieux s’inscrit dans le cadre d’une communication massive. Il agit comme un vecteur de forces morales pour unir les soldats russes mais également effrayer et démoraliser l’adversaire dans le cadre d’une guerre de représentations.
2.2 Communication et guerre de représentations
Historiquement, les notions de terreur et de violence sont associées aux tchétchènes. Cette image a notamment été construite par différents auteurs russes comme Pouchkine dans son poème « Le prisonnier du Caucase ». Plus récemment, les deux guerres de Tchétchénie ont renforcé l’idée de vaillants combattants issus des montagnes. Lors de la mobilisation des kadyrovtsy dans le conflit en Ukraine, les journaux l’ont qualifié « d’arme psychologique » c’est-à-dire « l’emploi de méthodes et techniques de guerre visant à éveiller la peur chez l’adversaire ». En effet, le lendemain de l’invasion, le 25 février 2022, le président tchétchène a rassemblé ses 10 000 soldats sur la place de Grozny afin de proclamer leur mobilisation. Cette représentation théâtrale des forces tchétchènes n’est pas la seule du conflit. Leur leader Ramzan Kadyrov est très actif sur son canal Télégram qui rassemble plus de 2 millions d’abonnés. Il y partage principalement du contenu autour du conflit et de l’islam. Sa communication est très soignée avec des vidéos de haute qualité et du montage. Il se met en scène autour de ses proches et se présente en chef de guerre. On retrouve dans cette communication des éléments déjà présents dans celle de l’État Islamique. Dans sa thèse intitulée « La stratégie de communication du groupe État Islamique, sociologie d’un discours guerrier et violent de propagande et de sa réception par le droit pénal français », Tiffen Le Gall met en avant une distinction entre les vidéos de recrutement axées sur l’escapisme et celles sur le devoir et la guerre. Cette seconde catégorie développe un narratif basé sur l’héroïsme, la virilité et l’aspect guerrier. On retrouve ces éléments dans la communication tchétchène. Elle s’articule, selon Johann Lemaire, autour de trois éléments : ils ne subissent aucune perte, font face à une faible adversité, ils viennent en aide à la population. Cela participe à l’entretien du mythe d’un combattant tchétchène redoutable qui vise à galvaniser ses troupes et susciter la peur chez les ukrainiens.
Cette communication massive est reprise par les kadyrovtsy sur le terrain. Leurs unités sont celles disposant le plus de caméramans au sein de l’armée russe. Ils publient leurs réussites sur le front et partagent un certain esprit de camaraderie. Ils renvoient une image de soldats aguerris qui aiment faire la guerre. Cependant, ce qui est diffusé tranche avec le ressenti de leurs adversaires. En effet, les tchétchènes ne seraient pas de bons combattants en raison d’un manque de préparation en raison d’un entrainement court avant d’être déployé au front. De plus, ces combattants ont habituellement la charge du maintien de l’ordre plutôt que de la guerre frontale. Les ukrainiens les surnomment ironiquement « les combattants de Tiktok » en raison de leur plus grande présence sur le réseau social que sur le terrain. Cette communication rentre dans le cadre d’une guerre des représentations c’est-à-dire « une guerre mentale, symbolique, une guerre de préparation des consciences visant à mobiliser les troupes amis et démobiliser les troupes ennemis ». L’objectif est double. Premièrement, il s’agit de renvoyer une image inspirant la crainte chez l’adversaire afin de les démoraliser. Deuxièmement, il s’agit d’unir ses propres troupes autour de la conviction de sa propre puissance tout en donnant une justification à leur mobilisation. Dans le cas présent, la religion et l’ethnie semblent servir de lien entre les combattants tchétchènes. Ils se regroupent autour des cris « Allah u Akbar » et « Akhmat sila » qui incarnent respectivement le religieux et l’ethnique. Enfin, les faits tendent à nuancer grandement cette communication.
Premièrement, nous l’avons vu, contrairement à ce que diffuse Ramzan Kadyrov, la motivation de ses combattants est davantage l’argent que la défense de l’islam. Deuxièmement, l’unité ethnique des tchétchènes semble compromise au vu de leur présence de chaque côté de la ligne de front. Pour finir, l’image de vaillants combattants est remise en cause par une présence avant tout en deuxième ligne pour notamment s’occuper des déserteurs ou servir de chair à canon. Ainsi, on observe que les technologies de l’information et de la communication sont massivement utilisées et maitrisées par les combattants tchétchènes. Elles sont utilisées aussi bien par les soldats sur le terrain que par le dirigeant Ramzan Kadyrov. Cette communication reprend des pratiques utilisées par l’État Islamique sur la qualité vidéo et les mises en scène représentant la virilité, la cohésion des troupes et la dimension religieuse de la lutte. Pour ce faire, les tchétchènes mettent en avant de manière outrancière les caractéristiques qui leurs sont attribuées de combattants à la fois féroces et pieux. L’objectif poursuivi par cette utilisation importante des réseaux sociaux est d’à la fois renforcer les forces morales des troupes et dans un même temps, véhiculer la crainte chez l’adversaire. Cette stratégie semble avoir un impact limité puisqu’elle ne semble pas suivie des faits à la fois dans sa dimension unificatrice et dans la peur créée au sein des troupes ukrainiennes. Ce que l’on peut donc constater c’est que le djihadisme du côté russe émane avant tout d’acteurs institutionnels et religieux. On assiste à un islamisme étatique qui va venir compléter la légitimation officielle en y ajoutant une dimension islamique. Les Ukrainiens sont décrits comme un mal à combattre entraînant la nécessité de proclamer et mener le jihad. Ce caractère religieux est amplifié et incarné à travers une communication importante notamment de Ramzan Kadyrov qui se positionne en chef militaire guidé par sa foi. L’objectif poursuivi est à la fois de créer un sentiment d’appartenance basé sur la religion pour motiver les troupes et d’en même temps de façonner un mythe autour du combattant tchétchène afin de faire réduire les forces morales de l’adversaire. Derrière ces ambitions, on retrouve en réalité des luttes internes entre des autorités en quêtes de reconnaissance auprès du pouvoir central. Dans les faits, la mobilisation d’un discours djihadiste amplifié par une communication importante semble trouver un écho assez faible au sein des soldats mobilisés qui sont avant tout motivés par le gain financier de leur engagement. Ce que l’on peut donc conclure c’est que le djihadisme dans le conflit ukrainien est protéiforme.
D’un côté, il est marqué par la présence d’anciens combattants du jihad ayant débuté leur lutte en Tchétchénie avant de passer par la Syrie et d’enfin arriver sur le territoire ukrainien. De l’autre, il est un outil utilisé par les institutions religieuses et politiques pour démontrer leur loyauté envers Vladimir Poutine et sert comme une arme de communication afin d’unir les combattants et de déstabiliser l’adversaire. Ainsi, le jihad dans le conflit en Ukraine répond à des dynamiques historiques, institutionnelles et politiques spécifiques. On constate que l’emprunte des groupes terroristes islamistes, notamment l’État Islamique, est encore présente avec la persistance d’anciens combattants dans ce conflit ukrainien et dans l’usage important des réseaux sociaux numériques. Toutefois, si le djihadisme est présent, il est bien différent des combats asymétriques de Syrie ou d’Irak. La présence de djihadistes dans des conflits périphériques n’est pas nouvelle. On peut notamment citer l’exemple de la guerre au Haut Karabakh aux côtés de l’Azerbaïdjan. Si ce phénomène n’est pas nouveau, il est cependant récent. Il correspond à un net recul des différents groupes terroristes, l’État Islamique en tête, et de la question du devenir de leurs membres. La présence de djihadistes tchétchènes en Ukraine illustre bien ce phénomène de combattants devenus plus ou moins apatrides qui se déplacent au gré des conflits. Dans le cas présent, cela se conjugue avec l’élargissement du spectre des forces en présences. La guerre devient de plus en plus hybride avec la présence d’acteurs n’appartenant pas directement aux armées officielles. Nous l’avons vu avec la Légion Internationale ukrainienne mais dans cette continuité, l’usage de mercenaires comme le groupe Wagner, participe à cette hybridation des conflits. Il pourrait être pertinent de poursuivre les recherches sur ce type de modèle d’armée hybride et leurs conséquences sur les conflits futurs.
Bibliographie
Ouvrages Abdelasiem EL DIFRAOUI, Le djihadisme, Paris, Presses Universitaires de France, 2021.