Un commandement, quatre missions et un premier cap pour les acteurs de la profondeur

Une page s’est tournée pour le commandement du renseignement, une autre s’ouvre pour le commandement des actions dans la profondeur et du renseignement (CAPR). Officiellement créé début septembre à Strasbourg, le CAPR et ses trois brigades abordent une nouvelle séquence ponctuée d’enjeux et qui culminera avec l’organisation d’un premier exercice majeur, Diodore 2025.
Réinvestir la profondeur
« Le CAPR est officiellement créé aujourd’hui ». C’est avec ces quelques mots que le commandant de la force et des opérations terrestre, le général de corps d’armée Bertrand Toujouse, actait le 4 septembre à Strasbourg la naissance d’un nouveau commandement alpha au sein de l’armée de Terre. Si le rendez-vous était essentiellement symbolique, il marquait néanmoins un jalon majeur dans un processus engagé il y a environ 18 mois. « Nous franchissons à nouveau une étape », se félicitait le commandant du CAPR, le général de division d’infanterie Guillaume Danès.
Le CAPR, ce sont désormais 15 régiments, unités et centres rattachés à l’état-major ou réunis ou sein de la 4e brigade d’aérocombat (4e BAC), de la brigade de renseignement et cyber-électronique (BRCE) et de la 19e brigade d’artillerie (19e B.ART). Mis sur pied avant l’été, le bataillon de renseignement de réserve spécialisé (B2RS) relève directement de l’état-major installé au quartier Stirn. Idem pour le centre de renseignement Terre (CRT), organisme chargé de la veille et de l’exploitation du renseignement d’intérêt Terre en coordination avec la Direction du renseignement militaire (DRM). Pour tous, l’objectif fixé dès l’origine ne change pas : « proposer des idées pour améliorer la capacité de l’armée de Terre à façonner un adversaire puissant dans la profondeur avant qu’il n’arrive au contact des divisions et brigades interarmes », résume le GDI Danès.

Ce commandement alpha, l’un des quatre récemment créés par l’armée de Terre, a désormais un état-major, un insigne et un fanion tricolore. Trois couleurs pour autant de rappels des brigades qui le composent : le rouge de la 19 B.ART, le bleu clair de la BRCE, le bleu roi de la 4e BAC. Fort de cet amalgame de capacités et de savoir-faire spécialisés, le CAPR devient cet « outil indispensable » destiné à fournir les appui organiques au profit du corps d’armée et de ses divisons et brigades interarmes dans les champs du renseignement, du cyber, de la guerre électronique, des feux dans la profondeur, de la défense sol-air et de l’aérocombat.
Sa zone d’action ? Une frange partant de 50 km après la ligne de contact et s’étendant jusqu’à 500 km sur les arrières de l’ennemi, voire au-delà. Un ennemi capable d’engager plusieurs divisions, soit quelques dizaines de milliers de combattants, et la totalité du spectre capacitaire dont dispose la France et ses alliés. Un ennemi face auquel la France ne s’est plus engagée depuis un quart de siècle, rappelle le GDI Danès en écho à cette préparation « à des temps difficiles » évoquée plus tôt par le chef d’état-major des armées, le général Thierry Burkhard. « L’enjeu de la profondeur est majeur. Il l’est aujourd’hui, comme le démontre tous les jours le conflit ukrainien. (…) Il est en réalité aussi vieux que l’Histoire, tant la profondeur a été le sanctuaire des ressources adverses pour tout pays engagé dans un conflit », rappelait à son tour le GCA Toujouse.
Pour progresser rapidement et de concert, le CAPR mise sur une « Task Force Profondeur » (TF Deep) rassemblant tous les acteurs concernés dans un état-major commun, à contre-courant de l’ensemble de cellules co-localisées mais séparées qui prévalait jusqu’alors. Expérimentale, la structure adopte une configuration unique au sein de l’OTAN. « L’intuition est bonne, je suis sûr que cette Task Force démontrera son efficacité mais il faut encore en apporter la preuve. C’est un nouveau modèle dans l’armée de Terre. L’appropriation par le corps et les divisions prendra du temps et devra démontrer son intérêt par des exercices comme Diodore », concède le général Danès.
Naissance ou renaissance de deux brigades
La matérialisation du CAPR s’est accompagnée de celle de deux de ses trois brigades. Née en 2016, la 4e BAC conserve l’ordre de bataille prévalant depuis le 1er janvier et le rattachement du 9e régiment de soutien aéromobile auprès des 1er, 3ème et 5ème régiments d’hélicoptères de combat. Respectivement créée et recréée, la BRCE et la 19e B.ART agglomèrent quant à elles des unités en provenance de l’ex-COM RENS ou des éléments organiques auparavant subordonnés au deux divisions de l’armée de Terre.
Lointaine descendante de la brigade de renseignement et de guerre électronique, la BRCE rassemble le 2e régiment de hussards, les 44e et 54e régiments de transmissions, la 785e compagnie de guerre électronique et le centre de formation initiale des militaires du rang du domaine du renseignement (CFIM-151e RI). La BRCE hérite de deux missions historiques et d’autant de nouvelles. Traditionnellement, elle aura pour but de commander des unités de renseignement spécialisées dans la détection des menaces que l’ennemi portera sur le dispositif ami et de produire des attaques dans le domaine de la guerre électronique. S’y ajoutent l’identification, la localisation et la destruction de cibles prioritaires dans la profondeur, le tout en coordination avec la 4e BAC et la 19e B.ART, les deux brigades disposant des principaux moyens de frappe dans la profondeur. La lutte informatique offensive (LIO), enfin, entre maintenant dans son périmètre.
Entre le COM RENS et la BRCE, le format diminuera sensiblement. Les 3500 militaires d’avant laisseront place à une brigade plus ramassée d’environ 2500 combattants, la brigade de renseignement « perdant » un 61e régiment d’artillerie et une école des drones rattachés à la 19e B.ART, ainsi qu’un 28e groupe géographique rejoignant la brigade du génie. « Il y a une réflexion en cours sur l’articulation de la chaîne géographique des armées », explique le premier commandant de la BRCE, le général de brigade Vincent Tassel. Pilotée jusqu’à présent par l’état-major des armées, cette chaîne devrait être transférée pour partie à l’armée de Terre, pour partie à la Marine nationale. L’établissement géographique interarmées (EGI) pourrait dès lors devenir un organisme à vocation interarmées à dominante Terre (OVIA-T).

Si le renseignement et la guerre électronique demeurent centraux, « le cyber prend une importance particulière aujourd’hui », note le général Tassel. Certains régiments voient leur domaine de mission évoluer en conséquence. Le 54e RT se voit ainsi confier la mission de la LIO, avec de nouveaux moyens en personnel et en matériels à la clef. Quand cette discrète unité s’avère plutôt tactique et a vocation à accompagner une unité au contact, le 44e RT est quant à lui destiné à armer un bataillon ROEM situé en zone arrière et capable d’agir dans la très grande profondeur. La 785e CGE de Rennes conserve ses deux missions principales, que sont d’inventer et de tester des outils cyber et de guerre électronique. Elle contribue dès lors à la montée en puissance de la LIO.
« La 19e brigade d’artillerie, créée en 1993, est rétablie après 26 années de mise en sommeil », annonçait le GCA Toujouse dans son ordre du jour n°19. Brigade « à haute valeur ajoutée », elle est la seule à disposer de feux longue portée et de moyens d’acquisition dédiés à la contre-batterie au travers du 1er régiment d’artillerie, du seul régiment drones et de renseignement d’origine image – le 61e RA – et du seul régiment de défense sol-air de l’armée de Terre, le 54e régiment d’artillerie. Elle intègre par ailleurs l’école des drones, centre unique de formation et d’expertise dans le segment. À l’heure où le CAPR prenait corps, l’état-major de la 19e B.ART reposait sur une trentaine de militaires. Un format ramassé que la brigade tendra à conserver en écho à l’un de retours d’expérience du conflit russo-ukrainien, celui d’une conversion vers un système de postes de commandement « plus léger, plus réactif, plus furtif et doté de systèmes plus hybrides et redondants », observe son commandant, le général de brigade Marc Galan.
Le général Galan s’est fixé deux objectifs prioritaires. D’une part, la création d’un vrai « esprit brigade » renforcé par l’incorporation effective des unités à compter du 1er novembre. Et, d’autre part, la duplication et l’adaptation des enjeux de synergie et d’innovation poursuivis au niveau supérieur. La 19e B.ART jouera à ce titre un rôle central dans l’accélération de la boucle renseignement-feux dans sa mission d’appui permanent de la manoeuvre aéroterrestre au profit des grandes unités. Elle aura, sans doute plus que d’autres, vocation à s’inscrire dans un environnement interarmées et interalliés. Elle a ainsi reçu pour mission d’armer l’ossature d’une brigade multinationale d’artillerie, autrement dit d’être en capacité d’intégrer des unités alliées similaires. « Il y a un enjeu fort d’interopérabilité lié à la volonté de la France de servir de nation-cadre », relève le général Galan.
Des enjeux capacitaires et de recrutement
La création du CAPR et de ses brigades s’accompagne de nombreuses réflexions capacitaires. À l’exception de l’aérocombat, les différents domaines d’action représentent en effet autant de potentiels à renforcer, d’écueils à combler, voire de capacités à créer de toute pièce. Si les armées ont toujours agi dans le champ électronique, le domaine s’est avéré moins prégnant en Afghanistan, en Irak et au Sahel. « Le retour de la guerre en Europe entre ennemis à parité démontre que la guerre électronique est partout », reconnaît le général Tassel.
Bien qu’engagée après l’éclatement du conflit en Ukraine, l’écriture de la loi de programmation militaire 2024-2030 s’est peu penchée sur la question du spectre électromagnétique. Des discussions sont en cours au sein de l’état-major des armées pour corriger le tir, davantage intégrer le sujet et recréer une trame plus importante à l’échelon interarmées. Un programme d’équipement majeur (PEM) est en cours de déploiement. Il doit doter les armées d’une capacité d’appui électronique via un « système tactique de ROEM interarmées » (SYMETRIE). Preuve du virage engagé, ses cibles ont été augmentées l’an dernier de 49 à 73 cellules de ROEM tactique et de 25 à 36 porteurs pour répondre aux besoin de l’armée de Terre et de la Marine nationale. Porté par le CAPR, le volet terrestre du ROEM s’étend à de nouveaux besoins. Aux systèmes d’interception des signaux radar ou de brouillage des moyens de navigation adverse, par exemple, deux outils que l’armée de Terre entend bien capter.
De nouvelles pistes sont explorées dans tous les domaines, des communications aux drones en passant par les capacités d’aide à la décision. De même, la BRCE s’intéresse de près au monde civil, notamment pour répondre à l’une des grandes difficultés de la profondeur : le renvoi rapide et fiable du renseignement vers l’arrière sans être détecté. « Pour cela, nous parlons de plus en plus d’hybridation des réseaux, cette capacité à basculer de manière fluide des moyens militaires aux moyens civils qui permet parfois de se fondre dans la masse », observe le général Tassel. « J’ai profité d’Eurosatory pour faire la tournée des solutions techniques existantes et leur faire part de notre souhait de les tester l’an prochain », nous glisse pour sa part le patron du CAPR. En ce sens, ce commandement poursuivra son travail d’incubateur du combat dans la profondeur en vérifiant in situ la maturité et la pertinence des solutions « permettant de mieux travailler ensemble ».
L’enjeu relève également des ressources humaines. Si le 2e régiment de hussards recrute sans écueil, « en revanche nous avons plus de difficultés pour la guerre électronique parce qu’il s’agit de métiers très spécialisés », pointe le commandant de la BRCE. Pour ce dernier, il s’agira avant tout de mieux faire connaître des métiers pour lesquels la discrétion est naturellement de mise. En attendant de susciter davantage les vocations, la BRCE tire le meilleur de la montée en puissance de la réserve. Cette brigade a la particularité de disposer d’un état-major tactique de réserve (EMT-R), structure qui a armé l’échelon de commandement du bataillon de cérémonie durant les Jeux olympiques et paralympiques de cet été. « Et puis nous avons un complément de réserve, c’est à dire un certain nombre de réservistes aux compétences bien spécifiques ». Ces profils supplémentaires ne seront pas de trop, la BRCE étant appelée à jouer un rôle central dans la sensibilisation du reste de l’armée de Terre à la résurgence de la guerre électronique. « Tout d’abord, il faut savoir que cette menace existe. Cela peut paraître anodin, mais la guerre en Ukraine nous a incité à remettre de la guerre électronique dans tous nos exercices ». Destiné à se déployer parmi les unités de contact, cet autre espace de conflictualité exige de construire les bons réflexes pour diminuer le rayonnement des postes de commandement ou limiter les communications au strict nécessaire. Ce en quoi l’expertise de la BRCE devient incontournable.

(Crédits image : 54e RT)
Qu’il s’agisse des frappes dans la profondeur ou de la défense sol-air, la 19e B.ART est sans doute la brigade pour qui la marche capacitaire à franchir est la plus élevée. Pour son commandant, « il faut faire mieux dans tous les domaines. Je vais essayer de faire peser la brigade dans tout le domaine capacitaire, sur tout le spectre DORESE ». La LPM 2024-2030 amène un début de réponse. Ce sont notamment les 13 systèmes appelés à remplacer le lance-roquettes unitaire et les 24 Serval Mistral destinés à recréer une défense sol-air d’accompagnement, deux parcs potentiellement doublés à l’horizon 2035. Ce sont aussi les perspectives de développement de nouvelles munitions longue portée mais pas seulement. Sur les feux, « il faut de la précision, de la vitesse et de la masse, tant en pièces qu’en munitions. La mission de l’artillerie reste bien, dans un premier temps, de sidérer et de neutraliser l’adversaire », pointe un commandant de brigade pour qui il sera impératif de « disposer du panel complet de munitions ».
Selon les cas, la LPM prévoit de renouveler l’existant ou de récupérer un embryon de capacité mais sans pour autant répondre entièrement à la question de la profondeur. Le général Galan se veut pragmatique. « À nous aussi de démontrer notre efficacité et nos compétences », insiste-t-il, tout en rappelant que « la guerre en Ukraine n’est qu’un exemple de conflit, nous aurions tort de ne nous focaliser que sur celui-ci ». Il s’agira d’être force de proposition, d’expérimenter. « Beaucoup de choses vont être explorées, comme les munitions téléopérées, les détachement d’acquisition dans la profondeur ». La brigade ne doit par ailleurs pas être limitée à ses matériels majeurs, elle dispose d’un panel de capacités varié. Le radar COBRA, par exemple, « est un matériel très performant dans la lutte contre les tirs indirects ». Idem pour le système de lutte anti-drones MILAD déployé pendant les JOP 2024.
Quatre missions et un cap
Derrière les traditions, le CAPR s’est vu confier une quadruple mission et un premier cap. Effort prioritaire, l’accélération de la boucle renseignement-feux doit contribuer à prendre l’ennemi de vitesse. « Grand Duc aura montré que le sujet n’est pas tant la liaison entre le renseignement et l’artillerie mais plutôt la précision du renseignement pour garantir la confiance de l’artilleur. Et c’est justement en travaillant ensemble que la confiance s’installera », explique le GDI Danès. Surtout, il faut travailler la prise de décision en état-major car, quand deux minutes suffisent pour remonter l’information au poste de commandement, il faut encore « une vingtaine de minutes minimum pour autoriser le feu ».
Seconde priorité, la coordination des acteurs de la troisième dimension impliquera de « se faire confiance et de voler ensemble ». Six mois après l’exercice Grand Duc, l’optimisme reste la norme à la tête du CAPR. « Nous avions fait des progrès très rapides dans le raccourcissement de la chaîne décisionnelle et dans la coordination entre acteurs de la 3D, notamment dans un cadre tactique entre drones belges et hélicoptères français », se félicite son commandant. Depuis, la réflexion a encore évolué pour se concentrer sur la diminution de la ségrégation entre intervenants. « Après 25 années d’opérations extérieures, nous ne faisons pas voler ensemble, au même endroit et au même moment, un drone, une roquette et un hélicoptère », pointe le GDI Danès. Ce qui peut paraître logique pour des raisons de sécurité est en réalité un risque nécessaire « pour être efficace et bousculer notre adversaire ». « Il faut être capable de guider un tir d’artillerie ou un hélicoptère avec un drone », martèle celui pour qui il reste « du chemin à faire » dans la sur-interprétation des règlements et dans l’excès de mesures de protection ».
La troisième priorité « s’impose un peu d’elle-même ». C’est l’intégration interarmes, interarmées et interalliés. « Ce combat dans la profondeur, ce n’est pas que le sujet des trois brigades subordonnées au CAPR. C’est aussi la combinaison d’actions spéciales, de manoeuvres aéromobiles et aéroportées, de tirs de l’armée de l’Air et de la Marine. Et c’est même aussi des actions d’opportunité des unités de renseignement ». Et le spectre peut être élargi à l’influence, à la lutte informatique, bref à tous les espaces de conflictualité. « Le CAPR n’a pas tous les outils en main », souligne son commandant. En l’attente d’un successeur pour le LRU, la France repose en effet sur les alliés pour tirer dans la profondeur depuis le sol et atteindre la ligne des 500 km. Il va donc falloir agir avec les autres. Ce sera l’un des autres objectifs pour les mois à venir : trouver les contacts, ouvrir les bonnes portes, embarquer ou se faire embarquer par les bons acteurs. En interne, ce travail est fait. « L’effort pour moi, c’est d’aller en direction de l’armée de l’Air et de l’Espace, de la Marine nationale, du COM CYBER et des alliés, essentiellement américains », assure le GDI Danès. Jusqu’à imaginer la mise à disposition du CAPR au profit d’un corps d’armée étranger, l’un des scénarios envisagés mais restant à valider. Ainsi, la TF Deep « pourrait être projetée par la France au profit d’un autre corps montant en puissance en début d’opération avant de se constituer, un corps dans lequel une division française pourrait s’insérer par la suite ».

Dernière priorité, la transparence du champ de bataille est finalement loin d’être acquise comme l’a démontré l’Ukraine en déclenchant une offensive en territoire russe cet été. Pour le CAPR, cette capacité à voir avant d’être vu exigera en partie de « faire bénéficier les unités tactiques des moyens stratégiques ». C’est à dire de disposer de certains capteurs de la DRM suffisamment efficaces que pour fournir le renseignement requis par l’échelon tactique. Tant l’imagerie satellitaire que les écoutes conduites aux échelons supérieurs ont gagné en précision et en rapidité de traitement, les rendant intéressantes pour les rythmes adoptés par les brigades et divisions.
« Devant nous, il y a essentiellement ce jalon important fixé en mars 2025 avec la conduite de l’exercice Diodore », annonce le GDI Danès. Rendez-vous de grande ampleur, Diodore amènera un environnement ‘haut’ beaucoup plus complet que lors de Grand Duc, qui se concentre traditionnellement sur l’auto-entraînement des unités de l’ancien COM RENS. « Cette fois, le scénario nous échappe car il est construit par quelqu’un d’extérieur, à savoir le CRR-Fr et le COME2CIA. Nous découvrirons notre adversaire et allons travailler dans un cadre plus stimulant », note-t-il. Le CRR-Fr amènera l’environnement suffisant pour faire travailler la TF Deep, cette unité de circonstance constituée d’éléments en provenance des trois piliers du CAPR. Diodore devrait mobiliser le volume d’une brigade, soit de 4000 à 5000 combattants en partie simulés. L’essentiel se jouera dans l’est de la France parmi les grands camps de Champagne. La manoeuvre sera conduite en deux temps. D’un côté, pour réaliser la mission principale imposée par le CRR-Fr. De l’autre, pour effectuer une dizaine de vignettes permettant de travailler des savoir-faire, des organisations, des procédures spécifiques.
Des synergies à construire aux sauts capacitaires, les défis ne manquent pas pour les prochains mois, les prochaines années. Élevée, l’ambition ne se conçoit pas sans un socle de réalisme. Au sommet du CAPR, le pragmatisme prime : l’essentiel des travaux repose actuellement sur un ensemble d’hypothèses et d’intuitions. À défaut – heureusement – d’engagement majeur, seuls les exercices et expérimentations à venir permettront de confirmer les pistes prometteuses, détecter les corrections nécessaires et, surtout, signaler les impasses. Le CAPR avait dans ce sens mis le pied à l’étrier grâce à Grand Duc. Diodore devrait lui permettre de forcer l’allure.
Crédits image : 2e régiment de hussards


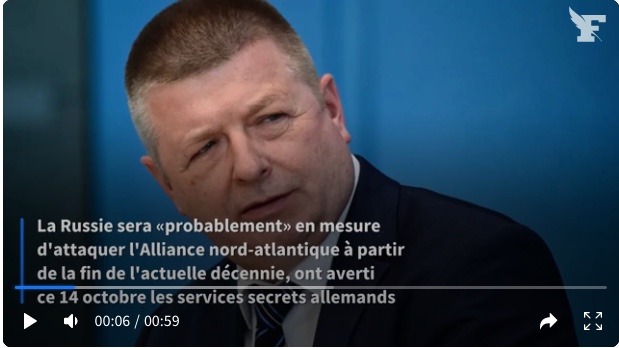




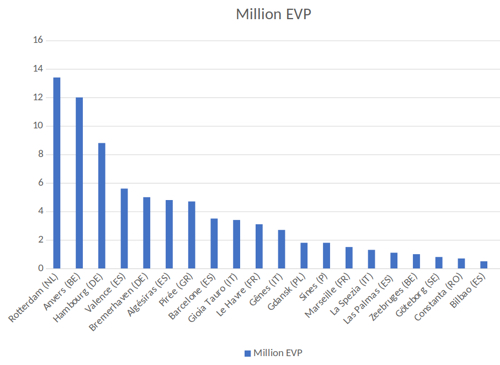


 Dans l’édition 2019 de son « Document de référence d’orientation de l’innovation de Défense » [DROID], l’Agence de l’innovation de défense [AID], alors nouvellement créée sous l’égide de la Direction générale de l’armement [DGA], avait annoncé qu’elle allait avoir recours à des auteurs de science-fiction ainsi qu’à des futurologues pour imaginer « des capacités militaires disruptives ». Et cela au sein d’une structure appelée « Red Team ».
Dans l’édition 2019 de son « Document de référence d’orientation de l’innovation de Défense » [DROID], l’Agence de l’innovation de défense [AID], alors nouvellement créée sous l’égide de la Direction générale de l’armement [DGA], avait annoncé qu’elle allait avoir recours à des auteurs de science-fiction ainsi qu’à des futurologues pour imaginer « des capacités militaires disruptives ». Et cela au sein d’une structure appelée « Red Team ».

