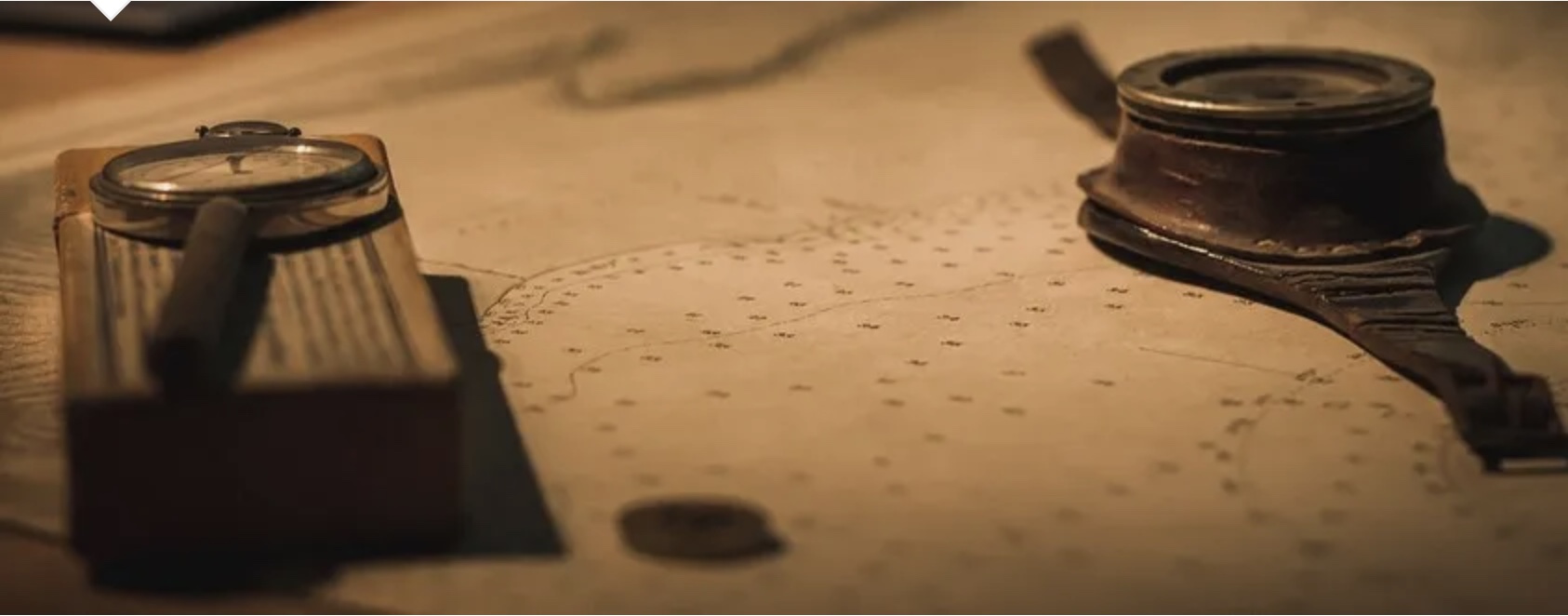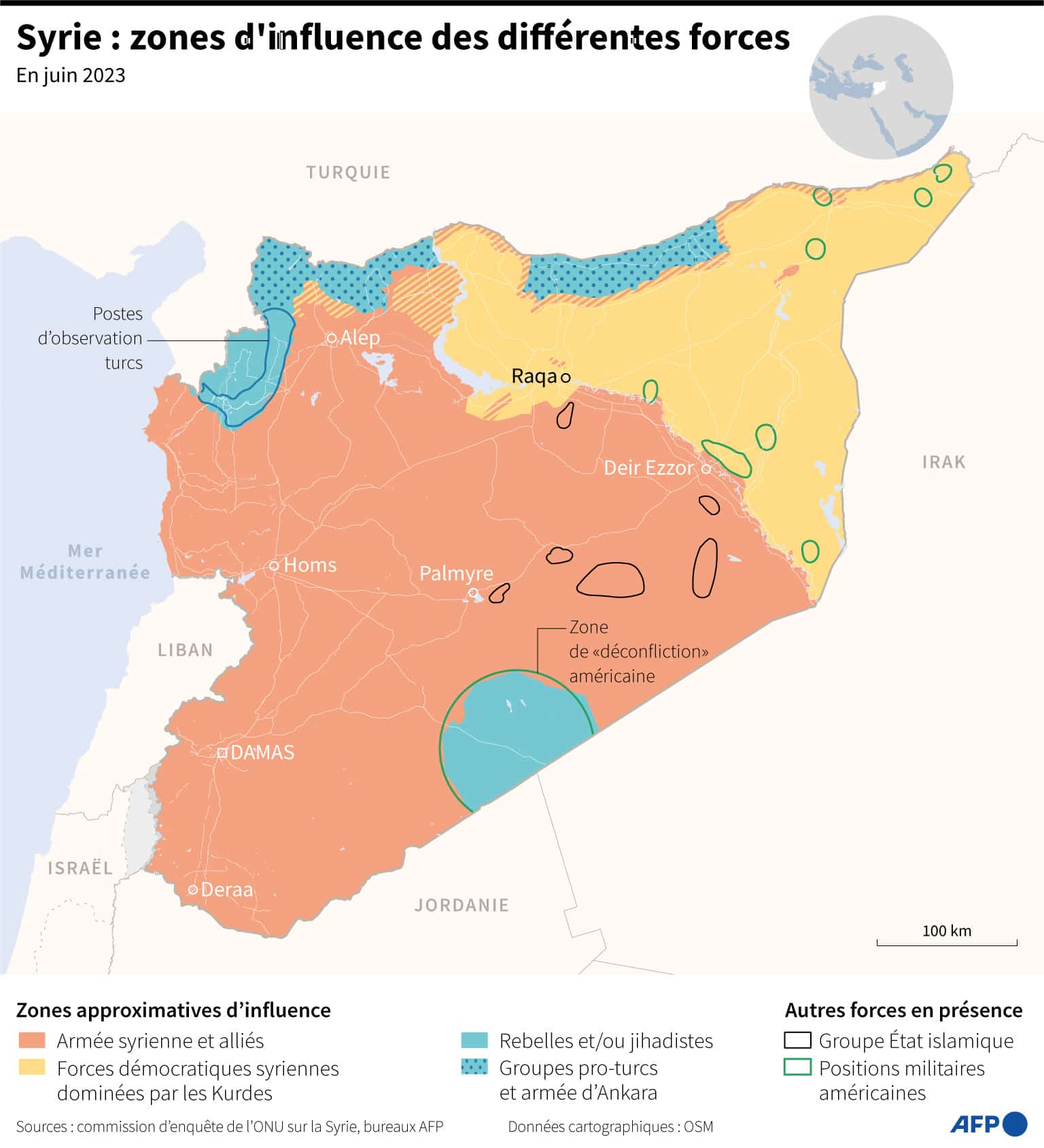La question des îles Éparses et l’importance stratégique du canal de Mozambique (1ère partie)
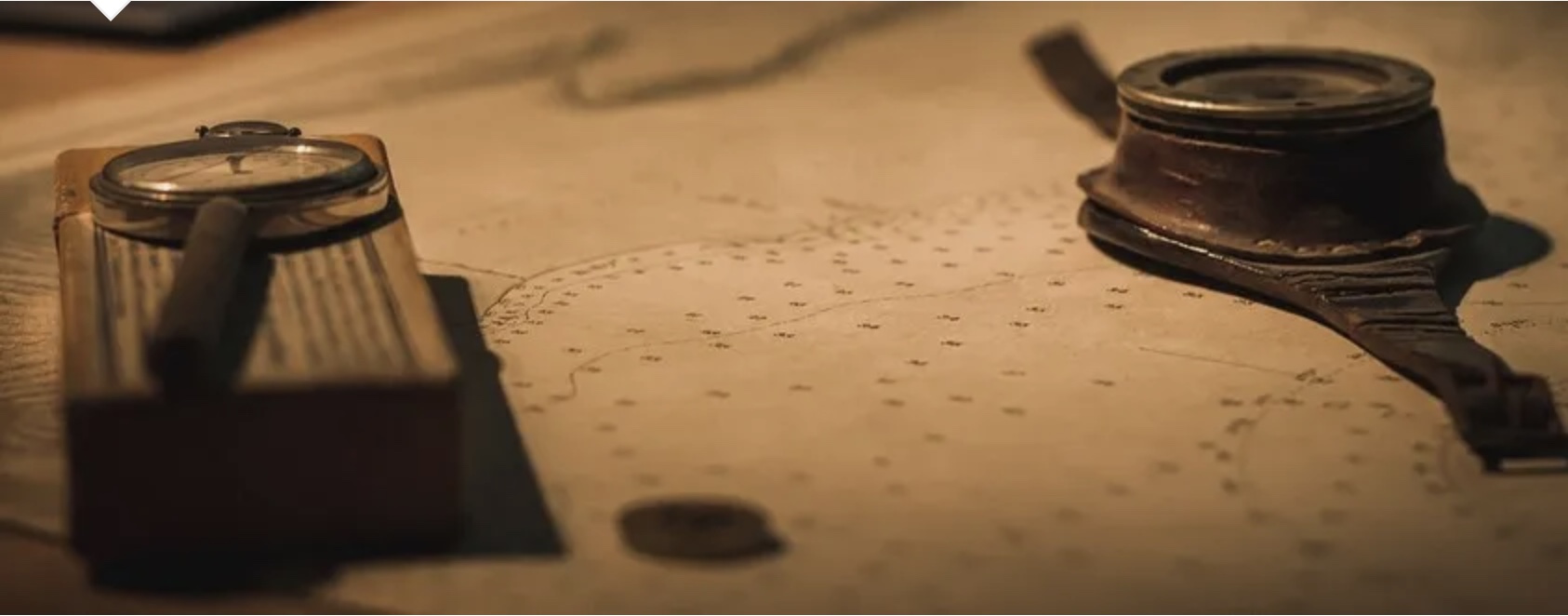
Paul Villatoux (*) – Esprit Surcouf – publié le 15 novembre 2024
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_la-question-des-iles-eparses-et-l-importance-strategique-du-canal-de-mozambique_par_paul-villatoux/
Ce secteur spécifique de l’Océan indien est largement méconnu en France. Pourtant, alors que la zone indo-pacifique est à nouveau au cœur de rivalités géostratégiques, il témoigne d’une importance loin d’être négligeable dont l’auteur nous révèle toutes les spécificités.
Parmi les nombreux points de passage considérés comme cruciaux pour le trafic maritime international dans la zone Indo-Pacifique, le canal de Mozambique est sans doute l’un des plus négligés.
Un espace géographique distinctif
Les raisons de ce relatif désintérêt tiennent à différents facteurs. Parmi ceux-ci, on peut signaler une certaine forme de polarisation sur la zone plus au nord du détroit de Bab el-Mandeb qui relie la mer Rouge au golfe d’Aden. Il convient également d’ajouter que le canal de Mozambique, espace considéré parfois comme périphérique, n’est pas une voie obligée, son contournement par l’Est ne posant pas de problème insurmontable. Enfin, plus généralement, il ne faut sans doute pas sous-estimer le fait que les États-Unis, en plaçant une limite aux côtes occidentales de l’Inde à leur définition de l’Indo-Pacifique, ont participé à une certaine forme de marginalisation de cette zone.
Cependant, depuis environ une quinzaine d’années, le canal de Mozambique retrouve progressivement son statut de point de passage stratégique, tout en concentrant un certain nombre de foyers de tensions qui caractérisent l’Indo-Pacifique aujourd’hui : tensions sécuritaires du fait de la présence de multiples activités illégales (piraterie, pêche illicite, trafics en tous genres, etc.) et de la montée de l’islamisme radical dans le Nord du Mozambique ; tensions géopolitiques dans le cadre des rivalités régionales (quatre pays le bordent – Mozambique, Comores, France et Madagascar en sont riverains) et du déploiement de la stratégie d’influence de la Chine dans l’est africain que lui conteste l’Inde ; tensions économiques enfin consécutives à l’exploitation encore timide des richesses halieutiques et pétro-gazières dont regorgent ou regorgeraient les fonds et sous-sols marins de la région.
Or, cet espace maritime, véritable « espace réticulaire » (réseaux de toutes sortes), revêt une importance toute particulière pour la France qui y concentre un ancrage insulaire certes modeste en superficie émergée, mais qui lui offre une position privilégiée dans le cadre du contrôle de l’espace maritime. La principale caractéristique de cet ancrage est de s’inscrire dans une histoire ancienne et particulièrement mouvementée en raison des conflits de souveraineté qui opposent la France à plusieurs acteurs régionaux.
Si l’on excepte Mayotte, 4 écueils, baptisés administrativement « îles Éparses » nous intéressent ici :
- L’archipel des Glorieuses, à 220 km de Madagascar, qui concentre un peu plus de 7 km² de terres émergées, est la plus septentrionale des îles Éparses. Elle se compose de deux îles coralliennes : Grande Glorieuse au sud-ouest et l’île du Lys au nord-est – et d’un ensemble de platiers récifaux de faible étendue – les Roches Vertes – situés entre les deux.
- Juan de Nova située à 150 km de Madagascar, au milieu de la partie la plus resserrée du canal de Mozambique, à mi-chemin des extrémités nord et sud. Sa superficie est de seulement 5 km².
- Dans la partie sud du canal de Mozambique, à 380 km à l’ouest de Madagascar, Bassas da India est une formation quasi circulaire pratiquement recouverte en intégralité par la mer à marée haute, avec un lagon intérieur peu profond dans lequel se trouvent des bancs et des têtes de coraux.
- Enfin, à moins de 130 km au sud-est de Bassas da India et à 350 km de Madagascar, l’île Europa est la plus méridionale, mais aussi, avec ses 28 km² de terres émergées, la plus grande des Éparses. Elle possède un lagon intérieur en voie de comblement dans lequel baigne une mangrove primaire.
On a l’habitude d’inclure dans ce groupe d’îles l’îlot de Tromelin à l’Est de Madagascar, mais, situé en dehors du canal de Mozambique, nous ne nous y intéresserons pas dans le cadre de cette communication.
Au-delà de leurs différences, ces petites îles ont en commun un certain nombre de caractéristiques communes :
- Elles appartiennent à la même aire géographique et ont des traits géographiques qui se retrouvent dans d’autres îles, notamment les îles extérieures des Seychelles.
- Elles abritent une faune et une flore remarquables, certaines espèces étant endémiques.
- Elles sont dépourvues d’eau potable, à l’exception pour certaines d’elles de vagues puits d’eau saumâtre.
L’objectif de cette étude est de tenter de mieux cerner les enjeux qui se rattachent à la zone du canal de Mozambique sous l’angle de la question des îles Éparses qui constitue l’un plus des anciens et des plus épineux dossiers auquel doit faire face la diplomatie française depuis plus de cinquante ans. Pour ce faire, nous aborderons le sujet en trois grands volets : le premier s’intéressera à la dimension stratégique de la question ; le deuxième abordera l’angle diplomatique et militaire tandis que le troisième s’efforcera de rendre compte de sa dimension économique et environnementale et des enjeux qui s’y rattachent.
La dimension stratégique
Cet aspect de la question pourrait se résumer par la formule : « Les îles Éparses doivent à leur position géographique une importance que ni leur taille ni leurs richesses réelles ou supposées ne peuvent leur conférer. »
Rappelons, en préambule, que le canal de Mozambique mesure 1 600 kilomètres de long, pour 419 kilomètres de large en son point le plus étroit. Ce vaste espace maritime s’étend donc sur presque de 900 000 kilomètres carrés, à des profondeurs allant jusqu’à 3 200 m. Véritable trait d’union entre Madagascar et la côte africaine, il est à la fois un lieu d’échange depuis des siècles et le couloir de pénétration privilégié par les Européens en route vers les Indes. Privilégié, mais non exclusif, car comme nous le rappelions en introduction, le contournement de Madagascar a toujours été possible (ce que les Portugais appelaient au XVIe siècle « la route du dehors » par opposition à la « route du dedans ») au prix d’un jour voire un jour et demi de mer en plus (en fonction de la saison et des vents favorables conditionnés par le mécanisme de la mousson : la mousson d’été souffle de l’Afrique orientale vers l’Inde, la mousson d’hiver souffle en direction inverse). Pour autant le canal s’est rapidement imposé comme une voie de communication internationale et une plaque tournante essentielle pour le commerce reliant le Moyen-Orient, l’Inde et l’Asie de l’Est à l’Europe et au Brésil.
Historiquement, contrôler les îles Éparses, c’est donc contrôler des points de relâche puis d’appui le long du canal de Mozambique. Ces ancrages insulaires servent ainsi pendant des siècles de lieux de traite pour des réseaux de contrebande.
Un premier tournant intervient en novembre 1869 avec l’ouverture du canal de Suez qui bouleverse les grandes voies de communication maritimes entre l’Europe et l’Orient, réduisant d’environ 8 000 km la route entre l’Europe et l’Asie. Il ne faut ainsi plus que 18 jours de mer pour rejoindre Madagascar contre 45 jours auparavant, rendant les trajets moins aléatoires. Si le trafic se déporte en grande partie vers le golfe d’Aden, il se maintient cependant dans des proportions moindres pour des flux secondaires.
Lorsque la France prend possession des îlots du canal de Mozambique entre août 1892 et août 1897, il s’agit pour elle de parachever son maillage de points d’appui et de protection dans cette sous-région de l’océan Indien après les prises de possession de Mayotte et de l’archipel des Comores entre 1841 et 1886, l’installation à Diégo-Suarez en 1885 et enfin la colonisation de Madagascar par la loi du 6 août 1896. Ces îles ne bénéficient alors d’aucun mouillage digne de ce nom et l’idée qui prévaut alors est de pouvoir disposer autour de la Grande Île malgache d’un « glacis protecteur » (c’est l’expression employée à l’époque face aux appétits britanniques. Ces derniers se concentrent cependant plus au nord avec la volonté de sécuriser la route vers l’Inde, perle de leur Empire, et le Moyen-Orient via la Méditerranée, Suez et le golfe d’Aden.
Divers facteurs vont jouer par la suite pour redonner une importance stratégique à cette zone et faire des îles Éparses des points d’appui non négligeables. Il en est ainsi du développement de l’aviation commerciale après la Grande Guerre et du défrichement des premières lignes aériennes. Juan de Nova, opportunément placée au centre du canal, est ainsi choisie pour accueillir une piste d’atterrissage de secours dès 1934, dans le cadre de la mise en place de la liaison aéropostale entre Tananarive et Paris. L’aménagement de pistes semblables à Europa (1950) et à Glorieuses (1965) n’est réalisé qu’après la Seconde Guerre mondiale, dans le prolongement de la mise en place de stations météorologiques destinées tout autant à prévenir l’arrivée des cyclones tropicaux qu’à manifester concrètement une présence française sur ces terres isolées.
Mais le retour au premier plan de la zone du canal de Mozambique sur le plan stratégique s’inscrit dans le développement spectaculaire de la production pétrolière du Moyen-Orient qui passe de 53 millions de tonnes en 1950 à 500 millions de tonnes à la fin de la décennie suivante. La crise de Suez, qui n’éclate à l’été 1956, provoque une fermeture temporaire du canal, faisant prendre conscience de la vulnérabilité de ce dernier et de la nécessité de conserver un contrôle étroit sur l’ancienne route du Cap, véritable voie de secours en cas de détournement du trafic maritime. Ces conceptions gagnent en crédibilité à la suite de la guerre des 6 jours, entraînant une fermeture du canal de Suez en juin 1967 qui se prolonge jusqu’en juin 1975. Le contournement désormais obligé du cap de Bonne Espérance renforce ainsi le caractère stratégique des positions situées à proximité ou à l’intérieur même du canal de Mozambique, d’autant que la hausse brutale des cours du pétrole en 1973 incite à surveiller très étroitement le trafic et la stabilité des flux maritime dans la zone. Les îles Éparses apparaissent ainsi comme de véritables sentinelles avancées sur la route du pétrole.
Mieux encore : la réouverture du canal de Suez en 1975 ne correspond pas pour autant à un effondrement du trafic dans le canal en raison du développement spectaculaire des pétroliers géants (supertankers) de plus 200 000 tonnes qui, à sa réouverture, ne peuvent pas emprunter le canal de Suez. Et même si ce dernier a été agrandi et modernisé à plusieurs reprises, notamment en 2015, pour permettre le passage de navire de plus gros tonnage, le canal de Mozambique continue de voir transiter aujourd’hui 30 % du trafic maritime pétrolier, soit plus de 5 000 navires par an[i].
Le contexte international joue enfin un rôle essentiel. L’abandon de la plupart des bases militaires britanniques « à l’est de Suez » à la fin des années 1960 et au début des années 1970 et la poussée soviétique vers les mers chaudes[ii] se traduisent par une montée en puissance des États-Unis dans la zone sud de l’Océan indien – on pense ici à l’aménagement de la base de Diego Garcia[iii]. Cette recomposition pousse la France à sauvegarder dans la région un maillage de points d’appui particulièrement précieux, dans un contexte où la décolonisation française en Afrique s’achève dans l’océan Indien avec la rupture entre Madagascar et Paris en 1973 puis l’indépendance des Comores en 1975 et enfin celle de Djibouti deux ans plus tard avec cependant le maintien dans la corne de l’Afrique de facilités militaires. La France sauvegarde ainsi sa position de puissance régionale bien positionnée pour contrôler le canal du Mozambique et articuler un système stratégico-militaire constitué du triangle Djibouti-Iles Eparses-Mayotte-Réunion. C’est globalement cette posture qu’elle s’efforce de conserver par la suite en s’adaptant à l’évolution géopolitique internationale, notamment à la suite de l’accélération des événements liés à la guerre froide. C’est ainsi que le repositionnement français dans la région passe par une ouverture à l’ensemble de la sous-région du sud de l’océan Indien en tissant des liens avec des pays qui jusqu’alors faisaient peu – ou pas du tout – partie de sa zone d’influence traditionnelle, qu’il s’agisse du Botswana, du Malawi, du Mozambique, de la Tanzanie, de la Zambie ou des Seychelles. Une fois sa géographie militaire stabilisée, Paris cherche surtout à s’inscrire dans un cadre régional de gouvernance dont témoigne la participation de la France, à partir de 1986, à la Commission de l’océan indien (COI), qui regroupe les représentants de Madagascar, de Maurice, des Seychelles et des Comores, participe de cette volonté de Paris d’affermir sa légitimité régionale et de conforter sa souveraineté sur cet espace autour et à l’intérieur du canal de Mozambique.
La dimension diplomatique et militaire
Pour autant, la question du litige territorial est loin d’être réglée, les îles Éparses comme Mayotte n’étant pas inclus dans le champ de coopération de la COI. Celle-ci renvoie à la période du processus de décolonisation de Madagascar en 1960. À la veille de la prise d’indépendance de la Grande Île, le gouvernement français décide, par le biais d’un simple décret daté du 1er avril 1960, de détacher en toute discrétion les îles Éparses administrativement afin de les placer sous l’autorité du ministre des DOM-TOM, le préfet de La Réunion étant chargé de les administrer. Leur statut est alors incertain, en marge du cadre institutionnel français, ces îles étant considérées comme des domaines privés de l’État à l’accès réglementé. Laissée longtemps dans l’ignorance, la jeune République malgache s’insurge dès les années 1960 contre ce qu’elle considère comme une mesure de captation unilatérale ne respectant pas les frontières héritées de la colonisation. Toutefois, c’est en 1973, au moment du retrait français de Madagascar, que la contestation des autorités malgaches issues de la révolution de mai 1972 se fait plus vigoureuse sous l’impulsion de Didier Ratsiraka qui s’attache à faire amorcer un virage progressiste à la Grande Île
La tension à propos de ces îles monte brusquement d’un cran en novembre 1973, en plein choc pétrolier et quelques semaines après la fin de la guerre du Kippour. Convaincu de l’imminence d’un coup de force malgache sur les îles Glorieuses, le gouvernement français décide la mise en place de garnisons militaires d’une quinzaine de parachutistes et de légionnaires des Forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) assistés d’un gendarme sur les 3 îles d’Europa, de Juan de Nova et des Glorieuses. Ces détachements sont relevés tous les 45 jours suivant un processus logistique relativement lourd : situées à 1 800 km de La Réunion, les îles reçoivent un certain nombre d’aménagements nécessaires à leur ravitaillement (piste d’atterrissage, bâtiments de vie et d’entrepôt, citernes…). Ce dispositif de nature essentiellement dissuasif est complété par le déploiement régulier de moyens maritimes dans la zone du canal de Mozambique, notamment dans le cadre de la surveillance et du contrôle du trafic maritime sur la route du Cap, chapeauté par un commandement opérationnel sous les ordres d’un amiral commandant la zone de l’océan Indien.
Or, si sur le plan militaire la tension s’apaise quelque peu au fil des ans, même si le survol de la Grande Île reste interdit aux avions de l’armée de l’Air, le contentieux franco-malgache se joue, à partir de la fin des années 1970, sur le terrain diplomatique. L’objectif d’Antananarivo est de porter le litige sur la scène internationale et de faire condamner la France qui subit coup sur coup deux revers diplomatiques en décembre 1979 et décembre 1980 par le biais du vote de deux résolutions de l’ONU invitant « le gouvernement français à entamer sans plus tarder des négociations avec le gouvernement malgache en vue de la réintégration des îles ». C’est incontestablement au cours de la décennie 1979-1989 que le différend franco-malgache sur les îles Éparses connaît son apogée, d’autant que l’exemple de la crise des Malouines au printemps 1982 incite naturellement à la vigilance. Pour autant, la fin de la guerre froide et la reprise des relations militaires franco-malgaches au début des années 1990 permettent aux forces armées des deux pays d’entamer une période de coopération fructueuse qui se concrétise rapidement par l’organisation d’exercices bilatéraux et un très actif programme d’assistance militaire. Des projets de cogestion sur les îles sont même initiés dès 1999 par le président Chirac, mais ne déboucheront jamais sur des mesures concrètes.
À dire vrai, à cette date, la question de la souveraineté des îles Éparses semble avoir perdu une grande partie de sa pertinence, alors même que, côté malgache, les problèmes de politique intérieure de la première moitié des années 1990 – crise institutionnelle, économie sinistrée, autosuffisance alimentaire non assurée, déforestation accélérée – font passer au second plan le traitement de ce dossier. Du côté français, ce climat de détente se traduit par l’automatisation progressive des stations de la météorologie nationale, entre avril 1999 et septembre 2001 et même une velléité de retrait des détachements militaires en 2009. Le projet s’inscrit ainsi dans un continuum de décisions dont l’une des plus spectaculaires est le rattachement – en 2 temps 2005 puis 2007 – des îles Éparses aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) en tant que 5e district de cette entité, permettant de leur conférer un statut officiel et définitif.
Plusieurs facteurs vont pourtant bousculer le schéma apaisé qui se dessine à la fin des années 2000. Le premier est avant tout opérationnel dans la mesure où une menace nouvelle fait brusquement son apparition dans la zone du canal de Mozambique : la lutte contre la piraterie – essentiellement somalienne – autour de la Corne de l’Afrique, est en passe de provoquer une déstabilisation de la région. Entreprise en 2008, l’opération militaire maritime européenne « Atalante » dans le golfe d’Aden a pour effet indirect de repousser les pirates dans le sud de l’océan Indien. Aperçus non loin des Seychelles, des groupes de pirates sont même repérés dans les parages de l’archipel des Glorieuses en septembre 2009. Cette menace d’une possible installation de base aérienne par les pirates somaliens n’incite naturellement pas à initier un processus de désengagement. En outre, le canal de Mozambique est de plus en plus en proie à des trafics illicites en tous genres, notamment de drogue : « Le canal du Mozambique fait partie de la route sud de l’héroïne qui relie les zones de production afghanes à l’Afrique australe ». Il en est de même pour la pêche illégale, notamment de concombres de mer, qui attire de nombreuses embarcations agissant pour des commanditaires asiatiques dont certaines n’hésitent pas parfois à narguer les détachements militaires qui ont été dotés de Zodiac pour intervenir au-delà des littoraux afin de lutter plus efficacement contre ce fléau[iv].
Zone concurrentielle, le canal de Mozambique demeure enfin un espace profondément instable. La menace djihadiste, avec la montée de l’islamisme dans les pays d’Afrique de l’Est et notamment au Mozambique depuis 2017[v], constitue ainsi un risque majeur de déstabilisation régionale. La présence militaire française sur les îles Éparses, de par son ancienneté et sa remarquable continuité, apparaît à cet égard comme l’un des rares facteurs de stabilité au sein d’un espace « fragmenté dans son intériorité par les îles qui en font un puzzle de souverainetés » et « écartelé entre plusieurs aires d’influence, politiques, culturelles et marchandes »[vi]. Il est ainsi symptomatique de constater que ce sont précisément les orces des FAZSOI, chargées de se relayer sur les Éparses depuis près de 50 ans, qui, en mars 2021, ont été mis en alerte dans le cadre d’une intervention sur le Mozambique voisin, en proie à une insurrection islamique menée par le groupe Al-Shabab (lié à l’État islamique) dans la province de Cabo Delgado. L’intervention est finalement annulée au dernier moment. Un an plus tard, une équipe de cette même unité est finalement projetée au Mozambique dans le cadre d’un déploiement original mêlant engagement opérationnel et formation des forces militaires locales à la lutte anti-terroriste. Annick Girardin, alors ministre de la Mer, ne s’en est pas cachée : les 300 millions d’euros versés au titre de la coopération bilatérale avec le Mozambique vont « permettre de protéger les îles Éparses et les intérêts de notre pays dans le canal ».
Enfin, dernier facteur important dans la décision du maintien des détachements militaires, la crise politique que connaît la Grande Île en 2009 provoque une forte rancœur à l’égard de la France et ravive les vieux souvenirs de la « Françafrique ». La question des îles Éparses devient un thème important de la politique intérieure malgache, sa médiatisation étant en partie assurée sur les réseaux sociaux et par le biais de la diaspora malgache à l’étranger. Or, sans aucun doute, ce retour du « refoulé » sur les Éparses n’est-il pas étranger aux nouvelles convoitises économiques qui se manifestent. Les revendications malgaches pour la restitution des îles Éparses sont d’autant plus vigoureuses que s’affirment d’autant plus que les discussions entre le Royaume-Uni et l’île Maurice sur la restitution de l’archipel des Chagos (57 îles) a débouché sur un accord le 3 octobre 2024, après un demi-siècle de litiges. Le président malgache Andry Rajoelina ne s’y est pas trompé en invitant les autorités françaises à faire de même (cf interview au Figaro datée du 11 octobre 2024).
À suivre …
[1] Le blocage du canal de Suez pendant six jours en mars 2021 ou la menace que fait peser la rébellion houthi sur son fonctionnement continuent de rappeler l’importance de l’ancienne route du Cap.
[1] L’Union soviétique recherche des points d’appui pour permettre à sa marine de guerre d’étendre son influence politique en direction des mers chaudes (on a parlé à l’époque de « chasse aux îles ») et la poussée des pays du bloc de l’Est se fait sentir tout au long des années 1970 : Madagascar, l’Éthiopie, le Mozambique, la Somalie ou la Tanzanie se sont rapprochés de l’URSS ou de la Chine. La marine soviétique se voit octroyer des facilités de relâche dans certains ports, qu’il s’agisse de l’île Maurice, de Socotra (Yémen) ou de Zanzibar, où son influence économique et politique apparaît grandissante.
[1] Il s’agit pour eux, à la veille de l’allègement de leur dispositif au Vietnam, d’organiser des positions de repli leur permettant de sauvegarder leurs intérêts dans cette partie du monde.
[1] En janvier 2014, un équipage de quinze Malgaches parvient même à débarquer sur Juan de Nova avant d’être rejeté à la mer. Quelques semaines plus tard, le 29 mars, cinq navires et 112 pêcheurs font irruption dans le lagon de Juan de Nova avant d’être arraisonnés par la frégate Nivôse appuyée par le détachement du 2e RPIMa, avec près d’une tonne d’holothuries saisies et rejetées à la mer.
[1] Le Mozambique fait face depuis octobre 2017 à de violentes attaques de la part d’un groupe militant islamiste appelé Ahlu Sunna Wal-Jamaa (les gens de la tradition du Prophète et du Consensus).
[1] Olivier Vallée, « Le canal du Mozambique : un espace géocritique », Le Grand Continent, 15 avril 2021, https://legrandcontinent.eu/fr/2021/04/15/le-canal-du-mozambique-un-espace-geocritique/
[i] Le blocage du canal de Suez pendant six jours en mars 2021 ou la menace que fait peser la rébellion houthi sur son fonctionnement continuent de rappeler l’importance de l’ancienne route du Cap.
[ii] L’Union soviétique recherche des points d’appui pour permettre à sa marine de guerre d’étendre son influence politique en direction des mers chaudes (on a parlé à l’époque de « chasse aux îles ») et la poussée des pays du bloc de l’Est se fait sentir tout au long des années 1970 : Madagascar, l’Éthiopie, le Mozambique, la Somalie ou la Tanzanie se sont rapprochés de l’URSS ou de la Chine. La marine soviétique se voit octroyer des facilités de relâche dans certains ports, qu’il s’agisse de l’île Maurice, de Socotra (Yémen) ou de Zanzibar, où son influence économique et politique apparaît grandissante.
[iii] Il s’agit pour eux, à la veille de l’allègement de leur dispositif au Vietnam, d’organiser des positions de repli leur permettant de sauvegarder leurs intérêts dans cette partie du monde.
[iv] En janvier 2014, un équipage de quinze Malgaches parvient même à débarquer sur Juan de Nova avant d’être rejeté à la mer. Quelques semaines plus tard, le 29 mars, cinq navires et 112 pêcheurs font irruption dans le lagon de Juan de Nova avant d’être arraisonnés par la frégate Nivôse appuyée par le détachement du 2e RPIMa, avec près d’une tonne d’holothuries saisies et rejetées à la mer.
[v] Le Mozambique fait face depuis octobre 2017 à de violentes attaques de la part d’un groupe militant islamiste appelé Ahlu Sunna Wal-Jamaa (les gens de la tradition du Prophète et du Consensus).
[vi] Olivier Vallée, « Le canal du Mozambique : un espace géocritique », Le Grand Continent, 15 avril 2021, https://legrandcontinent.eu/fr/2021/04/15/le-canal-du-mozambique-un-espace-geocritique/
 |
(*) Paul Villatoux est docteur en histoire des relations internationales et habilité à diriger des recherches. Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages et de plusieurs centaines d’études, d’articles et de communications sur l’histoire militaire et le monde contemporain. Il est par ailleurs rédacteur en chef des magazine Gazette des Armes et Action et responsable éditorial des éditions Mémorabilia. |