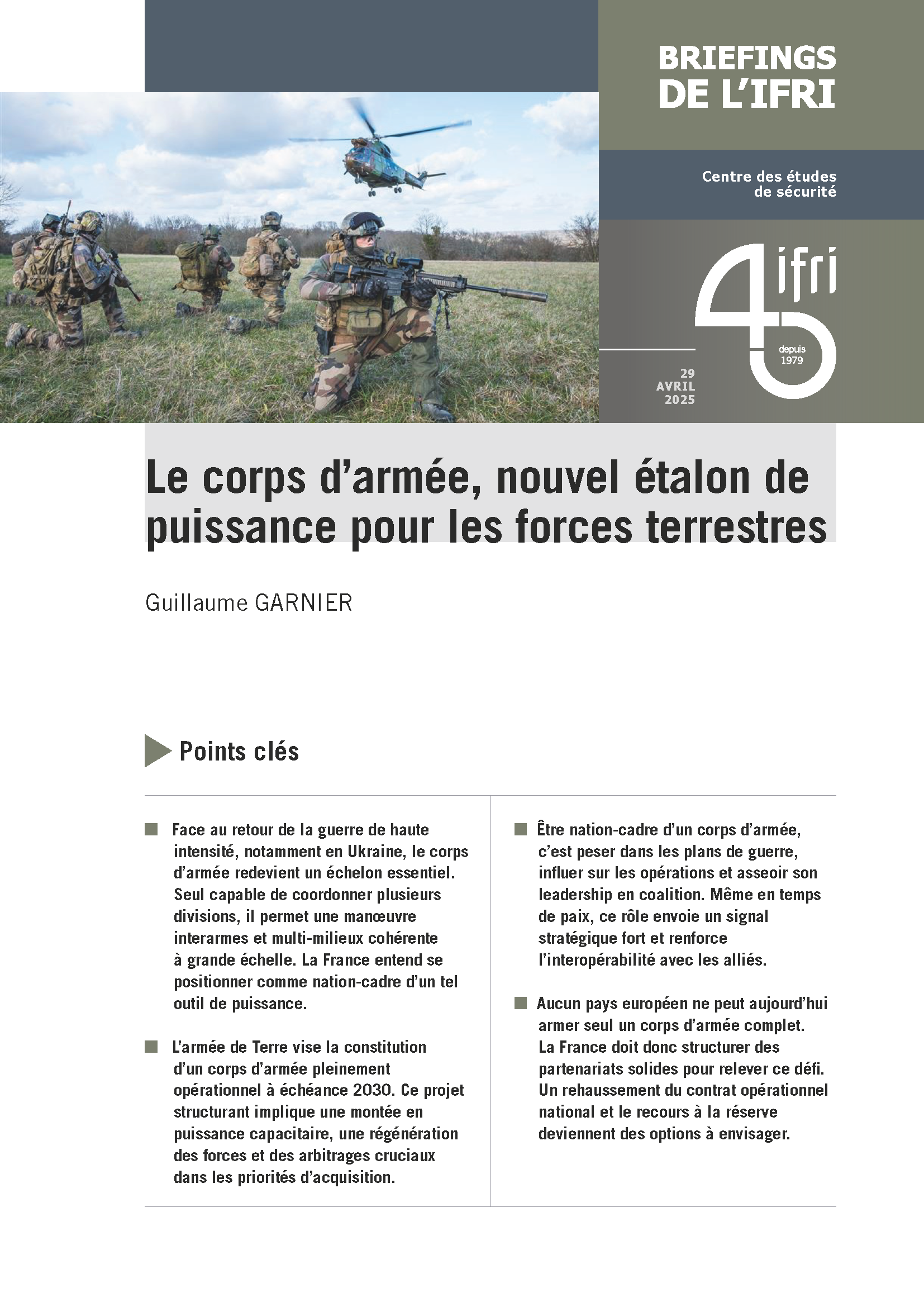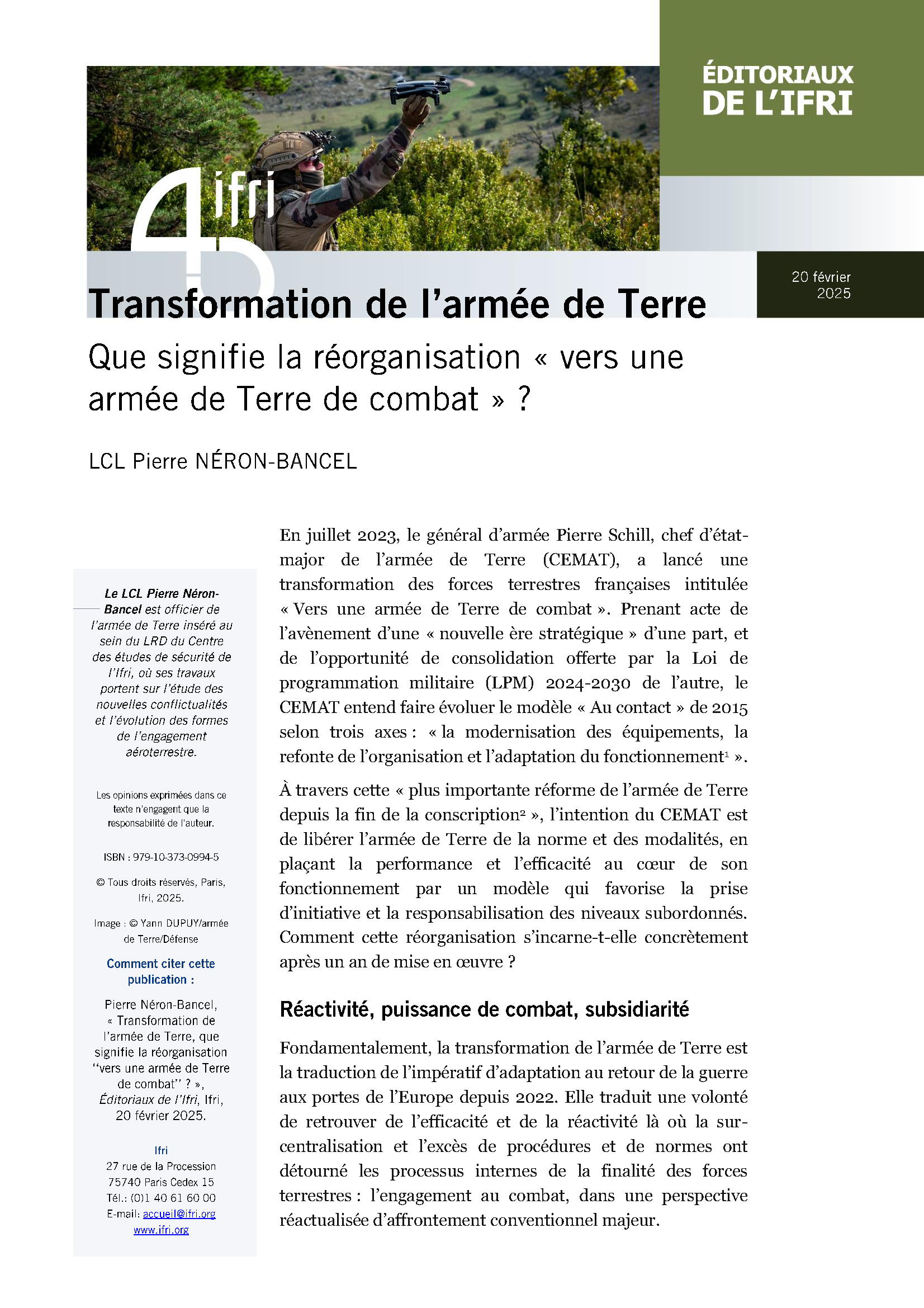L’armée française prépare la guerre de demain

https://www.revueconflits.com/larmee-francaise-prepare-la-guerre-de-demain/
Le mardi 14 mai 2025 s’est déroulé à l’École Militaire le Cercle de l’Innovation et du Combat Futur (CICF) organisé par le Pôle rayonnement de l’armée de terre (PRAT). L’objectif ? Faire le point sur les ambitions de l’armée de terre, sur ses capacités opérationnelles et sur ses besoins en vue d’anticiper les combats de demain.
« Le monde est en train d’évoluer et il faut s’y adapter », a introduit le général Bruno Baratz, commandant du Commandement du combat futur, traçant ainsi le sillon à suivre pour les discussions à venir. L’événement a permis la réunion du trilogue entre la Direction générale de l’armement (DGA), les forces armées et les industries de défense, dans une optique de préparation de conflits de haute intensité, auxquels la France pourrait prendre part dans les années à venir.
À l’heure où se prépare la table des négociations à Istanbul et où l’avenir de l’Ukraine semble plus que jamais incertain, les menaces affluent de divers horizons. Dégradation de la situation au Liban, en Syrie, entre l’Iran et Israël, entre l’Inde et le Pakistan, une pression croissante sur Taïwan, une situation en France crispée par le maintien d’une menace terroriste, l’armée de terre française veut s’adapter pour « faire face ».
Les conflits actuels témoignent d’une dynamique générale de robotisation et d’autonomisation des systèmes d’armement, à laquelle il faut être à la hauteur. « Notre mission n’est-elle pas de gagner la guerre avant la guerre » ? interroge le chef de l’armée de terre, le général Pierre Schill. D’où l’urgence d’anticiper, et de prévoir la guerre du futur.
Une nécessité d’innovation et de réarmement
Dans l’amphithéâtre Foch de l’École militaire et devant des centaines d’officiers, industriels, journalistes et civils de la Défense, les officiers supérieurs se succèdent dans la prise de parole. Leur position est unanime : la France a pris du retard dans sa souveraineté stratégique, mais les moyens sont mis en œuvre afin de la résoudre. Et c’est urgent.
Alors que l’Ukraine vise à produire 4,5 millions de drones par an dans les années à venir, les derniers chiffres font état d’à peine 4000 drones à usage militaire en France. Devant l’omniprésence de ces drones dans les conflits, devenus déterminants, ces chiffres sont le reflet d’un retard stratégique accumulé ces dernières années, n’attendant qu’à être comblé. Et le ministère des armées, notamment à travers la DGA, s’y emploie résolument. Ses derniers résultats en témoignent.
Premièrement, la loi de programmation militaire 2024-2030 rehausse le budget alloué aux armées à 413 milliards d’euros, sur l’ensemble de ces années. Ensuite, la production d’armement s’accélère : la production des canons Caesar a été multipliée par deux, voire trois. Celle de ses munitions est passée de 30 000 à 60 000 par an. Dassault a hissé sa production de rafales d’un à trois par mois. En parallèle, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a inauguré en mars dernier une ligne de production de poudre gros calibre pour les systèmes d’artillerie de l’usine Eurenco, à Bergerac. Et enfin, les programmes de modernisation s’accentuent. Scorpion, le système de combat aérien du futur (SCAF), le Main Ground Combat System (MGCS), le porte avion nouvelle génération (PA-NG), le pacte drones aériens de défense, visent tous multiplier et moderniser les systèmes de défense. Le Pacte drone, justement, réunit une centaine d’entreprises civiles et militaires autour d’un projet commun : l’émergence d’une filière dynamisant le développement et la production de drones de contact.
Tout cela est bien le signe d’une volonté d’acquérir et de développer une autonomie stratégique en matière de conception et de production d’armements. Un objectif : être à la hauteur des conflits de demain.
Co-Ho-Ma : coopération homme-machine
Si la tendance est davantage à la robotisation des combats et à la transparence du champ de bataille, l’homme continuera à prendre toute sa part dans les combats futurs. C’est l’avis du Commandement du combat futur, qui considère que le soldat aura à connaître des situations de stress extrême, et que préparer la guerre de 2040, c’est également préparer l’homme à absorber des charges cognitives immenses. C’est le tandem homme-machine, que le ministère s’efforce d’accroître. Le général Baratz précise justement « qu’il ne faut pas opposer la technologie et la masse, puisque nous avons besoin des deux », voyant en eux une forme de complémentarité.
Le triptyque forces – DGA – industrie : un levier essentiel
Le CICF représente une « occasion unique de dialogue entre les forces armées, la DGA et les industriels ». C’est ainsi que l’ancien numéro deux de l’armée de terre, le général Bernard Barrera a ouvert la table ronde réunissant le chef d’état-major de l’armée de Terre, Pierre Schill, Emmanuel Chiva, de la DGA, et le président du GICAT, Nicolas Chamussy, représentant la base industrielle et technologique de défense (BITF).
Les acteurs de la table ronde ont ainsi abordé la question du besoin fondamental de disposer de capacités importantes tout en maîtrisant les coûts. Cela ne se fera que par l’affermissement de la collaboration entre le monde de la défense et celui civil. La complexité de l’ère d’extrême modernisation entamée depuis peu obligera au renforcement de ces liens.
Ainsi, rassembler les représentants des forces armées terrestres, de la DGA et des industries de défense, c’est témoigner de l’existence d’une réflexion commune autour de ces enjeux. C’est montrer que les moyens mis en œuvre sont à la hauteur des ambitions affichées par les armées. Si cela prendra du temps, le CEMAT rassure : « Je ne vois aucune raison pour laquelle la France ne serait pas capable de répondre aux enjeux de demain ». Au délégué général pour l’armement, Emmanuel Chiva, de conclure : « Nous sommes capables de le faire ».
Anticiper et prévoir : une leçon de l’histoire
L’amiral Philippe de Gaulle, fils du général, se confiait à Sébastien Lecornu avant de s’éteindre en mars 2024 : « Il y a une question que je me pose encore, M. le ministre. Je vais bientôt mourir et il y a quelque chose que je ne m’explique toujours pas. Mais pourquoi a-t-on perdu en 40 ? ».
Une interrogation, plus de 80 ans après les faits, qui révèle sans doute un traumatisme demeuré ancré dans la mémoire des anciens. Les réponses à la défaite, elles, sont nombreuses. Un commandement qui peine à penser la guerre à mener. Un état-major incapable de s’adapter aux nouvelles formes de la guerre, loin des guerres de tranchées de la Grande Guerre. Un ennemi mieux préparé, qui a prévu et préparé le conflit.
Les responsables politiques et militaires français cherchent à tirer tous les enseignements de cette blessure française, en vue de forger les armées de demain.