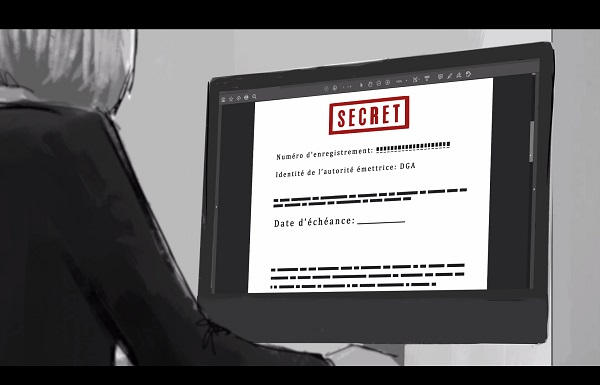C’est qui le chef ?

par Michel Goya – La Voie de l’épée – publié le 27 juin 2024
https://lavoiedelepee.blogspot.com/
Dans les systèmes monarchiques, c’est le souverain qui, par tradition, commande les armées y compris normalement sur le terrain. Avec l’arrivée des régimes républicains, et de fait avec la constitutionnalisation des monarchies, les choses sont devenues un peu plus compliquées. La Constitution de 1848 en France indique par exemple dans son article 50 que le Président de la République (PR) élu au suffrage universel « dispose de la force armée, sans pouvoir jamais la commander en personne ». Les premiers projets de lois constitutionnelles de la IIIe République reprennent la formule, ce qui suscite la colère du « maréchal-président » Mac Mahon (élu par l’Assemblée en mai 1873). Devant sa menace de démission, l’amendement Barthe (1er février 1875) est repoussé et l’article 3 de la loi du 25 février 1875 indique seulement que le Président « dispose de la force armée ». Ce pouvoir est néanmoins limité par l’obligation de contreseing d’un ministre pour toutes les décisions du Président, la possibilité d’être poursuivi pour haute trahison et l’obligation d’assentiment des deux chambres pour déclarer la guerre.
Le maréchal de Mac Mahon a cependant suffisamment de latitude pour organiser un « domaine réservé », une expression de Chaban Delmas en 1959 pour désigner les prérogatives particulières qui devraient être accordées au PR en matière de défense et de politique extérieure. Mac Mahon accorde beaucoup de d’intérêt aux réformes militaires en cours et traite directement avec les ministres et les généraux de corps d’armée qu’il reçoit à l’Élysée. Il tient à désigner lui-même les ministres de la Guerre et de la Marine. La crise du 16 mai 1877 coupe court à cette interprétation. Avec la « constitution Grévy » et la révision de 1884, la France adopte un régime parlementaire et le Président de la République n’exerce plus qu’une « magistrature morale », ce qui permet à Poincaré d’imposer Clemenceau comme Président du Conseil en décembre 1917 mais ne suffit pas à Albert Lebrun pour empêcher la crise des institutions de juin 1940. Cette dernière crise et le désastre qui l’accompagne est en garder en tête pour comprendre l’esprit des institutions de défense de la Ve République.
Notons au passage que le général de Gaulle met en place dans la « France combattante » un système très simple, avec un chef du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) décideur unique avec sous ordres directs un État-major de Défense nationale pour la conduite des opérations et un ministre de la Défense nationale (et non quatre ou cinq ministères, de la Défense nationale, de la Guerre, de l’Air, de la Marine, de l’Armement). Le chef du GPRF est assisté d’un Conseil de défense nationale réunissant tous les ministres concernés par cette guerre désormais totale. Autant d’éléments que le général de Gaulle s’efforcera d’imposer dans les institutions et la pratique de la Ve République.
En attendant, l’expression « Chef des Armées » apparaît dans un décret du gouvernement provisoire de la République en date du 4 janvier 1946 avant d’être reprise, sur proposition du général Giraud alors député, dans la Constitution de 1946 (art. 33 « Le président de la République préside, avec les mêmes attributions [que pour le Conseil des ministres, c’est-à-dire faire établir et conserver les procès-verbaux], le Conseil supérieur et le Comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées. »). Mais l’article 47 précise que « le président du Conseil [qui devient une fonction en soi et non un ministre supérieur aux autres], assure la direction des forces armées et coordonne la mise en œuvre de la Défense nationale ». La gestion de la politique de Défense de la IVe République n’est finalement pas très différente de celle de la IIIe avec ses qualités et ses énormes défauts, évidents lors de la guerre en Algérie.
La nouvelle paralysie institutionnelle qui apparaît à cette occasion impose une réforme profonde des institutions et une nouvelle Constitution. Pourtant, étrangement, cette constitution n’apparaît immédiatement pas très différente de celle de 1946 dans son organisation de la Défense nationale. L’article 15 de la Constitution de 1958 (« Le Président de la République est le Chef des Armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale », sans préciser quelles sont les compétences qu’il exerce à ce titre) est peu différent de l’article 33 de la Constitution de 1946. De plus, l’article 19 (« Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. ») ne fait pas référence à l’article 15. Les actes du Président de la République en conseil de défense doivent donc normalement être contresignés par le Premier ministre. Si on ajoute l’article 20 (« le gouvernement dispose de l’administration et de la force armée ») et l’article 21 (« Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale ») de la Constitution mais aussi l’article 7 de l’ordonnance de 1959 (« la politique de défense est définie en conseil des ministres ») et son article 9 (« le Premier ministre, responsable de la Défense nationale, exerce la direction générale et la direction militaire de la Défense »), on obtient quelque chose de proche de l’esprit de la IIIe ou de la IVe République.
Le général de Gaulle ne l’interprète pas de cette façon dans ses Mémoires d’espoir (« Il va de soi, enfin, que j’imprime ma marque à notre défense […] cela pour d’évidentes raisons qui tiennent à mon personnage, mais aussi parce que, dans nos institutions, le Président répond de « l’intégrité du territoire » [art.5], qu’il est « le Chef des Armées », qu’il préside « les conseils et comités de Défense nationale » »). La personnalité du nouveau président de la République et les évènements en Algérie – et pour le général de Gaulle le plus choquant d’entre eux est la rébellion d’une partie de l’armée – impose une centralisation des pouvoirs à son profit. À partir d’avril 1961, la dualité des pouvoirs entre le PR et du PM s’efface au profit du premier et d’une manière générale au profit des civils. L’état-major du Premier ministre redevient le Secrétariat général de la défense nationale à direction civile et le Chef d’état-major général de Défense nationale, l’actuel Chef d’état-major des armées (CEMA), perd beaucoup de ses prérogatives. L’ordonnance de 1959, finalement abrogée en 2004, perd une grande partie de sa substance. Et puis deux phénomènes particuliers sont apparus.
Arguant du caractère très particulier de l’arme nucléaire et de la nécessité de décision urgente, le décret du 14 janvier 1964 « relatif aux forces aériennes stratégiques » décide que le Président de la République a seul qualité pour décider l’emploi du feu nucléaire, ce qui est contradiction avec les dispositions de la Constitution et de l’ordonnance de 1959. Ce décret a été abrogé et remplacé par celui du 12 juin 1996 plus conforme aux textes constitutionnels et législatifs mais qui conserve un caractère ambigu. Dans son article premier, le conseil de défense doit définir « La mission, la composition et les conditions d’engagement des forces nucléaires » alors que le président chef des armées et président du conseil de défense « donne l’ordre ». Cela est considéré très majoritairement comme un « ordre de conduite » et non une décision nécessitant donc le passage par un conseil de défense et le contreseing du Premier ministre, mais pourrait être interprété différemment si une situation de crise plaçant la France devant un tel choix survenait en période de cohabitation hostile. On se demande si un président de la République pourrait réellement engager le feu nucléaire en premier (en riposte, la question ne se pose pas) alors qu’il doit faire face à un gouvernement, une majorité et donc un peuple hostile. Plus largement, la question se pose du maintien au pouvoir d’un président désavoué par le peuple. Le général de Gaulle avait tranché cette question à sa manière mais tout le monde n’est pas de Gaulle.
Et puis, il y a eu la multiplication des opérations extérieures, rendues possibles justement par la centralisation des institutions. Une opex, c’est une opération décidée par le président de la République, et comme c’est très facile alors que la France a de nombreuses obligations internationales, elles deviennent très nombreuses. Cela pour premier effet de remettre les militaires dans la boucle décisionnelle. Premier ministre et ministre de la Défense/Armées ont leurs états-majors particuliers et le CEMA redevient premier conseiller militaire et membre du Conseil de défense tout en étant en ligne directe avec le PR pour la conduite des opérations. Mais cela a pour effet également de multiplier les conseils de défense dès lors que l’on considère que ces opérations extérieures sont importantes, or qui dit conseil de défense dit in fine approbation du Premier ministre. Cela ne pose pas de problème en cas de situation normale, ou s’il y a désaccord cela se traduit par une démission, comme celle du ministre de la Défense en 1990 au moment de la guerre du Golfe et de la décision de François Mitterrand d’y engager les forces françaises.
En cas de cohabitation c’est forcément plus compliqué et cela se traduit souvent par une négociation entre les deux têtes de l’exécutif. On se souvient des difficultés de lancer l’opération Turquoise au Rwanda en 1994, contrairement à l’opération Noroit au même endroit deux ans plus tôt en période « normale ». Turquoise est finalement engagée mais aux conditions du Premier ministre Édouard Balladur. En décembre 1999 en revanche, le Premier ministre Lionel Jospin s’oppose totalement à une opération de contre coup d’État en Côte d’Ivoire.
Depuis la réforme constitutionnelle de 2008 se pose aussi un autre problème. Avant l’engagement dans la guerre du Golfe (1990-1991), le PR avait ordonné au gouvernement de poser la question de confiance selon l’article 48.1 devant l’Assemblée nationale et de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale (art 49.4), afin d’asseoir la légitimité de son action. Mais il disposait alors de la majorité et le vote de confiance ne posait guère de difficultés. Désormais, le Parlement doit obligatoirement voter la poursuite ou non d’une nouvelle opération au bout de quatre mois. On imagine par exemple que l’envoi de militaires français en Ukraine soit jugé suffisamment important pour justifier d’un Conseil de défense, première étape, puis en cas d’approbation, d’un vote au Parlement. Quelle que soit la nouvelle configuration de l’Assemblée nationale le 7 juillet, on peut imaginer qu’on n’est pas prêt dans ce cas d’avoir des soldats français en Ukraine. Notons au passage que tous ces blocages éventuels sont des incitations au contournement en faisant appel aux services clandestins ou discrets et même, comme aux États-Unis aux sociétés privées.
Notons que si le Premier ministre ne peut déclencher lui-même d’opérations extérieures, il peut déclencher des opérations intérieures en tant que premier responsable de la sécurité du territoire. Dans la confrontation avec l’Iran qui s’est traduit notamment pas une série d’attentats terroristes sur le sol français en 1986, le Président de la République a déclenché quelques mois plus tard l’opération Harmattan dans le Golfe arabo-persique. Entre temps, le Premier ministre et rival pour la future présidentielle, Jacques Chirac, ne voulait être en reste et avait déclenché l’opération intérieure Garde aux frontières et envoyé des soldats renforcer douaniers et policiers de l’Air et des Frontières. Cela n’avait aucun intérêt opérationnel, mais cet engagement inédit de soldats sur le sol français métropolitains (le pas avait été franchi en Nouvelle-Calédonie) permettait au Premier ministre d’exister politiquement.
Pour résumer, la reconnaissance d’un pouvoir entier et personnel du Président de la République comme chef des Armées ne peut plus être niée. La question a été tranchée dans ce sens par le Comité consultatif pour la révision de la Constitution dans son rapport du 15 février 1993. Le comité, tout en jugeant discutable l’expression « domaine réservé », a estimé que ; malgré certaines ambiguïtés, l’exercice de pouvoirs propres en matière de défense par le Président de la République correspondait à une « tradition trentenaire ». La tradition est ainsi devenue une source de droit en matière constitutionnelle à condition de justifier d’une application « paisible » pendant une certaine durée. On notera que le comité avait proposé de modifier l’article 21 de la Constitution comme suit : « Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement. Il est responsable de l’organisation de la Défense nationale » afin de refléter la réalité des choses. Cela n’a pas été fait et le Premier ministre, s’il ne peut rien déclencher de vraiment nouveau en politique de défense, ni même sans doute mettre fin à quoi que ce soit d’important, conserve une grande capacité de blocage. Maintenant que la coïncidence des élections présidentielle/législatives n’existe plus et que les cohabitations risquent à nouveau de se multiplier, il n’est pas certain ensuite que l’interprétation actuelle, même confortée par une longue pratique, tienne éternellement.