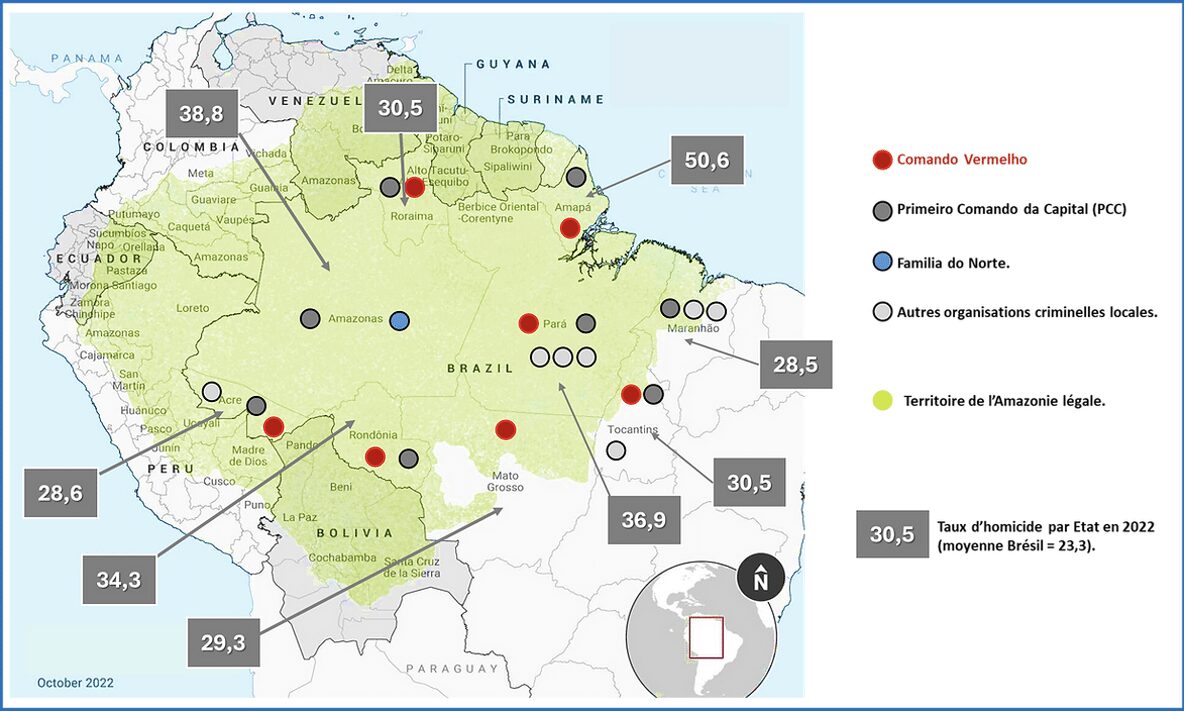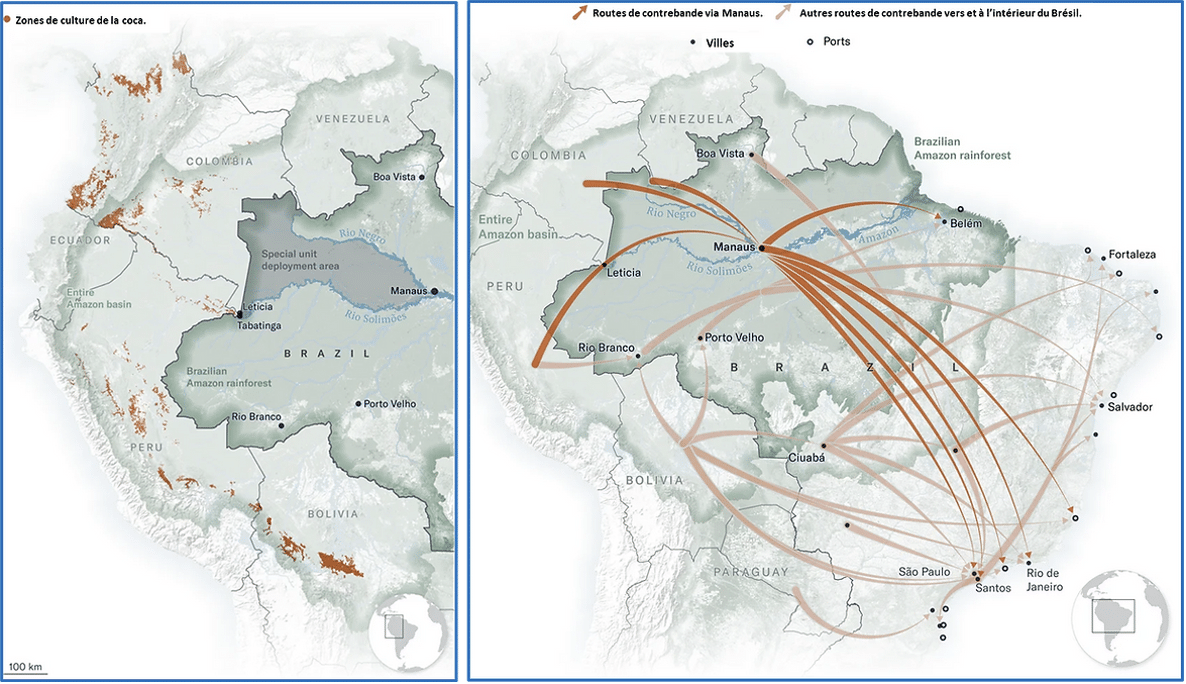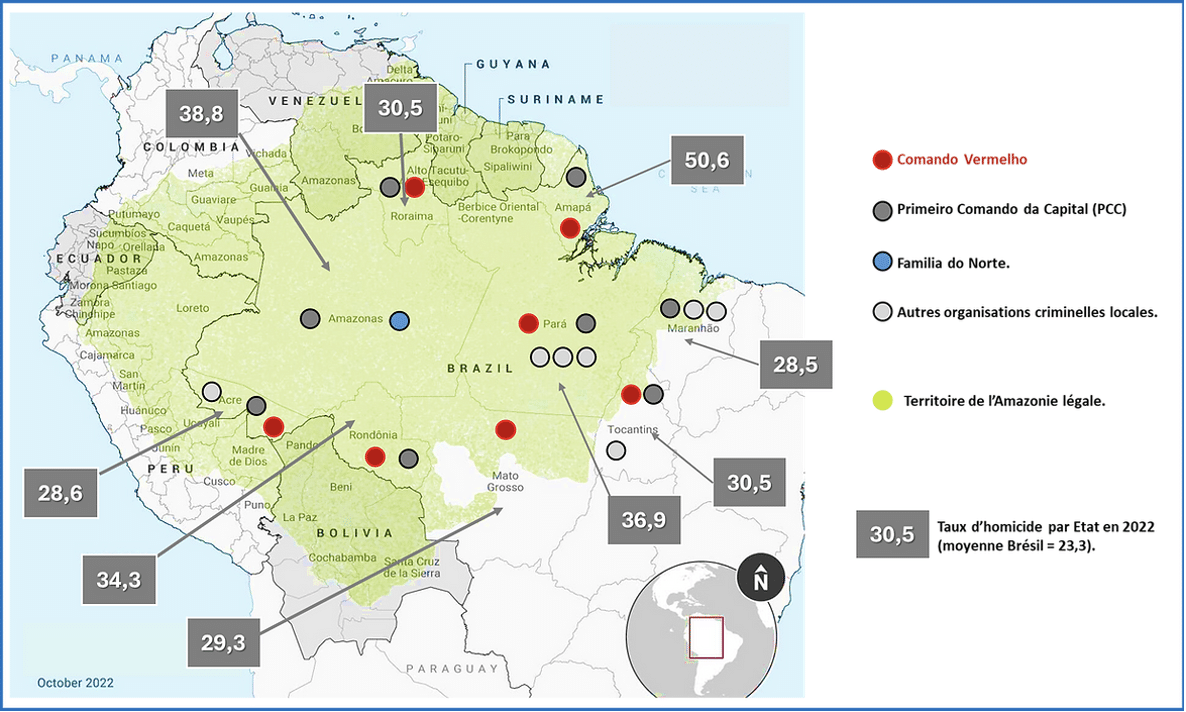Domaine des représentations, des symboles, des rapports de force et des occupations de l’espace, le sport s’inscrit dans la réflexion géopolitique. Il est aussi l’expression d’une forme de la puissance et un moyen de communication politique. Entretien avec Jean-Baptiste Guégan sur cette géopolitique du sport.
Jean-Baptiste Guégan & Lukas Aubin, Géopolitique du sport, La Découverte, 2024.
Jean-Baptiste Guégan & Lukas Aubin, La guerre du sport, une nouvelle géopolitique, Tallandier, 2024.
Propos recueillis par Côme du Cluzel.
Qu’est-ce qui fait du sport un objet d’étude géopolitique ?
Si l’on considère que la géopolitique, c’est l’étude des relations de puissance, des rapports de force et des tensions sur un territoire que se partagent et se représentent différents acteurs, il n’y a rien de mieux que le sport pour la comprendre. Le sport permet de comprendre la géopolitique au sens large d’Yves Lacoste. En effet, qu’est-ce qui permet aujourd’hui à une population de se sentir concernée en tant que nation ? Le sport constitue une de ces occasions. Les sportifs et leurs supporters vont arborer leurs symboles nationaux via le sport. On va les entendre via le sport, ils vont littéralement donner un corps à la nation. Le seul autre exemple, c’est l’armée et le rapport au conflit.
Pour comprendre les relations internationales et la géopolitique, le sport est un excellent moyen de vulgarisation. Il permet de saisir tous les acteurs de la scène internationale et de les voir agir les uns avec les autres à toutes les échelles, dans leur diversité. Il permet aussi de considérer les actions et interactions de ces acteurs sur les territoires. S’ajoute à cela la question de la puissance, parce que s’il y a bien un endroit où on mesure la puissance et le rapport de force entre acteurs, c’est bien par le sport, que ce soit via les classements des médailles, les podiums obtenus, les trophées remportés et la mise en scène qu’en font les États et les pouvoirs en place, etc.
Ce que le sport permet de saisir aussi, c’est l’idée de représentation, l’une des notions centrales de l’approche géopolitique. Prenons l’exemple du Parc des Princes. Si vous êtes supporter du PSG, et notamment si vous êtes un supporter ultra, vous ne laissez pas entrer quelqu’un avec un autre maillot que celui du PSG. A fortiori, si vous êtes à Auteuil et membre du collectif Ultra Paris, “Ici c’est Paris” et rien d’autre. Pour les supporters les plus engagés, le virage leur appartient symboliquement alors que le stade n’appartient même pas au club. Il appartient à la mairie de Paris. Nous sommes au cœur de l’idée de représentation. Ici, c’est mon territoire, un espace approprié comme le définissent les géographes.
Cette représentation se retrouve dans tous les sports. Et ça se voit aussi à travers des phrases de sportifs. Le basketteur qui, par exemple, sous son panier, claque un contre sur celui qui veut lui dunker sur la tête, il va le regarder et il va lui faire « pas chez moi, pas ici ». À l’inverse, toujours en prenant l’exemple de la NBA, Boston, l’équipe qui vient de gagner les NBA Finals, c’est plus qu’une équipe. On parle de Celtics Nation comme on parle de Lakers Nation. On est sur la construction d’un groupe qui partage une culture, une histoire et une langue commune et qui s’approprie symboliquement une ville et son enceinte de basket qu’elle investit de représentations spécifiques avec sa langue, ses expressions, ses vedettes, etc. Le sport permet ici de comprendre l’ancrage territorial et l’appropriation des espaces pour ces tribus sportives, ces clans de supporters. À une autre échelle, c’est aussi par le sport que l’on connaît le mieux l’essence des nations. Et les Jeux olympiques s’inscrivent aussi dans ce phénomène d’identification.
Prenons l’exemple du Golfe arabo-persique. Quand on voit le Qatar, ses relations avec l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, on comprend très vite que le sport leur permet de se confronter les uns aux autres. En même temps, il leur permet de parler à leur peuple et au monde. Aujourd’hui, si vous êtes un dirigeant, passer par le sport, c’est le meilleur moyen de toucher l’ensemble du globe. Il a une capacité de diffusion massive.
Ce qui vaut pour le Qatar et ses dirigeants vaut aussi pour Emmanuel Macron avec Kylian Mbappé (ou du moins ça valait lors de son premier mandat). Et ça le vaudra encore si on a des performances françaises d’exception avec les Jeux. La volonté d’appropriation politique de l’olympiade par des acteurs politiques comme Valérie Pécresse, Anne Hidalgo ou Emmanuel Macron s’inscrivent dans cette dynamique politique et géopolitique.
Dans votre plus récent ouvrage, vous parlez du terme de sport power. Est-ce finalement une sorte de soft power fondée sur le sport?
Beaucoup considèrent que le sport permet surtout de faire de l’image, de travailler le rayonnement, l’attractivité d’un pays ou d’une puissance. Certes, il y a une part de vérité, mais pas seulement.
Aujourd’hui, quand on regarde les régimes autoritaires et même certaines démocraties avancées, le sport, c’est de la puissance, point. C’est aussi du hard power, c’est-à-dire que c’est un marqueur de votre puissance économique. C’est un moyen de montrer que vous avez su tirer profit de votre démographie et de votre territoire, parce que pour avoir des sportifs, il faut être capable de former et transformer en sportif cette démographie, tout en tirant profit des conditions bioclimatiques à votre disposition.
La France et les États-Unis sont deux pays qui le font très bien, et on voit cela au vu de leur réussite dans l’olympisme que ce soit en termes de médailles obtenues ou d’éditions organisées. À l’inverse, aucun État africain n’a encore organisé les Jeux olympiques d’été et ils sont très peu à avoir une capacité à bien figurer dans les sports d’hiver à cause justement de domaines bioclimatiques trop limités, de moyens insuffisants et d’une gouvernance qui ne le permet ni le favorise.
Dans tous les autres domaines de la puissance, le sport est directement associé au militaire. Quand Pierre de Coubertin relance les Jeux, il le fait d’abord pour préparer des athlètes pour la revanche de 1870. Et puis pour organiser des événements sportifs, que ce soit la Coupe du Monde, l’Euro ou je ne sais quoi, il faut avoir une vraie capacité diplomatique. Il faut faire partie d’un cénacle restreint et comprendre comment fonctionnent la diplomatie, les relations internationales, leurs usages et le rapport aux autres États pour faire valoir ses intérêts. Dans ces cas-là, on est aussi dans de la puissance dure. On est sur ce que l’on appelle la puissance du sport, le sport power.
Le sport power, finalement, ça va plus loin que la seule limitation à l’attractivité, l’influence ou la maîtrise du calendrier international. On passe vraiment un cap au-dessus. C’est aussi pour ça qu’aujourd’hui, tout le monde essaie de pratiquer du sport. Ce n’est pas anodin si l’Arabie Saoudite, par exemple, déverse aujourd’hui des milliards sur le sport et l’e-sport.
À l’heure de la professionnalisation du sport, comment a évolué la géopolitique du sport ?
La géopolitique du sport, au départ, c’était l’apanage des États et éventuellement de certains acteurs individuels. Je pense par exemple à Tommie Smith en 1968, qui utilise sa victoire au jeu lors des Jeux de Mexico pour faire passer un message politique revenant sur la ségrégation raciale aux États-Unis.
On avait des stratégies d’État. C’est l’URSS qui revient, par exemple, lors des Jeux d’Helsinki en 1952. C’est l’Allemagne nazie ou l’Italie fasciste qui s’investissent dans les Jeux pour montrer la supériorité de leur modèle idéologique.
Aujourd’hui, on a des acteurs différents et d’une autre nature. On a des ONG qui vont se servir du sport pour se faire entendre. Parfois, pour de bonnes raisons, c’est par exemple tout ce qui est associations comme Play International ou tout ce qui tourne autour du Peace Forum, le forum pour la paix.
Et puis, il y a d’autres acteurs qui, eux, sont là pour utiliser la puissance médiatique et mobilisatrice du sport pour porter une critique sociale, voire politique. Des ONG comme Amnesty International ou Carbon Market Watch vont se servir du sport pour montrer d’abord son absence de soutenabilité, mais aussi aller porter l’attention sur d’autres dimensions. On l’a vu avec Qatar 2022, avec la mise en avant de la question des migrants, la question des minorités, la question des droits des femmes, etc. Donc aujourd’hui, il y a de nouveaux acteurs, les ONG, mais il y a aussi les entreprises. Nike est une des 500 premières entreprises mondiales et cela dit quelque chose du poids actuel du sport, soit 2% du PIB global. La valorisation des clubs de sport l’atteste. Les chiffres sont affolants. Les Dallas Cowboys (football américain, NDLR), c’est plus de 8 milliards d’euros. Le PSG, aujourd’hui, est évalué à plus de 4 milliards d’euros.
Parmi les nouveaux acteurs du sport, des groupes financiarisés plus ou moins liés à des intérêts d’État se distinguent comme le City Football Group (CFG), le groupe qui rassemble une dizaine de clubs sous sa holding comme Manchester City, Yokohama Marinos, Palerme ou New York City Football Club. Aujourd’hui, ces organisations comme le CFG sont structurées comme des firmes transnationales. Elles optimisent leurs profits et sont capables de faire pression sur les organisateurs d’événements ou d’utiliser le sport pour faire de l’entrisme. On a vu, par exemple, Manchester City aller dans le sens de la Super League et se servir du sport pour faciliter les intérêts émiratis en Angleterre. Et on a vu le même club de Manchester City remettre en cause les règles de la Premier League (championnat de foot en Angleterre, NDLR).
Un dernier type d’acteurs surgit. Ce sont tous les États, des régimes autoritaires jusqu’aux démocraties, qui utilisent le sport de manière structurée. Et on voit notamment les nouveaux entrants, je pense, par exemple, aux États du Golfe, mais pas qu’eux. Je pense à l’Inde aussi. Montrer leur émergence géopolitique, ou au contraire, affirmer le sud global ou leur volonté de puissance par le sport. Narendra Modi avec la candidature de l’Inde pour les Jeux de 2036 ne fait rien d’autre. Le Qatar, évidemment, est devenu avec l’Arabie Saoudite, les parangons de cette stratégie. Mais c’est aussi le Rwanda parmi d’autres qui essaie d’exister à l’échelle de l’Afrique subsaharienne par le sport.
Ce qu’on voit, c’est qu’à ces acteurs-là s’ajoutent deux autres types d’acteurs, les sponsors et les diffuseurs. Tous ceux qui exercent une influence géopolitique en sponsorisant le sport et en le diffusant sont des acteurs qui n’existaient pas avant. C’est le cas de Qatar Airways ou des marques liées à des États qui sponsorisent le cyclisme, le football ou les matchs de certaines compétitions.
Sur la dernière décennie, on a vraiment considéré le sport d’un point de vue politique. Et pourtant, tout le monde n’est pas d’accord. Aujourd’hui, tout le monde ne comprend pas encore à quoi le sport peut servir. Mais ça progresse. Les dirigeants sont obligés d’ouvrir les yeux, ils comprennent leurs intérêts à le considérer autrement. Beaucoup d’universitaires ont ouvert les yeux. Je pense qu’un État moderne, ouvert sur le monde et conscient des enjeux, ayant la volonté de peser dans les affaires internationales, ne peut plus faire l’impasse sur une politique sportive structurée autour d’une stratégie clairement définie. La géopolitique du sport est devenue une dimension importante.
Quels sont les arguments des sceptiques de cette géopolitique du sport ?
Souvent, le premier contre-argument opposé à la géopolitique du sport, c’est que c’est que du sport, justement. Socialement, le sport est moins légitime que les arts et la culture au sens noble du terme. Souvent, les gens qui la critiquent sont des gens qui ignorent le sport, n’en ont pas fait ou n’ont pas un rapport intime au sport. Ils n’en comprennent simplement pas le fonctionnement et la portée.
Quand ils le connaissent, il y a aussi un biais socioculturel. Ce n’est pas assez bien pour qu’on le considère, car cela reste associé au corps. Par exemple, on a des gens très bien qui ont écrit des histoires du monde qui sont magnifiques et dans lesquelles il n’y a rien sur le sport, pourtant un phénomène structurant du XXe siècle.
De manière générale, ils n’ont simplement pas conscientisé, par exemple, le fait que le sport a une réalité géographique. Le sport, ce sont des stades, mais pas uniquement. Le sport, ce sont des migrations, des sociologies particulières, des réseaux de sociabilité et de clubs, mais ce sont aussi des réseaux politiques d’influence et de cooptation. Or, cela, pour le comprendre, il faut l’avoir vécu, il faut l’avoir étudié. Et souvent, c’est lié. Mais ça change.
Le sport revêt une dimension géopolitique et ça a été très compliqué pour certains de l’admettre.
Il y a encore un déficit générationnel. La génération qui a commencé à vraiment comprendre ce que ça implique, c’est celle qui aujourd’hui a une quarantaine d’années. La génération qui a moins de 30 ans, aujourd’hui, elle a vraiment intériorisé la question sportive. Elle a grandi avec cette dimension politique et géopolitique. L’exemple le plus simple de ça, c’est de voir, par exemple, sur les deux mandats de Macron, la place qu’occupe le sport dans la mise en scène du pouvoir, dans l’usage géopolitique qu’on peut en faire, notamment avec le Qatar, mais pas seulement.
Et ce sont des choses que n’aurait pas faites Jacques Chirac, par exemple. Ce sont des choses que François Hollande n’avait pas forcément conceptualisées. Parce que ce sont des gens qui partaient d’une autre réalité qui valorisait encore le cinéma et les arts majeurs comme des instruments prédominants en termes d’influence. Or, aujourd’hui, ce n’est plus vrai.
La Coupe du Monde, c’est la moitié de l’humanité qui est touchée. Les Jeux, c’est plus de 3 milliards et demi de personnes. Ça n’a pas le même effet qu’un festival tel que le Festival de Cannes. Il n’y a pas de comparaison : le seul moment où vous allez rassembler tout le monde, c’est par le sport.
C’est sûr que les plus grosses audiences jamais comptabilisées sont quand même des événements sportifs. Il y a un exemple qui est sidérant. Ce sont les finales de NBA gagnées par les Toronto Raptors en 2019. Plus de la moitié du Canada regarde ces matchs. Le festival de Toronto, pourtant l’un des plus respectés d’Amérique du Nord, n’a pas une telle audience.
Dans votre livre, vous parlez de victoire sportive comme marqueur d’une certaine forme de mesure de la puissance d’un État. Or, comment une réussite sportive peut-elle en arriver là ? Parce qu’on peut penser à plusieurs contre-exemples. Par exemple, la Nouvelle-Zélande ou l’Afrique du Sud qui se partagent toutes les Coupes du monde de rugby. Ou encore le parcours héroïque du Maroc en Coupe du Monde de foot en 2022. Ce sont des pays qui, malgré leur réussite, n’ont pas forcément gagné une place importante sur l’échiquier géopolitique mondial.
Oui, c’est intéressant parce que là, on est sur un discours qui est déjà très sophistiqué. C’est-à-dire que c’est celui qui consiste à opposer la réalité et l’image qu’on en a.
C’est-à-dire que la réalité, c’est qu’aujourd’hui, le Maroc ne peut pas jouer dans la cour des grands à l’échelle mondiale. En revanche, il peut tenter à l’échelle régionale et à l’échelle continentale de peser. Et il a compris une chose. Ce qui compte, ce n’est pas forcément la seule puissance économique ou la puissance militaire. Aujourd’hui, le Maroc n’a pas la capacité de peser en étant parmi les premiers mondiaux. Cependant, il y a quelque chose qui vaut tout le reste : c’est l’image. Aujourd’hui, ce qui compte, c’est la puissance de l’imaginaire. C’est tout ce qui a fait la force, par exemple, du premier mandat d’Emmanuel Macron.
L’image prédomine et s’impose même si à un moment donné, la réalité vient remettre en cause ce que vous avez déclaré. Aujourd’hui, ce qu’on voit, c’est la capacité du sport à être un levier politique d’influence.
On le voit avec la France à l’occasion des Jeux de Paris 2024, pour être considérée comme un acteur capable de peser, elle doit montrer sa capacité à respecter ses engagements diplomatiques, mais aussi être capable d’accueillir le monde. En le faisant par le sport, elle montre qu’elle s’inscrit dans le rang des quelques puissances capables de le faire dans des conditions qui correspondent aux standards internationaux les plus élevés. Tout en assumant le risque de l’échec devant le monde entier, elle montre qu’elle demeure innovante, attractive et potentiellement encore capable d’exister à l’échelle européenne et mondiale.
Ce qu’on voit avec le sport aujourd’hui, c’est la capacité de mise en scène du pouvoir et de la puissance. Et je distingue volontairement les deux. Quand vous êtes aux États-Unis, c’est simple, la puissance sportive, vous l’avez, parce que vous avez été le premier acteur à vous positionner dessus. Mais quand vous regardez l’Inde qui demain, rien qu’en termes de démographie, en termes de capacité scientifique et en termes de capacité d’investissement, est passée devant l’économie française. Mais tout le monde ne l’a pas encore saisi.
Avec 1,3 milliard de personnes, le sport indien se résume au cricket et au yoga. Malgré la caricature volontaire, on voit qu’aujourd’hui, dans la palette de la puissance, que la capacité à montrer et à se montrer importe pour se légitimer à une autre échelle.
Si la Russie, sur la décennie 2010-2020, était le premier État à organiser autant d’événements internationaux, ce n’est pas simplement parce que Vladimir Poutine était un acteur qui, finalement, aime le sport. C’est qu’il en avait compris la puissance politique et géopolitique.
Aujourd’hui, à l’heure des réseaux sociaux et de l’hyperconnexion du monde, l’idée, c’est de toucher le cœur des hommes et leur esprit. Et le sport a cette vertu, il est capable de toucher les deux. Aucun autre domaine d’activité ne le permet en dehors de la guerre et ce n’est pas pour rien que les tensions du monde s’y retrouvent et s’y attisent.
Le sport a cette capacité à montrer et à construire d’autres représentations. La France, par exemple, va être ciblée, notamment par la Russie ou l’Azerbaïdjan parce qu’elle est capable d’organiser le sport et de peser dans sa gouvernance. Parce qu’elle va aligner sa capacité de puissance moyenne et montrer qu’elle est encore capable de peser dans le jeu, les Jeux de Paris vont être visés par la désinformation et des actions d’ingérence.
Ce sont des choses qu’on ne voyait pas auparavant. Les États-Unis comprennent depuis longtemps la puissance géopolitique du sport. Sur la décennie qui vient, ils vont accueillir successivement la Coupe du monde de foot, les Jeux olympiques et probablement candidater pour accueillir une nouvelle édition des Jeux olympiques d’hiver sans compter les deux Coupes du monde de rugby, féminine et masculine, qu’ils vont organiser.
Ajoutez à cela les ligues professionnelles privées, et vous avez un modèle qui fonctionne et qui sert la politique américaine et montre la puissance du pays. Les États-Unis seront probablement l’un des deux premiers vainqueurs des Jeux de Paris, probablement même le premier pourvoyeur de médailles. Le sport sera un assez bon étalon de ce qu’est la puissance et des rapports de force globaux, mais aussi des divisions à l’œuvre à l’échelle française par exemple.
Aujourd’hui, les Jeux olympiques étant organisés à Paris, la population semble souffrir de l’organisation de cet événement. Est-ce qu’aujourd’hui, on peut parler d’une déconnexion entre le sport et le peuple ?
Alors tout d’abord, le peuple est une notion politiquement marquée et la population de Paris, ce n’est pas le peuple de France. Ce qu’on voit, c’est que si on utilise des termes plus académiques, il y a des externalités négatives réelles. Elles soulignent à quel point les Jeux olympiques peuvent être un facteur de perturbation et de dérangement des populations locales, notamment celles qui accueillent.
Ce qu’on voit, c’est que depuis à peu près une quarantaine d’années, dès qu’on a de grandes compétitions internationales, d’abord, les locaux s’en vont, en partie, parce qu’ils n’ont pas envie d’être dérangés. Quant aux touristes qui voulaient venir à cette période-là, souvent, en raison des coûts pratiqués, ils ne viennent pas forcément. On voit alors d’autres types de touristes arriver. Les événements sportifs n’ont pas que des atouts à proposer, ils portent en eux au regard de leur importance, de ce qu’ils mobilisent une capacité à déstabiliser aussi les lieux qui les accueillent. Mais il n’y a pas que du négatif, bien au contraire.
Les événements sportifs ont une capacité à construire des images des lieux, ce qu’on appelle du city branding, la capacité à créer des images de marque locales et des représentations qui s’ancrent durablement dans les têtes. Ce qui représente un vrai avantage à l’heure des réseaux sociaux et de la concurrence globale.
Prenons Londres, avant 2012, donc avant les Jeux, c’était quand même l’image d’une Angleterre un peu dépassée, assise sur la famille royale. Et les JO se passent extrêmement bien. Des images de Londres sous le soleil sont loin de celles d’une capitale restée dans les 80s. Et cela s’accompagne de retombées. Pendant trois ans, Londres est devenue la ville la plus visitée au monde, ravissant à Paris le titre de première capitale touristique mondiale.
Je prends un autre exemple, la Russie et sa Coupe du Monde, en 2018. Sur la Coupe du Monde, la grande volonté de Poutine, c’était de renouveler les représentations de la Russie et de sortir des images qu’on avait de la Russie de la décennie 1990-2000, avec ces images d’insécurité, de magasins vides. Autant de stéréotypes qui ont marqué les représentations des gens. L’opération de relations publiques permise par la Coupe du monde a permis à la Russie de changer son image en affichant celles d’un pays sûr où les gens sourient et d’un État capable d’organiser un événement global avec un niveau de sécurité extrêmement élevé.
L’exemple du Qatar va dans le même sens. En 2022, il a accueilli la coupe du monde de football. 20 ans avant, personne ne savait ce qu’était le Qatar et n’avait de représentation de Doha. Le sport permet de se positionner et d’exister. Tout le monde sait à quoi ressemble Doha aujourd’hui.
Quand la France obtient les Jeux de Paris 2024, tout le monde comprend l’opportunité que cela représente. Mais si on avait demandé directement aux Français, ils n’auraient probablement pas été unanimes. Pourquoi ? Parce que les Français se disent « un tel événement a un coût, cet argent pourrait être mis ailleurs ».
Derrière les Jeux, la réalité est plus complexe. Des événements comme les Jeux peuvent changer les choses et l’image d’un territoire. Après, si on est Parisien, les Jeux, on les subit depuis plusieurs mois en attendant une fête qu’on espère belle. Mais en même temps, des projets liés au Grand Paris ont été mis en œuvre comme le prolongement de la ligne 14 ou du tramway.
Pourtant il y a de moins en moins de villes qui veulent vraiment accueillir les JO, et ce pour des questions principalement de budget ?
C’était vrai en 2017. Ce n’est plus vrai aujourd’hui. Les Jeux d’été sont attribués jusqu’en 2032. Le CIO a été habile. Il a attribué coup sur coup Paris et Los Angeles en laissant les villes se mettre d’accord. Il a sécurisé deux Olympiades et très vite, il a vu le Queensland et l’Australie se positionner. Il a ainsi modernisé et fait évoluer ses règles d’attribution. Aujourd’hui, on entre dans un processus de discussion avec le CIO. Le temps des concours et des promesses est terminé. On n’a plus à subir ce qu’on appelle “la malédiction de l’enchère”, c’est-à-dire cette course qui consiste à proposer de manière très irréaliste le plus beau des projets avec des coûts amoindris au possible.
Cela n’existe plus. Aujourd’hui, on entre en négociation. Et pour 2036, des candidats, il y en a un grand nombre. Il y a l’Indonésie, la Corée du Sud, l’Inde. On subodore la possibilité d’une candidature saoudienne, probablement d’une candidature qatarienne. On imagine qu’il y aura une candidature européenne. Probablement que l’Allemagne va continuer à y réfléchir.
Aujourd’hui, on a plus de candidatures pour les Jeux d’été qu’il y a 7 ans au moment où Paris a été élu pour accueillir les Jeux. Pourquoi ? Parce qu’on a rationalisé le processus. Même si on critique beaucoup trop l’édition parisienne, Paris 2024 va être la première candidature à moins de 10 milliards d’euros depuis 2000. C’est la première candidature où il n’y aura pas de dépassement du budget par rapport à ce qui a été fixé. Et pourtant, il y a eu le Covid, le doublement du poste de sécurité et un nombre de menaces jamais vu sur une Olympiade dans l’histoire sportive. Malgré cela, on est pour l’instant à moins de 9 milliards d’euros. Et tout ce qui a été prévu en termes de construction, malgré le Covid, a été tenu. C’est-à-dire le prolongement de la ligne 14 du métro, le prolongement du tramway jusqu’à Porte Dauphine, la construction du centre aquatique, la construction de l’Adidas Arena. La Solideo a tenu le budget, ce qui mérite d’être noté. Tout cela en tenant le calendrier. Et ça, pour le coup, c’est vraiment un coup de maître. Et je ne suis pourtant pas tendre en général avec les Jeux.
C’est vraiment à mettre au crédit, finalement, de la capacité française à faire face. Et, sauf catastrophe, on peut avoir la chance de mettre en place la plus belle fête des Jeux, et on peut avoir la chance de montrer une image de Paris comme on ne l’a jamais vue. L’été 2024 peut rester dans les têtes comme le bicentenaire de la Révolution. C’est-à-dire une folie qui va éblouir le monde pendant dix ans. Et si ça se passe mal, ces Jeux vont rentrer dans l’histoire pour de mauvaises raisons.
Mais il faut aussi reconnaître une chose, si Paris 2024 est capable de tenir sa promesse, il faut imaginer l’effet « wow » que ça va entraîner. Le déclencheur, ça va être la cérémonie d’ouverture et la semaine qui va précéder. Il ne faut pas qu’il y ait de faits divers, même si déjà le contexte de la dissolution vient rajouter une complication supplémentaire.
Il risque donc d’y avoir des acteurs en interne, que ce soient des partisans des extrêmes ou finalement certaines ONG, qui vont se servir des Jeux pour se faire entendre. Il y a aussi la crainte terroriste ou celle des menaces politiques avec un vrai risque de conflits potentiels, notamment sociaux.
Paris 2024, c’est la somme de toutes les peurs. Mais par définition, le pire n’est jamais certain. Donc, il faut y croire, on va se dire qu’impossible n’est pas français. Et comme d’habitude, c’est toujours quand il a les deux pattes là où il ne le voudrait pas que le coq soit capable de se faire entendre.