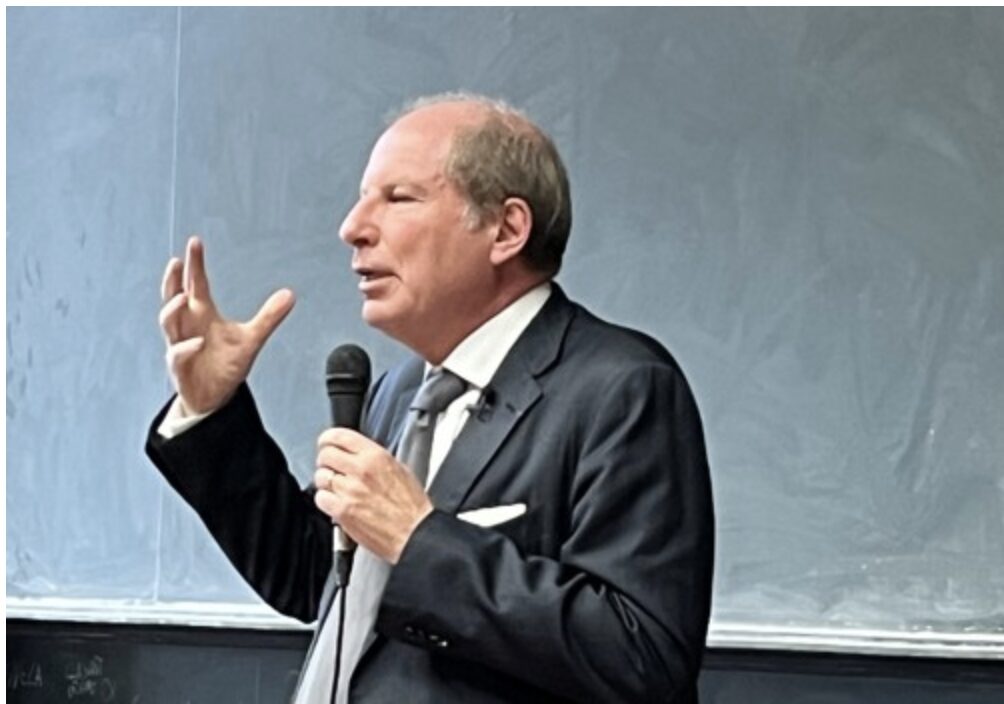L’influence étatsunienne en Amérique du Sud
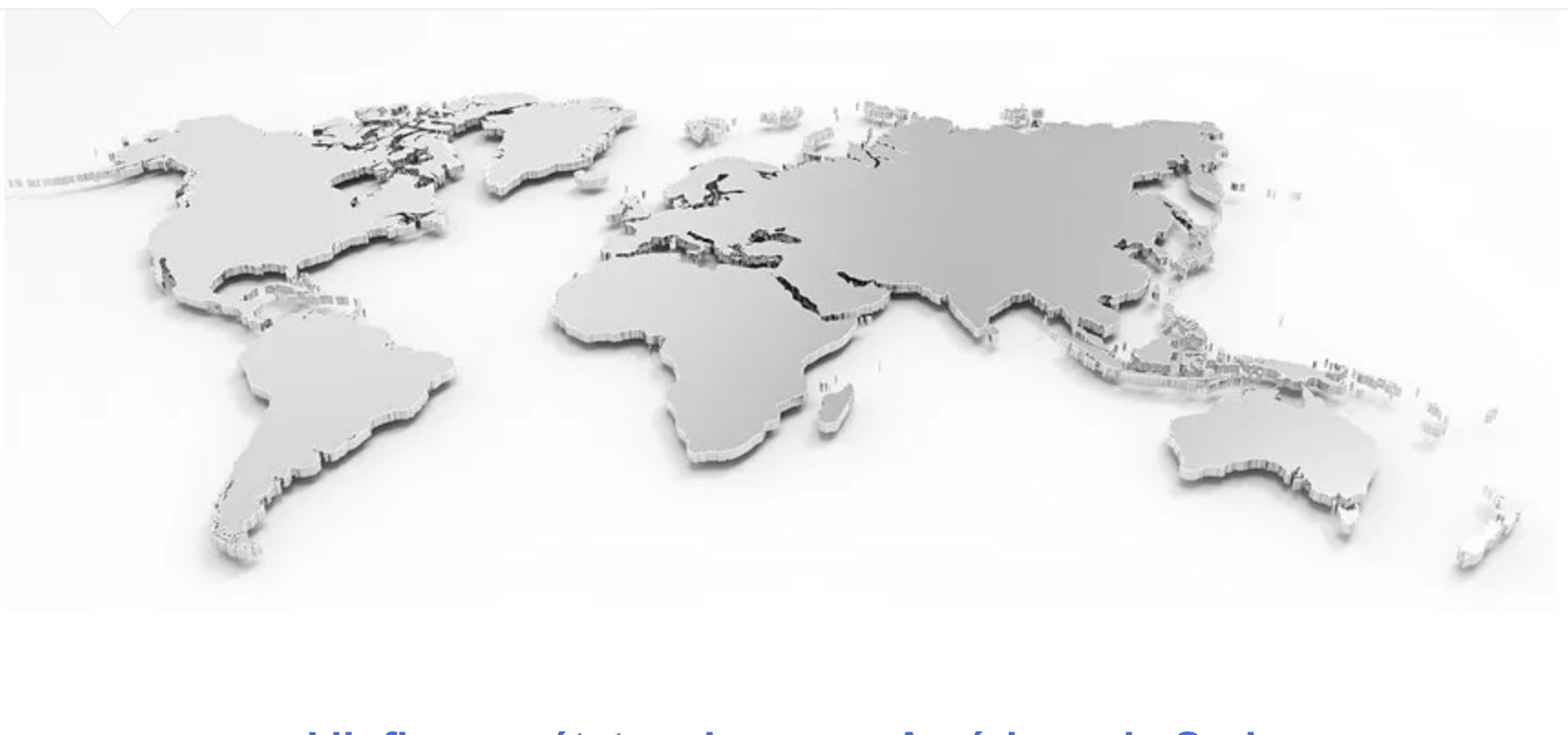
par Athénaïs Jalabert-Doury (*) – Esprit Surcouf – publié le 9 août 2024
Stagiaire chez ESPRITSURCOUF
L’Amérique du Sud a longtemps été considérée comme la « chasse gardée » des États-Unis, tant sur le plan politique qu’économique et culturel. Qu’en est-il désormais ?
Cette influence, consolidée au cours du XIXe siècle avec la doctrine Monroe et accentuée par la politique du « Big Stick » au début du XXe siècle, a continué de se manifester de diverses manières pendant la Guerre froide et même après. Cependant, ces dernières décennies, plusieurs signes indiquent un possible recul de cette domination américaine en Amérique du Sud. La montée en puissance de nouvelles puissances économiques, l’émergence de gouvernements locaux cherchant à s’affranchir de l’influence étasunienne et la diversification des influences culturelles sont autant de facteurs qui suscitent une réflexion sur cette dynamique.
Historique de la présence étatsunienne en Amérique du Sud
Depuis le XIXe siècle, les États-Unis ont toujours été très attentifs à l’Amérique Latine, et cela débute en 1823 avec l’instauration de la « Doctrine Monroe ». Grâce à cette dernière, les États-Unis se déclarent responsables de la protection de l’ensemble du continent américain, ce qui renforce leur force militaire. Au XXe siècle, cette volonté de préserver le continent persiste, mais la menace n’est plus d’Europe, mais émerge de l’Union Soviétique. D’où la réinterprétation de la doctrine Monroe en 1947 pour laisser place à la doctrine Truman.
Cependant, dès les années 1950 la protection des Etats-Unis, est remise en question, voire contestée dans certains pays d’Amérique Latine.
En fait, les pays d’Amérique latine ne demandent aucune protection et certains y voient une tentative tout à fait voilée des États-Unis d’étendre leur contrôle sur l’ensemble du Nouveau Monde. A vrai dire, les États-Unis sont intervenus dans la politique des pays d’Amérique latine. En réaction, cela a conduit certains pays, comme Cuba, à se tourner vers l’URSS : en 1961, les États-Unis ont planifié l’invasion de la Baie des Cochons pour renverser le régime de Fidel Castro. Un an plus tard, en 1962, la crise des fusées de Cuba éclate.

Légende : La Baie des Cochons 1961 – Cuba / Source : Creative Common
Avec la fin de la guerre froide et la consolidation de la démocratie en Amérique latine, les relations avec les États-Unis se sont stabilisées et se trouvent aujourd’hui à un carrefour important. Toutefois, l’influence des États-Unis est contestée à différents niveaux. Les pays d’Amérique latine se développent et de nouvelles puissances telles que le Brésil, l’Argentine et le Mexique émergent. Par conséquent, certains pays remettent en question la prétention des États-Unis au leadership régional.
En outre, un anti-américanisme féroce s’est développé, mené en particulier par Hugo Chávez lorsqu’il était au pouvoir. Chef militaire du Venezuela de 1998 à sa mort en 2013, Chavez a fait une série de déclarations enflammées contre Washington et s’est finalement allié au régime de Castro à Cuba. Cela a conduit à la création de l’ALBA (Ariansa Bolivariana Palos Pueblos de Nuestra America) en 2004 dont l’objectif était d’unir les pays signataires d’Amérique latine dans une alliance anti-américaine. Cependant, seuls 10 pays, dont le Venezuela, le Nicaragua et Cuba, ont choisi de rejoindre l’ALBA. La plupart de autres pays souhaitent assouplir leurs relations avec les Etats-Unis et établir un partenariat avec Washington, notamment sur le plan commercial. C’est pourquoi le Mexique a décidé en 1994 de s’allier aux États-Unis par le biais de l’ALENA et de l’accord Canada-États-Unis-Mexique.
Donald Trump et l’offensive sud-américaine
L’Amérique latine a fait face aux vents de Washington à plusieurs reprises dans son histoire contemporaine : l’agressivité ou simplement l’indifférence et le mépris de la diplomatie nord-américaine, symbolisés par la politique de négligence modérée de Kissinger/Nixon entre 1969 et 1974, ont soudé les peuples latino-américains. Le « latino-américanisme » a, un temps, reflété la volonté d’émancipation politique symbolisée par l’accord de Viña del Mar de 1969.

Dès le lendemain de sa prise de fonction le 20 janvier 2017, Donald Trump passe à l’offensive en lançant directement la construction du mur sur la frontière mexicaine. Il promet que le Mexique en assumera le coût estimé à quinze milliards de dollars. La réaction du président mexicain Peña Nieto est prompte : il annule sa visite à Washington initialement programmée pour le 31 janvier. Soucieux de tenir ses promesses de campagne, Trump fait de la relation avec le Mexique une priorité de son agenda politique.
Le Mexique présente en effet deux caractéristiques qui convergent dans l’esprit des électeurs de Trump : ce pays a largement bénéficié́ des délocalisations industrielles causées par l’ALENA et continue à exercer sur les Etats-Unis une pression migratoire insupportable. Cette double mobilité́, des entreprises vers le sud et des migrants vers le nord, est censée accentuer les pressions à la baisse sur les salaires aux Etats-Unis. La renégociation de l’ALENA et la construction d’un mur doivent permettre aux Etats-Unis de retrouver leur dynamisme économique perdu depuis des décennies, et de compenser les pertes de pouvoir d’achat de la classe ouvrière. De même concernant Cuba, les engagements pris par Trump durant sa campagne n’ont pas non plus été suivis d’effets tangibles en 2017. Le 16 juin, dans un discours prononcé à Miami devant les opposants historiques au régime castriste, Trump a remis en cause l’ensemble de la politique de son prédécesseur. Dans la foulée, il a limité les possibilités de voyager dans l’ile et interdit aux entreprises américaines de faire des affaires avec des partenaires liés à l’armée (très présente dans le secteur du tourisme). Même si ces décisions risquent de freiner sérieusement le boom du tourisme en provenance des Etats-Unis qu’avait enregistré Cuba en 2016, Trump ne revient pas sur le rétablissement des relations diplomatiques ni sur la politique migratoire, et ne retourne pas non plus à l’époque des sanctions économiques sévères. La coopération dans le domaine de la lutte contre le narcotrafic est quant à elle préservée. Face à cette situation, le président Trump a tergiversé et multiplié les maladresses et ces prises de position ont été critiquées dans toute l’Amérique latine. Ses errements ont contrasté avec la détermination de l’Organisation des États Américains (OEA), mais des limites à son action sont vite apparues. Rien que durant la crise politique et les soulèvements au Venezuela, les Etats-Unis sont restés discrets sur la situation mais ont souvent accusé par le gouvernement vénézuélien de s’ingérer dans ses affaires intérieures. Washington est resté silencieux à l’exception de la déclaration en 2017 qui suggérait de nombreuses options pour le Venezuela, y compris « des options militaires si nécessaire ».

Alors que la volonté des États sud-américains était de développer le libre-échange, Trump s’est tourné vers le
protectionnisme. Quand l’ancien président argentin Mauricio Macri s’était rendu en visite officielle au Brésil, le Mercosur a alors été rétabli. Même le Mexique a été invité à se rapprocher du Mercosur en vue d’annuler l’ALENA. De plus, le secrétaire général de l’Association latino-américaine d’intégration (ARADI) avait proposé un accord économique et commercial global intégrant tous les accords existants, y compris le Système d’intégration centraméricain (SICA). Les déclarations des dirigeants qui s’ensuivirent avaient une portée antiprotectionniste, visant à positionner l’Amérique du Sud contre le président Trump. Cette intense activité diplomatique est le produit de l’isolement des États-Unis sous la présidence Trump et de l’absence de leadership du Brésil, libérant les puissances moyennes (notamment le Mexique et l’Argentine). Elle reflète également le changement politique en Amérique du Sud, qui envisage à nouveau le développement du libre-échange dans la région.
La volonté multilatéraliste de Joe Biden mis à mal par des difficultés d’intégration régionales et des changements socio-économiques fluctuants
Lorsque Joe Biden est arrivé au pouvoir en janvier 2021, de par son expérience en tant qu’ancien président de la commission des affaires étrangères du Sénat (1997-2008) et envoyé permanent du vice-président Barack Obama en Amérique latine (2008-2016), il était jugé comme un fin connaisseur de l’Amérique latine. La « pression maximale » sur Cuba et le Venezuela (et accessoirement le Nicaragua) dans le but d’un changement de régime dans ces pays « socialistes » dont ils font partie, après quatre années de mandat de Donald Trump caractérisées par une indifférence stratégique à l’égard des pays latino-américains, une pression commerciale et une émigration ponctuelle ou constante (Argentine, Brésil, Mexique et les pays du ” Triangle du Nord “) et, selon les termes de l’ancien secrétaire d’État, John Bolton, une « troïka de despotes ».
Le Mexique, l’Amérique centrale et les Caraïbes constituent le cœur de la feuille de route latino-américaine élaborée par Joe Biden et son administration. Cette région du sous-continent est le bénéficiaire le plus direct de l’influence économique et géopolitique traditionnelle des États-Unis. Pour Joe Biden, cette approche est un plan et un moyen de restaurer l’hégémonie américaine. Dans ce contexte, Joe Biden envisage une nouvelle relation avec l’Amérique centrale et les Caraïbes basée sur la résolution conjointe de problèmes directement liés aux priorités locales. Les questions migratoires sont donc un axe central de son projet pour la sous-région.
Conformément à la promesse de Joe Biden de remporter près des deux tiers du vote latino lors des élections du 3 novembre 2020, le nouveau président américain a soumis au Congrès, dès le premier jour de son mandat, un nouveau projet de loi, l’American Citizenship Act of 2021, visant à « moderniser le système d’immigration américain ». En rupture radicale et spectaculaire avec les politiques de son prédécesseur, et notamment celles prônées par le camp républicain et de nombreux sympathisants des puissants mouvements Alt-Right et suprémacistes blancs, cette loi prévoit une nouvelle « voie d’accès à la citoyenneté » ou, à terme, au droit de vote pour les quelque 11 millions d’immigrés clandestins (principalement des Centraméricains comme le Salvador, le Guatemala et le Honduras, des Mexicains et des Caribéens comme Haïti) qui vivent et travaillent aux États-Unis (notamment dans les secteurs de l’agriculture, des travaux publics, des services et de la restauration).
Ces derniers mois encore, l’administration Biden s’est appuyée sur des accords avec le Mexique pour augmenter le nombre de demandes d’asile et de nouvelles restrictions sur le passage des frontières, alors que le président Trump avait cherché à bloquer toute entrée.
Mais la question reste complexe et doit faire face à la propagande médiatique qui s’empare du sujet à chaque élection. Tous les chercheurs, les organisations professionnelles et quatre administrations successives ont appelé le Congrès à adopter une loi. Cependant, le Congrès n’a pas réussi à agir sur cette question en raison de la polarisation politique et de la transformation du Parti républicain par le président Trump.
De plus, cette administration avait confirmé le lancement du « Plan Biden pour construire la sécurité et la prospérité en partenariat avec les peuples d’Amérique centrale ». Ce « Plan Biden » était l’une des pierres angulaires de la stratégie latino-américaine du nouveau président lors de la campagne électorale. Dans la tradition de la diplomatie de Washington, le plan affirme que « l’hémisphère occidental, ou en d’autres termes l’ensemble du continent américain, de la pointe nord du Canada à la pointe sud du Chili, a le potentiel d’être sûr, démocratique et prospère ».
Poursuivant la logique de l’Alliance pour le progrès de 2014, abolie par Donald Trump, le plan prévoit l’allocation de 4 milliards de dollars américains8 sur quatre ans à trois pays du « Triangle du Nord », où a lieu la majeure partie de la migration de la région vers les États-Unis. Conçu pour réduire les migrations en provenance du Salvador, du Guatemala et du Honduras de manière « efficace et durable », le « plan Biden » prétend s’attaquer aux problèmes « sous-jacents » de ces phénomènes : la pauvreté, la violence, le crime organisé, la corruption, le dysfonctionnement des institutions publiques et le changement climatique. Son objectif est de proposer une « stratégie globale » qui permettra à terme à ces pays de se transformer en sociétés de « classe moyenne ». Dans cette optique, le « Plan Biden » organise la mobilisation des fonds américains, l’implication des différentes administrations et agences gouvernementales impliquées sur le terrain, ainsi que la participation du secteur privé américain et des bailleurs de fonds internationaux. En contrepartie, les pays bénéficiaires doivent s’engager à mettre en œuvre, promouvoir et cofinancer les réformes identifiées et exigées par Washington et ses partenaires pour lutter contre la corruption, la pauvreté, le crime organisé et la violence en développant leurs propres ressources (réforme fiscale) ; également en termes de gouvernance d’entreprise et d’attractivité économique pour faciliter l’afflux d’investissements étrangers. Sur ce dernier point, le Président a inclus cet objectif dans la promotion de la « transition vers une énergie propre, l’adaptation au changement climatique et la résilience ».
La politique latino-américaine de Joe Biden rencontre des difficultés en Amérique latine, en particulier dans le cône sud, en raison du recul des processus d’intégration régionale et de l’absence de leadership politique régional. Les dynamiques de coopération ont eu du mal à voir le jour à cause des divisions géopolitiques du fait des choix économiques, commerciaux, sanitaires, sécuritaires et climatiques faits. C’est dans ce contexte général que Joe Biden a pris position sur deux dossiers sensibles : Cuba et le Venezuela. Ces deux pays ont exprimé le souhait de réfléchir à l’ère Trump et d’avoir un dialogue ouvert.
En ce qui concerne le Venezuela, le nouveau gouvernement, par l’intermédiaire de son nouveau secrétaire d’État Antony Blinken, a clairement indiqué qu’il considérait Nicolás Maduro comme un « dictateur brutal » et que, contrairement à l’Union européenne, il continuerait à reconnaître Juan Guaido comme président intérimaire du Venezuela jusqu’à la tenue d’élections « libres et équitables ». Tant que cet objectif n’est pas atteint, le nouveau gouvernement pourrait modifier sensiblement son approche du Venezuela. Il mettra l’accent non plus sur l’intervention politique directe (comme il l’a fait sous Donald Trump) mais sur l’action humanitaire et permettra aux Vénézuéliens qui se trouvent aux États-Unis en tant qu’immigrés clandestins de bénéficier des nouvelles dispositions du gouvernement en matière d’asile. Les dirigeants vénézuéliens ne sont pas des activistes économiques.
Quant à Cuba, l’ancien secrétaire d’État, Mike Pompeo, a réintégré à la dernière minute le 11 janvier 2021 sur la liste des « États soutenant le terrorisme » (retiré de la liste par le président Barack Obama en 2015), après quatre années de renforcement constant des mesures restrictives unilatérales, y compris extraterritoriales. L’administration Biden, quant à elle, est prête à avancer avec prudence car Joe Biden est revenu à la doctrine Obama de normalisation des relations avec Cuba et a annoncé son intention de lever certaines restrictions imposées par son prédécesseur Donald Trump sur les voyages à Cuba des Américains et sur les envois de fonds à la famille restée au pays par les Cubains vivant aux États-Unis. Toutefois, des partisans d’un changement de régime à Cuba se trouvent aussi bien dans le camp démocrate que dans le camp républicain du président.
Une moindre présence en Amérique latine : de l’interventionnisme intense à l’influence
Les États-Unis continuent de jouer un rôle-clé en Amérique latine à travers la diplomatie et la sécurité : la visite du Secrétaire d’État américain Antony Blinken, en décembre 2023, en Colombie et au Chili illustre cet engagement. En Colombie, Blinken a rencontré le nouveau président de gauche, Gustavo Petro, pour établir un cadre de collaboration sur la sécurité, notamment en ce qui concerne la « paix totale » et la lutte contre le narcotrafic. Cette rencontre vise à harmoniser les objectifs américains avec les priorités locales sous la nouvelle administration. Sur le plan économique, les États-Unis cherchent à renforcer leur influence par le biais de l’Alliance pour la prospérité économique des Amériques, lancée par Joe Biden dès 2022. Cette initiative vise à contrer l’influence croissante de la Chine dans la région et à réduire l’émigration vers les États-Unis en favorisant l’intégration économique régionale. Une stratégie de « nearshoring » est également promue, encourageant la relocalisation de centres de production en Amérique latine, notamment au Mexique, pour diminuer la dépendance envers l’Asie. Les États-Unis maintiennent aussi des relations commerciales solides avec des pays comme la Colombie et le Chili : la Colombie, par exemple, exporte une part importante de ses produits vers les États-Unis, qui restent un partenaire commercial majeur.

Les relations entre Washington et le Chili sont importantes surtout avec la montée en puissance du géant asiatique dans le pays andin, et notamment après le retour de Chine du président chilien Gabriel Boric en octobre 2023. L’administration américaine a également rédigé un rapport stratégique indiquant qu’elle souhaite étendre son influence et renforcer ses relations avec le Chili. Mais la complicité des États-Unis dans l’établissement de la dictature de Pinochet dans les années 1970 suscite encore le cynisme chez certains Chiliens et leur méfiance à l’égard de l’agenda américain dans le pays. La crise sociale de 2019 a également donné naissance à une génération d’hommes politiques désireux de changer le modèle hyper-néolibéral du Chili, calqué sur celui des États-Unis, qui crée d’énormes inégalités sociales. Il est vrai que, depuis plusieurs années, le Chili a renforcé son partenariat avec la Chine, notamment au niveau économique. Le géant asiatique est aujourd’hui le premier partenaire commercial du Chili, notamment pour l’exportation de cuivre, la principale ressource du pays. Cependant, les États-Unis conservent toujours une influence non négligeable puisqu’en 20 ans, les exportations du Chili vers les États-Unis ont triplé, notamment grâce à l’accord de libre-échange. Les relations en termes de niveaux académiques, culturels et touristiques sont également très élevées. Pour sa part, le Chili souhaite que ses relations, que ce soit avec les États-Unis ou la Chine, en récoltent le plus grand bénéfice. Le pays a vraiment besoin d’investissements majeurs, notamment dans le secteur énergétique, car il ambitionne de devenir le premier producteur mondial de lithium et mise tout sur l’hydrogène vert. Ce sont ces investissements que Gabriel Boric recherchait en Chine en octobre dernier et désormais aux Etats-Unis avec Joe Biden.
Malgré ces efforts, le leadership américain en Amérique latine montre des signes de déclin. Un exemple marquant est le boycott du Sommet des Amériques par le président mexicain, suite à l’exclusion de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua. À l’origine, les Etats-Unis ont rayé de ce sommet rassemblant tous les pays du continent pour des raisons de violation des principes démocratiques et des droits humains au sein de ces pays. Ce boycott coûte cher aux efforts entrepris par Joe Biden qui souhaitait affirmer, depuis son élection, son leadership régional. Alors que Joe Biden a souhaité concentrer sa politique étrangère dernièrement sur l’Europe avec la guerre en Ukraine et l’Asie, la Chine gagne du terrain et investit massivement en Amérique du Sud. Michael Shifter, chercheur à l’organisme Inter-American Dialogue, souligne notamment que « les Etats-Unis ont encore beaucoup de soft-power, mais leur influence politique et diplomatique décline chaque jour ». Justement, le Président américain avait décidé d’être en rupture avec son prédécesseur Donal Trump et de finalement levé certaines sanctions à l’encontre de Cuba et d’être plus ouvert. Et justement, le Sommet des Amériques venait avancer une nouvelle ambition de Biden pour l’Amérique latine mais certains opposants critiquent que cela « n’est pas la bonne voie ».
En ce sens, la politique américaine de promotion de la démocratie est de plus en plus critiquée. Les États-Unis sont accusés de traiter de manière sélective certains pays, excluant Cuba et le Venezuela tout en maintenant des relations avec des nations comme l’Arabie Saoudite. Cela affaiblit la crédibilité des États-Unis en tant que promoteurs de la démocratie en Amérique latine.
L’influence croissante de nouveaux acteurs dans la région posent problèmes à Washington : la Chine, mais également la Turquie, sans oublier la Russie, notamment au Nicaragua. Les relations avec l’Europe se sont densifiées, mais sont distancées sur le plan économique par le nouveau poids de Beijing. Un nouvel engagement sur des bases contractuelles entre les États-Unis et ses voisins latino-américains semble indispensable pour une relation partagée et plus apaisée, alors même que la pandémie bouscule l’ordre établi. Enfin, les crises sociales récentes, comme celle au Chili en 2019, ont favorisé l’émergence de nouveaux leaders politiques qui remettent en question le modèle néolibéral soutenu par les États-Unis. Cette dynamique sociopolitique entraîne une méfiance accrue à l’égard de l’influence américaine.
Pour aller plus loin ;
- BERG, Eugène. « Livre – LA politique des Etats-Unis en Amérique latine : interventionnisme ou influence ? », Revue Conflits, 01/08/2020.
- « Biden poursuit son opération séduction auprès de l’Amérique latine », l’Orient-le Jour, AFP, 03/11/2023.
- DABÈNE, Olivier. L’effet Trump en Amérique latine: une nouvelle donne régionale?. Les Études du CERI, 2018, 233-234, pp.4 – 8.
- DROUHAUD, Pascal. « L’Amérique latine : enjeux et perspectives internationales », Revue Défense Nationale, n°855, 10/2022, pp. 103 à 110.
- FONTAINE, Marion. « Au Sommet des Amériques, l’effritement de l’influence des Etats-Unis sur le continent », Géo, 07/06/2022.
- KANDEL, Maya. « Le virage sud-américain de Joe Biden met en furie les républicains », Mediapart, 02/05/2023.
- OVARLEZ, Lola. « Biden-Trump, même combat en Amérique latine », L’Opinion, 23/02/2024.
- STEELS, Emmanuelle. BENRABAA, Najet. DERROISNÉ, Naïla. « Sommet des Amériques : Joe Biden soigne les relations avec ses voisins », France Info, 03/11/2023.
- VAGNOUX, Isabelle. « Les Etats-Unis et l’Amérique du Sud : des voisins distants », Politique Etrangère, Institut Français des Relations Internationales, 2013/4, pp. 65 à 76.
- VENTURA, Christophe. « Etats-Unis-Amérique latine : quelles perspectives après l’élection de Joe Biden ? », Note d’analyse réalisée par l’IRIS pour le compte de l’Agence française de Développement,02/2021.
 |
(*) Athénaïs Jalabert-Doury est actuellement étudiante en relations internationales à l’ILERI et stagiaire au sein de la revue Espritsurcouf. Elle se passionne notamment sur les sujets de sécurité internationale, plus particulièrement dans les zones géographiques des Amériques et de l’Europe. |