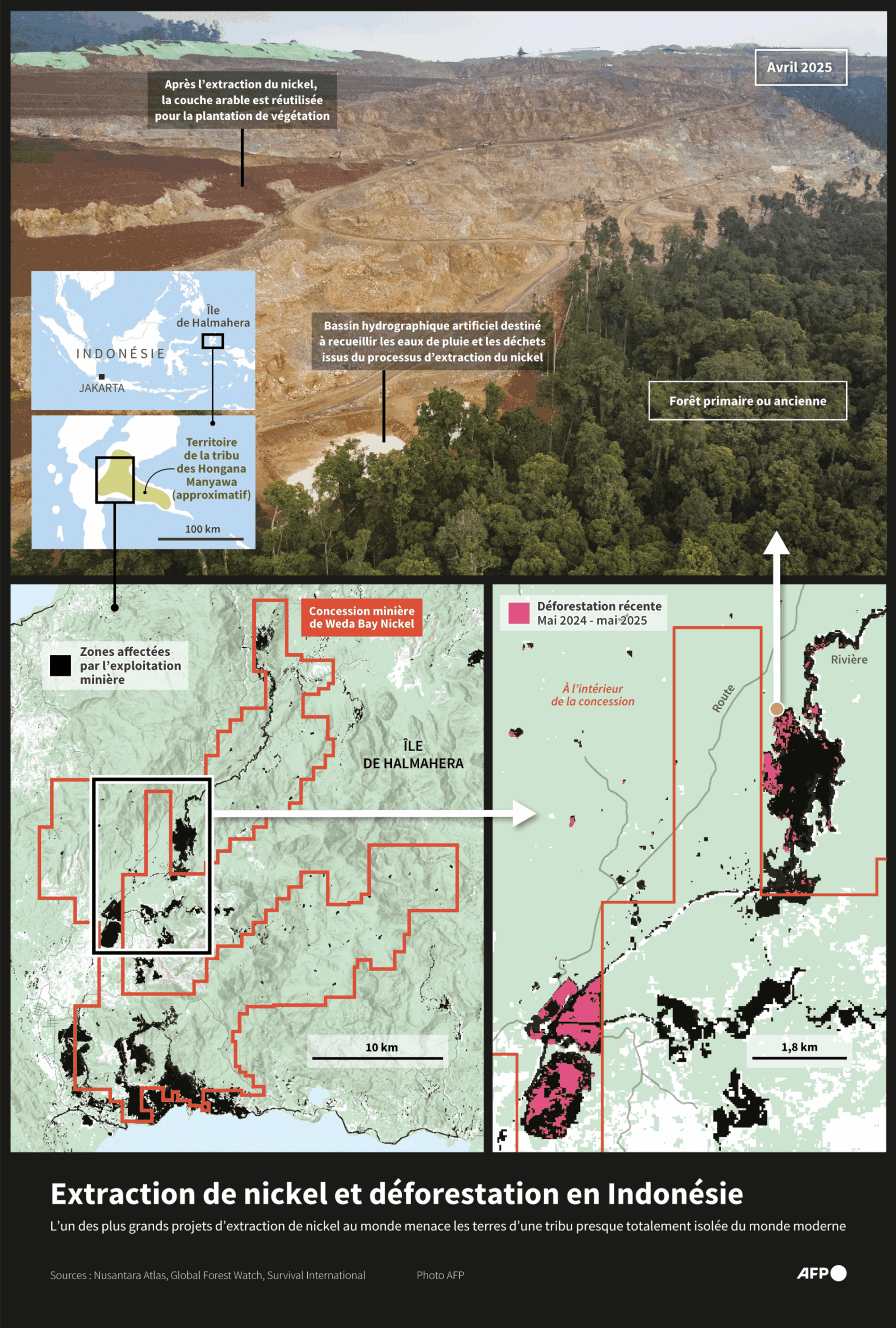Après les attaques contre les alaouites, c’est au tour des druzes d’être menacés. Une insécurité constante qui témoigne des difficultés de la nouvelle Syrie et qui fait craindre le spectre d’une guerre de communautés.
Le 8 décembre 2024, le régime de Bachar el-Assad cédait face à l’offensive d’une coalition de rebelles et de djihadistes dirigée par le groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTC) dont le chef, Ahmed al-Charaa (de son ancien nom de guerre Abou Mohammed al-Joulani), est depuis devenu président intérimaire de la Syrie. Le soulagement consécutif à la chute du dictateur laissait rapidement place à l’inquiétude des minorités syriennes exposées aux potentiels désirs de vengeance de la majorité sunnite désormais au pouvoir.
Dès son accession aux responsabilités, le nouvel homme fort de Damas, qui indique aspirer à une Syrie unifiée, semblait soucieux de rassurer les différentes communautés et invitait les sunnites à rejeter toute violence à l’encontre des alaouites, affaiblis par la chute de Bachar el-Assad, et des autres communautés. Al-Charaa rappelait ainsi à ses hommes que « l’islam nous a enseigné la bonté et la miséricorde… Soyez un modèle de tolérance et de pardon »[1].
Les tensions confessionnelles et communautaires ont cependant eu raison des appels au calme répétés du nouveau dirigeant et ont abouti à des violences contre les alaouites mais aussi contre la minorité druze. Les druzes, dont une partie significative vit en Israël, s’interrogent quant à leur futur au sein de cette nouvelle Syrie et se retrouvent tiraillés entre un déficit de confiance grandissant vis-à-vis de Damas et les promesses de sécurité émanant de Tel-Aviv.
Des tensions communautaires qui aggravent le déficit de confiance
La majeure partie des 700 000 druzes de Syrie[2], soit 3% de la population du pays[3], vit dans la province de Soueïda, située à une centaine de kilomètres au sud de la capitale syrienne et proche des frontières jordanienne et israélienne. Relativement épargnés sous Bachar el-Assad, les druzes assuraient leur propre sécurité. Le départ du fils de Hafez el-Assad a mis fin à cette situation de relative autonomie et de nombreuses délégations en provenance de Damas se sont présentées au cheikh Hikmat al-Hijri, chef religieux de la minorité qui pratique une branche de l’islam chiite, afin d’envisager un rapprochement. Outre cette province, approximativement 250 000 druzes se trouvent en périphérie de Damas, notamment dans les banlieues de Jaramana et Sahnaya.
Les premiers échanges entre le régime et l’autorité religieuse druze sont cordiaux. En décembre 2024, le cheikh déclarait ainsi donner sa chance aux nouvelles autorités avec des réserves : « Leurs paroles sont bonnes, mais nous attendons les actes. Pour le moment, le gouvernement provisoire n’a pas de légitimité populaire »[4]. Début mai, les perspectives de collaboration se sont grandement détériorées. En témoignent les récentes prises de parole du cheikh Hikmat al-Hijri qui dénonce des tueries « collectives, systématiques, claires, visibles et documentées » visant les druzes et indique ne plus faire « confiance à un groupe qui se désigne comme gouvernement », reprochant notamment à Damas de ne pas tenir ses hommes[5].
Les premiers signes d’inquiétude sont apparus au moment des exactions perpétrées par HTC dans la ville de Lattaquié et ses alentours à l’encontre des alaouites au début du mois de mars. Prétextant avoir subi des attaques de la part d’éléments restés fidèles à l’ancien régime, HTC se livrait à un déferlement de violence dans ce bastion alaouite mais aussi dans des localités environnantes. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, 1 383 alaouites ont été assassinés par les djihadistes du groupe HTC[6]. La communauté druze, dont la confiance a été ébranlée par ces tueries, sera visée à son tour quelques semaines plus tard.
Le lundi 28 avril, une vidéo d’un homme insultant le prophète Mahomet circulant sur les réseaux sociaux est attribuée à un dignitaire religieux de la minorité druze. Un communiqué du ministère de l’Intérieur indiquant qu’aucune preuve ne vient étayer cette thèse ne suffira pas à empêcher des hommes armés de s’en prendre aux druzes résidant dans la banlieue de Jaramana, en périphérie de Damas, dans la nuit de lundi à mardi. Le mercredi, des violences éclatent dans la ville de Sahnaya, proche de Damas, mais aussi dans la province de Soueïda. Au 1er mai, l’Observatoire syrien des droits de l’homme annonçait que plus de 100 personnes avaient été tuées dans ces combats.
Alors que le gouvernement promettait que les responsables de l’attaque seraient poursuivis et traduits devant la justice, le cheikh Hikmat el-Hijri dénonçait une « campagne génocidaire » et réclamait l’intervention de « forces internationales pour maintenir la paix ». Un déficit de confiance largement partagé par sa communauté comme en témoignent les récents points de blocage avec le gouvernement.
La question sécuritaire source de crispation
Les représentants du gouvernement sont « très respectueux et positifs. Mais nous voulons de l’action ». Relayé par le New York Times, ce sentiment d’un leader druze résume celui de ses coreligionnaires[7]. Après avoir subi les assauts des djihadistes, les habitants de Jaramana et Sahnaya ont déploré l’absence de protection de la part du gouvernement. Les druzes ont donc dû sécuriser leurs villes par leurs propres moyens. Estimant la nouvelle administration responsable de la situation, ils dénoncent les insuffisances d’un gouvernement qui indique pourtant avoir déployé des hommes autour de la ville.
Damas, qui assure pouvoir protéger tous les habitants, a demandé aux résidents druzes de déposer les armes et de les confier au gouvernement. A l’issue des combats de Jaramana, les représentants de la minorité ont trouvé un accord avec le régime en vertu duquel ils ont accepté de remettre leurs armes lourdes mais refusent pour l’instant de renoncer aux armes légères tant que l’armée n’aura pas prouvé sa capacité à la protéger[8]. Cité par Reuters, un membre du comité de Jaramana explique que « c’est notre droit d’avoir peur, car nous avons vu ce qu’il s’est passé ailleurs ». Et de poursuivre « dès qu’il y aura un état capable de canaliser ses forces, nous n’aurons aucun problème à remettre nos armes »[9]. Le média indique que cet accord prévoit également que les milices druzes intégreront les rangs du régime en échange de la possibilité de protéger leur communauté. Interrogé par Al Jazeera, un membre de la minorité druze estime toutefois que la situation est proche de la sédition, soulignant ainsi la fragilité de ce projet d’intégration[10].
Le sentiment d’insécurité vient s’ajouter à des griefs d’ordre économique à l’encontre du nouveau gouvernement qui avaient déclenché une manifestation à Soueïda en mars dernier. A cette occasion, des hommes armés s’étaient emparés du bureau du gouverneur désigné par Ahmed al-Charaa et avaient accroché des drapeaux druzes au-dessus du drapeau syrien. La milice druze Rijal al-Karama, à qui le gouvernement a délégué les missions de police, n’était pas intervenue. « Ce n’est pas notre responsabilité de décrocher le drapeau druze » avait ainsi indiqué Basim Abu Fakhr, porte-parole de la milice[11].
Ce refus d’intervention illustre la difficulté pour Ahmed al-Charaa d’intégrer les milices druzes à l’armée syrienne. Alors que le président par intérim était parvenu à trouver un accord avec une importante milice d’une autre communauté, les kurdes des Forces démocratiques syriennes[12], les accords récemment conclus avec les représentants druzes de Jaramana prévoyant l’intégration de leurs miliciens aux forces étatiques doivent encore être mis en application et demeurent fragiles. De plus, ceux qui avaient précédemment accepté de soutenir le nouveau gouvernement, comme les hommes du groupe Rijal al-Karama, refusent de prendre position contre leur communauté et rechignent à utiliser le matériel envoyé par le ministère de l’Intérieur en raison de menaces de la part d’autres milices druzes[13].
Perdant patience, le ministère de la Défense a déclaré que l’ensemble des groupes armés devaient rejoindre les forces gouvernementales avant le 28 mai[14]. Alors que le délai a expiré et que HTC tente de rassurer les minorités en menant des opérations contre des groupes terroristes, notamment à Alep, il conviendra d’observer les réactions de ces différents groupes ainsi que la solidité du processus d’intégration. En cas d’échec, le malaise de la communauté druze pourrait profiter à Israël.
Le malaise druze, une opportunité pour Israël
Le 2 mai dernier, soit immédiatement après les violences ayant visé les druzes, Israël bombardait les alentours du palais présidentiel de Damas afin d’afficher son soutien à une communauté liée à l’état hébreu. Environ 150 000 druzes vivent dans le nord d’Israël et sur le plateau du Golan. Bénéficiant d’une reconnaissance officielle comme minorité religieuse depuis 1957, la communauté druze participe à la vie du pays, la plupart de ses membres effectuent leur service militaire sous le drapeau israélien et certains occupent même un rôle politique. Comme le rappelle Le Figaro, 5 000 druzes sont tombés au combat depuis l’indépendance israélienne et environ 20% des membres de la communauté disposent de la nationalité israélienne[15].
Désireux de renforcer sa sécurité afin d’éviter toute menace liée au nouveau gouvernement syrien et à ses membres les plus radicaux, Tel Aviv entend coopérer avec les druzes afin de sécuriser sa frontière avec la Syrie. Pour ce faire, Benyamin Nétanyahou a constamment rappelé que la protection des druzes était une des priorités de son gouvernement, répondant ainsi à leur besoin de sécurité. Ainsi déclarait-il : « Nous n’autoriserons pas le régime islamiste de Syrie à s’en prendre aux druzes. Si le régime les attaque, nous riposterons… », et d’ajouter « nous ferons tout pour éviter les attaques contre nos frères druzes de Syrie »[16].
Israël a depuis envoyé des troupes dans des localités situées en territoire syrien afin d’y ériger des barrières dans le but de prévenir toute offensive djihadiste. Parallèlement, Tel Aviv avait lancé 89 incursions terrestres et 29 frappes aériennes et d’artillerie dans le sud-ouest de la Syrie entre février et le début du mois d’avril[17]. Ce déploiement de forces terrestres et ces bombardements s’accompagnent de la mise en place d’un centre mobile de triage des blessés afin de « soutenir la population syro-druze ». Israël a également organisé l’acheminement de ressources humanitaires par voie aérienne afin de permettre aux druzes de « faire face aux défis humanitaires » qu’implique la situation en Syrie[18].
La communauté druze de Syrie est pour l’instant divisée quant au positionnement à adopter vis-à-vis de la protection proposée par Israël. Attachés à la Syrie, les druzes s’inquiètent néanmoins de l’insécurité croissante et de la menace djihadiste. L’intervention du cheikh Hikmat el-Hijri réclamant l’intervention de forces internationales n’est pas anodine et souligne que les druzes ne bénéficient pas de l’appui d’une quelconque puissance étrangère comme cela est le cas des kurdes, soutenus par les Etats-Unis. La perspective d’une protection, ainsi que celle d’une économie plus prospère avec notamment des emplois en territoire israélien, pourrait encourager les druzes syriens à s’entendre avec Israël.
Il y a un mois, Israël et les druzes de Syrie ouvraient un « nouveau chapitre » de leurs relations avec l’entrée en territoire hébreu d’une délégation religieuse druze venue effectuer un pèlerinage en Galilée, sur la tombe de Nabi Shuaib, un site religieux druze[19]. Ce pèlerinage qui intervient alors qu’aucun druze syrien n’était entré en Israël depuis 50 ans symbolise le rapprochement à l’œuvre entre israéliens et druzes de Syrie[20].
[1] https://www.lefigaro.fr/international/de-djihadistes-a-rebelles-la-mue-opportuniste-du-groupe-hayat-tahrir-al-sham-a-l-origine-de-l-offensive-en-syrie-20241202
[2] https://www.france24.com/en/live-news/20250430-syria-s-druze-minority-caught-between-islamist-government-and-israel
[3] https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/presentation-de-la-syrie/
[4] https://www.lemonde.fr/international/article/2025/01/06/les-druzes-de-souweida-cherchent-leur-place-dans-la-syrie-post-al-assad_6483408_3210.html
[5] https://www.aljazeera.com/news/2025/5/1/syrian-druze-leader-condemns-government-over-sectarian-violence
[6] https://www.lorientlejour.com/article/1451438/violences-en-syrie-au-moins-1383-civils-tues-depuis-le-6-mars-nouveau-bilan-ong.html
[7] https://www.nytimes.com/2025/05/01/world/middleeast/syria-sectarian-attack-druse.html?searchResultPosition=13
[8] https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/after-clashes-syrian-druze-leaders-sign-deal-to-hand-over-heavy-weapons-to-regime/
[9] https://www.reuters.com/world/middle-east/druze-near-damascus-resist-demand-turn-arms-tensions-boil-2025-05-06/
[10] https://www.aljazeera.com/news/2025/5/9/syrias-druze-divided-as-sectarian-tensions-linger-after-violence
[11] https://www.wsj.com/world/middle-east/deadly-attacks-on-syrias-small-druze-community-are-part-of-a-bigger-fight-c9a9ba70?mod=Searchresults_pos3&page=1
[12] https://www.wsj.com/world/middle-east/fierce-fighting-with-assad-supporters-poses-toughest-test-for-syrias-new-rulers-0ebd7a13?mod=article_inline
[13] https://www.wsj.com/world/middle-east/deadly-attacks-on-syrias-small-druze-community-are-part-of-a-bigger-fight-c9a9ba70?mod=Searchresults_pos3&page=1
[14] https://www.reuters.com/world/middle-east/syria-sets-deadline-small-groups-join-defence-ministry-2025-05-18/
[15] https://www.lefigaro.fr/international/pourquoi-israel-courtise-les-druzes-de-syrie-20250315
[16] https://www.spectator.co.uk/article/israel-has-a-plan-for-syria/
[17] https://www.wsj.com/world/middle-east/in-southern-syria-israel-is-the-power-that-matters-1d2d95f6?mod=Searchresults_pos8&page=1
[18] https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/artc-tsahal-deploie-un-centre-de-triage-des-blesses-au-sud-de-la-syrie-pour-la-communaute-druze
[19] https://www.timesofisrael.com/new-chapter-syrian-druze-clerics-enter-israel-for-first-pilgrimage-there-since-1948/
[20] https://www.fdd.org/analysis/2025/03/15/historic-festive-day-elated-crowds-of-israeli-druze-welcome-syrian-druze-clerics-visiting-israel/